Camilo CasteloBranco
VINGT HEURES DE LITIÈRE
Traduction de René Biberfeld
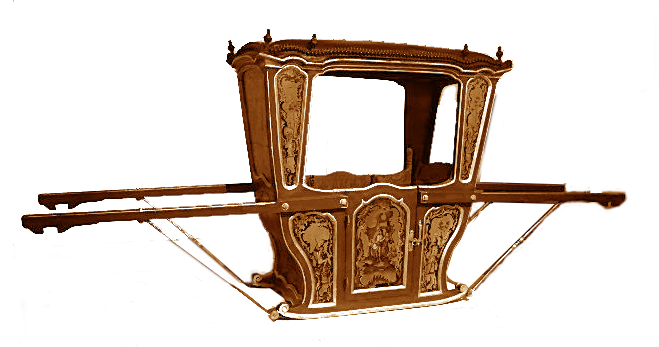
Image : Museo dos Coches - Lisboa
|
Le progrès est un gouffre.
La litière [1]
se débat déjà dans la gueule du monstre.
L'heure fatale va sonner ! D'ici peu, la litière va disparaître de la
face de l'Europe.
Le dernier refuge de l'ancienne, c'était le Portugal. On
ne l'a même pas laissée ici, dans ce magasin d'antiquailles ! Même pas
ici ! La pauvre, toute décrépite, couverte de poussière et de sueur,
vieille de sept siècles, frissonne, saisie d'effroi, elle écoute
l'horrible frémissement du wagon, qui fait battre les ailes crépitantes
de l'infernal hippogriffe.
À mesure que la vapeur taillait les plaines, elle
franchissait, épouvantée, les défilés pour se cacher. Mais la boucharde
et la ratissoire ont gravi les pentes raides et rocheuses des
montagnes, et la litière, traquée par le char-à-bancs, s'engouffra dans
les sentiers caillouteux, et se blottit à l'ombre du manoir abrupt et
inaccessible au roulement des carrosses.
Et voilà que la contemporaine du Portugal des chroniques
se tord et agonise en lâchant son dernier souffle.
La terre de Dom João Ier et de Nuno Alvares se meurt
avec la litière de João das Regas et de Pedro Ossem!
D'ici douze ans, la litière de location sera une
tradition, même pas perpétuée par la gravure. Dans un recoin de quelque
écurie d'un petit palais, pourriront encore les reliques de la noble
litière, mais ce n'est pas la litière offerte en holocauste au macadam,
à la diligence, à la malle-poste et au rail. C'est elle, c'est la
litière sacrifiée, la litière avec ses deux vigoureux mulets et ses
cinquante stridulants grelots, qui disparaît d'un coup, débitée à la
scie et à l'herminette pour réparer d'ignobles voitures et d'immonde
charrettes. C'est elle que je regrette, parce qu'elle a bercé mes
premières pérégrinations ; parce que du guichet de l'une d'elles, j'ai
vu, en quittant les villes, mes premières prairies, mes premiers bois,
et mes premières montagnes escarpées ; parce que le tintement de ses
sonnettes me mettait l'âme en joie, quand ses résonances festives
interrompait l'après-midi mes cogitations sur ces routes du Minho et de
Trás-os-Montes ; parce que c'est finalement dans une litière que j'ai
trouvé ce livre que vous allez, cher lecteur, feuilleter avec votre
patiente bienveillance.
Il y a quelques années, je faisais le trajet de Vila Real
à Porto. Je suis arrivé, l'âme et le corps brisés, à un hameau caché
dans les falaises du Marão, du nom d'Ovelinha. Le canasson qui m'y
avait amené, s'était mis à siffler en gravissant la pente, de telle
sorte qu'au sommet où l'on crie "Aux roues !", ses poumons se bombaient
avec une telle ardeur, accompagnés d'une toux caverneuse, qu'il n'y a
rien de triste que je puisse ajouter !
Quand je mis pied à terre, je rendis le cheval à son
propriétaire, et me mis à la recherche d'un maquignon qui me louerait
une monture moins poitrinaire jusqu'à Amarante. Revenant à l'auberge,
je trouvai une litière arrêtée, qui était arrivée jusque là. J'ai
demandé à son conducteur s'il s'en revenait. Il me répondit qu'il
conduisait un voyageur. J'ai contemplé la litière avec autant de
chagrin que d'envie, surtout lorsque la petite jument galicienne que
j'avais dénichée se mit à tousser d'une façon plus que significative,
qui annonçait une pousse et une morve royales.
J'ai été surpris dans mes réflexions par le locataire du
véhicule que je convoitais. Ô rayon de lumière !… ô bouffée
d'espoir qui me viens parfumée du paradis terrestre !… C'était mon ami
António Joaquim.
– Toi, ici !? s'exclama-t-il de la fenêtre de l'auberge.
– Oui, c'est moi, ici… et toi ?!
– C'est moi aussi, dans ce royaume des morts, dans ce
vestibule de l'enfer ? Où vas-tu ?
– À Porto, si l'on m'y emmène.
– Qui t'y emmène ?
– Cet emphysème à quatre pattes.
– Sois raisonnable, mon vieux ! Abandonne cette rosse aux
fauves du Marão, et assieds-toi à l'intérieur de cette litière.
Quand je suis parvenu à me convaincre que je ne rêvais
pas, j'éprouvais pour António Joaquim une reconnaissance que j'arrivais
à peine à contenir dans ma poitrine dilatée de joie. Je me hissai
jusqu'à sa fenêtre en grimpant sur le tronc d'une vigne, et lui serrai
la main, en m'exclamant :
– À la vie et à la mort ! Tu m'as sauvé, António
Joaquim ! Cette litière, ces clochettes et ces mulets vont peser dans
la balance de tes actes de charité !
Sur quoi, je descendis en m'accrochant aux branches de ce
cep.
– Cette apostrophe, dit-il, t'a mis sur les genoux !…
Viens prendre un bouillon de poule.
António Joaquim est un homme de quarante ans,
propriétaire, marié, qui réside dans l'un de ses domaines du Minho, aux
environs de Braga.
Il a une biographie sereine, qui tient en peu de
mots, et réconfortante pour qui est habitué aux biographies
orageuses et pleines de rebondis–sements.
Il a entamé des études qui devaient faire de lui un
prélat. Sa sainte mère avait rêvé que son fils recevrait la mitre. Dès
que l'enfant eut appris l'alphabet, elle l'envoya faire ses études à
Braga. Le gamin s'y rendit, contre la volonté de son père, qui ne
pouvait pas sentir les prêtres du requiem ; mais la volonté et le rêve
de son épouse ont prévalu contre la sienne.
À sa cinquième année de latin — un long espace de temps
qui excédait celui fixé par sa mère pour voir son rêve se réaliser
— il partit en vacances, et s'amouracha de la fille unique de
riches laboureurs. Moyennant quoi, le cœur d'António Joaquim connut de
terribles tourments, autant chez lui avec sa mère, qu'en dehors de chez
lui avec un rival, comme on le dira plus tard ; il finit par se marier,
et déposa aux pieds de la galante enfant la mitre épiscopale dont avait
rêvé sa mère, et les connaissances en latin qu'il avait engrangées en
cinq ans, lesquelles, à ce qu'il dit, ne valaient pas plus que la mitre.
António Joaquim est riche. Deux maisons se sont unies qui
donnent, en une année de récolte normale, mis à part le vin, deux cents
chariots d'huile, de châtaignes et de patates. Il élève des poulains,
qui lui ont valu d'être souvent roulé, et lui ont permis de rouler ses
meilleurs amis ; un détail qui ne salit pas le moins du monde la
réputation d'un homme qui fait commerce de poulains. Il engraisse aussi
des bœufs pour l'Angleterre tout en étudiant les inconvénients
économiques de l'exportation des bœufs.
Sa vie se perd en foires, à surveiller ses terres, il se
ménage quelques heures de loisir pour lire des ouvrages d'agriculture,
et il est passé maître en matière de menuiserie. C'est lui qui fabrique
les charrettes de ses enfants, les dévidoirs de son épouse, les râteaux
et les pelles de ses domestiques, il fait aussi des quenouilles, des
fuseaux, et des auges, tout cela à la perfection.
L'on a voulu envoyer António Joaquim au parlement, parce
qu'il présente des aptitudes pour les études économiques, et parle
couramment notre langue en se faisant entendre des gens du peuple. Mon
ami a refusé cette candidature parce qu'il est jaloux de son bien-être,
et dit qu'il n'a jamais reçu un coup de sabot des poulains rétifs qu'il
a apprivoisés : il n'en serait sûrement pas de même au parlement avec
ses collègues. On l'a nommé à d'autres postes officiels, et il les a
tous abandonnés à qui les voudrait, se réservant la gloire de raser de
près, avec la lame affilée de ses épigrammes les mentons des autorités,
dans des articles qu'il envoie, depuis dix ans, dans les gazettes en
signant, d'une façon tout à fait originale : Un fidèle lecteur.
Il n'y a plus rien à dire d'António Joaquim, que j'ai
rencontré à Ovelihna.
Nous avons bu à l'auberge une eau chaude et huileuse dans de
grosses écuelles, dont le fond était décoré de coqs qui avaient l'air
de scorpions. Nous avons avalé des morceaux de poule qui se jouaient du
mécanisme de la manducation, et nous sommes montés dans la litière.
Il était dix heures du matin.
Ici commencent ces vingt heures.
I
INTRODUCTION À L'HISTOIRE DE LA JUMENT
Tu fais encore des romans ? me demanda mon ami.
– Oui… Sedet
aeternusque sedebit, Infelix…[2] Je fais des
romans, et j'expie les péchés de mes aïeux, dans cet incessant effort
pour faire rouler jusqu'au sommet de la montagne mon rocher et glisser
avec lui au fond de la vallée.
– Tu es bien maigre, mon vieux ! fit-il observer, en me
palpant le cou, avec sans doute le tact magistral d'un homme qui
estimait la nutrition des poulains, à partir des fibres denses et de la
graisse de leur cou.
Renonce à ce mode de vie si tu n'aspires pas à te faire
momifier. Écoute, la nature a produit des hommes, pas des lettrés.
Quand il a chassé Adam du paradis, le Créateur a eu la compassion de ne
pas lui dire : " Tu seras écrivain !" Ce qu'il lui a dit, c'est :" Tu
gagneras ta vie à la sueur de ton front." Considère, mon ami, qu'il est
nécessaire de suer pour vivre. Et l'écrivain ne sue pas : il ne tardera
pas à mourir atrophié, comme je te vois, mon pauvre vieux ! Tu t'es
éloigné des prescriptions de la nature : reprends-toi, et corrige ce
vice.
– C'est là une chose qui ne se corrige pas.
– Veux-tu me dire que l'imagination est un aiguillon ?
Mets des caveçons à ton esprit ; prends ses rênes ; et s'il s'entête,
frappe-le à la tête avec une pierre. L'imagination qui fait des romans,
c'est un talent perdu, comme les talents cachés dont parle la parabole
de Jésus[3]. Pourquoi
n'emploierais-tu pas ton imaginative à des tâches
utiles ? Invente une araire, un moulin, un auget, un drain de rivières,
un piège à taupes, de la glu pour décimer les grillons et les moineaux.
Consacre ta fantaisie à un autre genre d'inventions, de sorte que les
mouvements de ton corps deviennent moins gourds, que l'air pur ne soit
plus filtré par les vitrages de tes poumons. Fais travailler tes
muscles, en les remuant, exerce tes fonctions respiratoires en
redressant ton corps, pour prendre une position verticale ; régénère
ton sang, et tu verras que tu es encore un homme… Tu me fais de la
peine !…
– À moi aussi, lui lançai-je.
– Et puis, avec ta permission, continua Joaquim António,
je vais te dire mon sentiment : tes fantaisies romanesques sont, la
plupart du temps, contraires à la nature et fausses.
– Ça, par exemple !…
– Tu peux être étonné, mais ne prends pas mal ma
grossièreté. Tu sais que je lis tes romans : c'est le plus grand
sacrifice que je puis te faire durant mes heures de loisir. Tes livres
ont cet avantage, que je les lis. Je suis accroché par des paradoxes
sur la vertu que tu étires sur trois cents pages. Tu as déjà fait
pleurer ma femme, pour un peu, tu me la mettais sur les nerfs ! Il m'a
fallu lui dire que tu mentais comme deux ministères, et que tu te
piquais d'avoir un style qui, comme les oignons et la moutarde des
sinapismes, fait jaillir des fontaines de sanglots. Même avec de tels
arguments, je n'ai pas réussi à te discréditer ! Dès la parution d'un
de tes romans, ma femme, acoquinée avec ton éditeur, éprouve ma
patience jusqu'à ce que ton livre arrive de Braga entre un petit paquet
de sucre et son sac de riz. La pauvre femme commence à pleurer en
voyant le titre, ne ferme pas l'œil de la nuit pour le lire ; et, le
lendemain, elle a les yeux cernés, elle est jaune comme les douze
phtisiques que tu as conduites à leur tombeau dans un torrent de
larmes. Tu as des romans, cher ami, qui mentent dès le titre. J'ai
commencé à en lire un, ça ne fait pas longtemps, qui s'intitule : "La
femme qui sauve."
– Et alors, rétorquai-je, qu'est-ce qu'il a ce titre ?
– Il n'a pas le sens commun.
– Ça me laisse sans voix !… Alors la femme qui sauve…
– Il n'y a pas de femme qui sauve. Un homme que l'une a
perdue, ne peut être sauvé par une autre.
– Tais-toi donc ! Tu ne connais rien au cœur humain. Tu
t'es marié, António Joaquim, lui répondis-je, tout jeune, il y a dix
ans ; tu as vieilli le jour de ton mariage ; tu es d'une matière qui
prédispose au bonheur ; tu n'entends pas ce que c'est que l'infortune
ni les joies du cœur, des joies qui alternent avec les chagrins, voilà
la vérité ; mais il est également certain qu'en dehors de la sphère de
tes goûts, il y a des délices du domaine de l'esprit, des femmes
providentielles, on les a fait descendre du ciel, on les déverse comme
des baumes recueillis dans les ruches des anges…
– Voilà un style on ne peut plus touffu, dit-il. Ce qui
est absurde ne se présente pas mieux quand on le justifie dans une
langue absurde. Vous autres, les conteurs d'infortunes bien
matérielles, les échevins des plaies sociales les plus purulentes, vous
devriez être obligés de vous taire, pour la même raison que la police
des cités oblige les mendiants à cacher leurs infirmités et leurs
chancres nauséabonds. Et c'est vous, qui exposez des ulcères en nous
accusant d'avoir un esprit matériel, nous qui avons un langage simple,
et le jugement aussi clair que lui, pour censurer et vitupérer les
incroyables démons que vous nous présentez à côté de quelques anges
impossibles. Si nous vous entreprenons, en mettant en doute l'existence
sublunaire de femmes qui sauvent,
vous en arrivez, toi et ceux qui
participent à vos mensonges, à crier dans un style embrouillé qu'il y a
des femmes qui nous procurent des baumes célestes, recueillis dans les
ruches des anges. Bigre ! Je crois autant à ces femmes qu'aux ruches
des anges, dont les abeilles sont ces anges en personne. Des anges pour
tous les usages ! C'est un épouvantable gâchis de puissances célestes
que font les écrivains à la mode. Si l'on vous ferme la porte du ciel,
comme l'on a fermé celle de l'empyrée aux poètes d'il y a soixante ans,
ma parole d'honneur que je ne sais pas où vous irez chercher du lest
pour vos poèmes et vos romans ! Vous coulerez par le fond faute de
poids pour vos fragiles planchettes…
Je l'interrompis, outré au nom de mes collègues :
– Il semble que tu arrives gonflé d'une science prise aux
fosses de Salamanque ! Serait-ce une maladie de l'esprit que te
donne la longévité de cette litière ?! Cela ne m'étonne pas que
Volney, assis sur les ruines de Palmyre, se lance dans des discours
funèbres sur les ruines des empires et de l'humanité ; et je m'étonne
encore moins qu'un homme éclairé comme toi, bercé dans une locomotive
comme celle-ci, se sente ramené aux temps du Feliz Independente et
dédaigne le roman moderne, contemporain de la vapeur !
– Ma question est d'un autre ordre, rétorqua mon ami. Je
ne loue ni ne déprécie ce qui se faisait il y a cent ans. Je réprouve
la contrefaçon des types que l'on propose de nos jours dans le roman,
et particulièrement dans les tiens. Quand je lisais des nouvelles, je
préférais l'école des châteaux lugubres, des fantômes qui apparaissent
à minuit, des vampires qui nous épargnent les sangsues, et des
bourreaux aux yeux écarquillés, qui luisaient dans les ténèbres des
cachots. Cela me distrayait et m'épouvantait de les lire. Une fois
terminé le volume, j'éclatais de rire, et faisais l'éloge de l'auteur
en ces termes :"Voilà un grand drôle !" Mais quand je lisais, de loin
en loin, un roman de l'école réelle, ou réaliste, comme disent les
Français, à la fin du livre, je ne riais pas : je me livrais à de
tristes méditations, et me disais :" C'est vrai ; le monde est fait
ainsi ; les misères du genre humain réfutent la perfection des œuvres
divines qu'elles font tomber du haut des astres sur le sol. L'aspect
physique de l'homme est aussi admirable que celui d'un insecte
microscopique ; mais la morale de l'homme est repoussante, elle est
terriblement hideuse !" La voilà, la raison de mon abomination pour les
romans qui s'inspirent de la nature. Je pense, à présent qu'il y a une
école mixte, à laquelle tes livres appartiennent.
– Mixte ?
– Oui : vous inventez d'impossibles vertus à côté de
perversités qui défient le sens commun. Dans le même chapitre, on nous
offre une femme nue exsudant le pus de sa gangrène morale, et une autre
femme portant le manteau des vierges, qui exhale les arômes des petites
fleurs de l'Hybla. À côté de l'aspect plébéien de la taverne,
l'orientalisme des figures magnifiques de la Bible.
– Et si la société, c'est cela , répliquai-je. Si la vie,
c'est ce mélange qui te répugne, comment veux-tu que j'écrive, António
Joaquim ?
– La société, ce n'est pas cela, mon vieux ! Toute
disgrâce commune a sa raison d'être ; tout crime a une face émouvante
qui implore le pardon pour un délit répugnant. Il n'existe pas de crime
absolument impardonnable ; il n'y a pas non plus de vertu immaculée. Je
refuse que l'on confronte deux femmes, et que l'on dise :" Cette femme
a provoqué la perte d'un homme, cette femme l'a sauvé." Celle qui l'a
perdu dégringole de marche en marche ; celle qui l'a sauvé s'élève
parmi les nuages, jusqu'à se dérober à l'analyse de l'esprit humain.
L'une entre en enfer sans donner la raison pour laquelle le romancier
l'y a expédiée ; l'autre frappe aux portes du ciel, et comprend qu'elle
ne vit pas honnêtement en compagnie des onze mille vierges.
Je l'interrompis :
– Ce n'est point là poser des questions ; c'est faire de
l'esprit. Quoi qu'il en soit, c'est une chose qui témoigne
avantageusement de tes qualités de plaisant. Entends-tu qu'il n'y a, en
aucun cas, de femme qui sauve ?
– Oui. Il n'y a qu'une chose qui sauve : c'est
l'expérience des femmes fatales. Il y en une autre que je n'ose te dire
de peur que tu ne me prennes pour un farceur de mauvais goût.
– Et qu'est-ce que cette chose ?… parle !
– Une vaillante jument.
– Une vaillante jument ?! Quelle blague !
– Écoute donc l'histoire de la jument salvatrice.
II
LA JUMENT SALVATRICE
António Joaquim alluma un cigare et continua ;
– J'ai rencontré bien des obstacles avant d'obtenir la
femme que j'ai épousée. Ma mère ne voulait pas renoncer à me voir en
mitre avec la crosse ; mon père ne pouvait sentir cette jeune fille
parce qu'il l'avait vue habillée à la mode de la ville, et qu'il avait
entendu dire qu'elle vivait comme font les nobles. Le père de Maria
Clara ne pouvait pas me sentir, parce que j'avais tué, avec mon fusil,
quelques tourterelles, que j'avais prises pour des palombes ; sa mère
me vouait une haine aussi forte, parce que j'avais fortuitement
dessiné, sur le mur de l'église, un visage avec un nez énorme, et il se
trouvait que la mère de Maria Clara était affublée du plus grand nez de
notre canton. Les traîne-savates de la paroisse commencèrent à dire que
ce personnage au gros pif était le portrait craché de Mme Joana do
Ribeiro ; ce bruit parvint à ses oreilles ; elle chercha à savoir qui
était l'Apelle au charbon ; et jura que son mari serait pape, quand je
serais évêque. Le ciel sanctionna ce serment.
Un obstacle de taille s'ajouta à tous les précédents.
Avant de me voir et de lire ma première lettre, Maria Clara aimait un
hobereau d'une autre paroisse assez loin de la sienne, un garçon bien
né, mal élevé, un bravache, un sale bonhomme. Je n'en savais rien quand
j'ai commencé à lui faire la cour : l'amour l'a emporté sur le bon
sens, quand on me l'a dit. J'ai continué en écoutant mon cœur, ainsi
qu'un tant soit peu ma vanité. Je n'étais pas sans éprouver quelque
crainte : je te l'avoue ici, personne ne nous entend, à cause du bruit
des grelots. On ne peut faire de telles révélations en toute sécurité
que lorsqu'on voyage en litière.
J'ai rencontré cet aîné de bonne famille près de la
demeure de Maria Clara. Le garçon, qui devait avoir vingt-cinq robustes
années, s'arrêta devant moi, en tirant les rênes de son cheval. Le
chemin était étroit, il fallait mettre pied à terre. J'ai été
naturellement obligé de le regarder en face, en contenant la fougue de
ma jument qui avait adressé une croupade au cheval.
– Me reconnaissez-vous, Monsieur ? me demanda-t-il.
– Fort bien, lui répondis-je. Vous êtes Monsieur Belchior
Pereira.
– Pour vous servir et aimer, si cela peut vous faire
plaisir.
– Merci bien, ai-je rétorqué, devant le sourire ironique
de cet alerte cavalier, qui reprit :
– Il n'y a pas de quoi. La preuve que je vous sers et que
je vous aime, c'est l'avis que je vais vous donner. Renoncez à vous
promener dans les environs. La femme que vous aimez, je l'aimais déjà
quand vous l'avez vue. Je ne suis pas disposé à vous la céder
facilement, et je ne vous demande pas non plus de me la céder. Mes
droits sont anciens. Il y a trois ans que j'aime Maria Clara, et que je
lui écris. Vous l'ignoriez certainement.
– Je le savais, répondis-je fermement, et avec la
confiance que me donnaient mes pistolets dans mes fontes.
– Mais vous ne saviez pas tout, il faut croire,
rétorqua-t-il aussitôt. Sachez à présent, Monsieur António Pereira,
qu'un homme de qualité ne peut décemment se venger d'une parjure ; mais
se venge de l'homme qui l'a fait parjurer.
– Je ne le savais pas, fis-je. Ce système me semble
irrationnel. Il serait plus juste d'affirmer qu'un homme comme les
autres se venge d'elle ; un homme de qualité, comme vous dites,
Monsieur, ne se venge de personne.
– Ne me donnez pas de conseils, Monsieur António !
répondit-il, la mine sombre.
– Je ne vous en donne aucun ; je vous fais part de mes
idées, nous ne faisons que bavarder.
Il reprit aussitôt :
– C'est que nous ne sommes pas en train de bavarder…
– Ah non ? je croyais que…
– Qui vous a dit que j'étais du genre à papoter ? C'est un
avertissement que je vous résume en deux mots : vous devez renoncer ou
éprouver le poids de mes poings. Vous avez compris, maintenant ?
– Oui, Monsieur, j'ai compris. Je ne renonce, ni ne veux
éprouver le poids de vos poings, Monsieur Belchior. Si vous voulez
m'imposer cette triste expérience, je vous promets de vous faire
éprouver le poids de deux balles.
L'autre lança son cheval ; ma jument se cabra ; moi, je
défis les crochets de mes fontes.
Belchior s'arrêta net, en dégainant du manche de son
fouet un court poignard. Il me toisa de haut en bas trois fois avec une
solennité passant les bornes de l'admissible dans le mélodrame. Je
sentis que le petit hobereau était moins redoutable qu'il n'en avait
l'air. Je lui dis que j'allais lancer ma jument sur lui, s'il ne me
dégageait pas le passage. Il se colla au mur d'un bois, hocha trois
fois une tête lourde de menaces, et me laissa passer tranquillement.
Maria Clara se trouvait à portée de fusil, accoudée au
rebord d'une fenêtre ouverte sur le mur de la métairie. Elle suait
d'angoisse. Belchior l'avait surprise en train de cueillir, à la plante
grimpante qui formait une voûte au-dessus de la fenêtre, quelques
fleurs, et à en faire un bouquet. Il lui adressa quelques insultes en
vociférant, et lui annonça que je mourrais de ses mains après une telle
expérience.
C'est pour cela que Maria Clara suait d'angoisse. Je la
tranquillisai en confirmant que je n'étais même pas moribond, et lui
assurai que Belchior me paraissait incapable de tuer quelqu'un.
Notre correspondance se poursuivit et mes incursions sur
les terrains environnants qu'on m'avait interdits ne furent pas
interrompues. La timide jeune fille cessa de se montrer, dans le
louable dessein de ne pas m'exposer à la férocité du nobliau ; quant à
moi, je m'entêtai à la convaincre que mon audace resterait impunie.
Il entreprit d'en tirer vengeance en employant les ruses
les plus lâches.
Il dénonça au père de Maria nos courts entretiens, de la
fenêtre du mur. La mère, piquée par le nez que j'avais reproduit, sans
malice aucune, sur le mur de l'église, aiguillonna son mari, en lui
fumigeant ses vapeurs de rage, par le nez original. On interdit à la
jeune fille de se rendre à ce mirador.
Elle était sûre des intentions honnêtes et honorables de
mon amour. Mon abbé, bon et digne confident de ma passion, prit à cœur
de désobstruer le chemin d'un projet si louable. Il s'entendit avec le
recteur de la paroisse de Maria Clara, ils unirent leurs efforts pour
tempérer l'âpreté des autre vieillards qui s'étaient mis d'accord pour
travailler à notre malheur. On mettait en œuvre une diplomatie de
saints hommes pour négocier le couronnement d'une tendresse innocente :
elle produisit d'heureux effets. Mme Joana passa l'éponge de la raison
sur le dessin du nez : son mari, monsieur João oublia l'offense
involontaire à ses tourterelles ; ma mère pleura ses dernières larmes
sur la mitre et ses rêves épiscopaux ; et mon père fut obligé de
reconnaître que les habits des citadines ne donnaient, ni
n'impliquaient aucun laisser-aller chez les jeunes villageoises. Les
deux clercs estimèrent accomplie, grâce à la protection divine, leur
mission, et rédigèrent les bans qui devaient être lus au cours des
trois jours sanctifiés.
Maria Clara exulta, je baisai la main des deux bergers ;
j'embrassai ma mère en lui promettant de faire ordonner prêtre tous mes
fils, si elle voulait ; et j'ai soulevé mon père dans mes bras. Le bon
vieillard riait et pleurait, avec la satisfaction de se voir perpétué
dans sa descendance. Cet amour anticipé que l'on voue à des petits- et
arrière-petits-enfants est une joie patriarcale, un avant-goût réfugié
dans la vie de nos villages. Dans les villes, mon ami, un homme et une
femme de quarante ans, avec des enfants de dix-huit, tremblent de se
retrouver grand-père ou grand-mère. L'existence d'un petit-fils, est un
éclat de rire lancé aux moustaches faussement noires, ou aux joues
rouges de carmin.
Mis au fait de l'accord inespérée, et de la première
lecture des bans, Belchior Pereira, prémédita une cruelle revanche. Je
le devinai, Maria Clara aussi. Le hobereau quitta la région, en disant
qu'il se rendait à Porto. C'est alors que j'éprouvai le plus de
craintes, et pris le plus de précautions, sans, toutefois, cesser de
passer quelques soirées d'hiver chez ma future épouse, contre sa
volonté. Je me contentai de me faire accompagner d'un vaillant
domestique, bien armé, montant un cheval qui sautait, les quatre jambes
en l'air, à hauteur d'homme.
Je suis parti, une nuit de janvier, à onze heures, de chez
Maria Clara. Pas une seule étoile au ciel. Cette nuit était plongée
dans l'obscurité d'un sépulcre. Le brouillard glaçait la moelle des os.
Les marais bourbeux projetaient leurs éclaboussures sous les pattes des
chevaux. Les ruisseaux débordaient et couvraient les pierres des gués.
Les oiseaux nocturnes piaulaient lugubrement dans les branches
dégarnies des châtaigniers. Toutefois, mon cœur était joyeux, plein de
lumière, parfumé, gonflé de délices. Je ne me souvenais pas de
Belchior, cette nuit-là ; tant de fois, dans d'autres, j'ai attendu que
mon domestique me précédât au passage des ravins et des
carrefours.
Nous arrivâmes sur une friche qui bifurquait en deux
petits potagers au sol fort instable, à l'entrée desquels j'avais
l'habitude de mettre pied à terre. Je ne l'ai pas fait alors. J'ai dit
au domestique de passer devant pour ouvrir le chemin, avec le pas ferme
de son cheval, à ma jument turbulente et peu sûre avec les pierres
déchaussées par l'écoulement torrentiel de l'eau de pluie. Un des
chemins menait à ma demeure, l'autre allait donner sur des broussailles
assez près de là.
Mon domestique fit traverser le potager, lentement, au
pas, à son cheval. Je voulus le suivre avec ma jument ; elle resta
immobile, sans réagir à mes éperons. Je m'obstinai, au point de lui
mettre les flancs en sang. Au troisième coup d'éperon, elle se dressa
brutalement, tourna sur elle-même, grogna, mordit furieusement le
frein, et se lança tête baissée dans l'autre sentier qui donnait sur
les taillis. Je m'accrochai à sa crinière, appréhendant une chute
mortelle, quand j'entendis trois coups de feu presque simultanés. Je ne
sais ce que j'ai pensé à ce moment-là. J'ai fait un effort désespéré
pour essuyer la charge de la jument. Je voyais déjà, en face de moi,
des ténèbres plus profondes, pour ainsi dire, enfoncées dans
d'autres ténèbres. C'était l'entrecroisement des arbres qui étouffaient
les broussailles. La jument s'arrêta net, accrochée par les scions secs
qui lui raclaient le poitrail.
J'ai mis pied terre, sans savoir pourquoi, et réfléchis un
moment. J'ai été immédiatement convaincu que mon domestique était mort.
Je me remis en selle. Je revins sur le même terrain au
galop. Ma jument obéissait, sans trébucher sur les dalles glissantes,
je l'ai guidée vers le chemin d'où je m'étais enfui. J'appelai d'une
voix forte mon domestique, et ressentis une joie indicible, quand
j'entendis sa voix.
– Je suis là ; mais je ne peux pas me lever ! me dit-il.
Je m'approchai. Il était étendu sous son cheval mort. Il
m'a dit qu'il avait reçu une balle au genou, et que le cheval tué sur
le coup lui avait, en tombant, cassé l'autre jambe. Je demandai des
forces à Dieu pour dégager mon pauvre domestique du poids de cet énorme
cadavre. J'y suis parvenu quand ma vigueur était à bout. Je l'ai pris
dans mes bras, et j'ai pu le mettre sur ma jument. Je marchais à côté
de lui, en maintenant sa jambe brisée sur la selle.
Quand je me suis trouvé près de chez moi, des domestiques
partaient avec des torches de paille allumées à ma recherche. Le bruit
des détonations étaient parvenues jusqu'à la chambre de ma mère, qui
priait Dieu pour moi.
J'ai le plaisir de te dire que la fracture à la jambe de
mon brave Leonardo a cicatrisé, sans entraîner d'infirmité. La balle au
genou lui avait à peine touché la rotule, sans aucune conséquence.
Venons-en maintenant au point essentiel de cet épisode,
mon cher ami : à qui dois-je mon salut dans cette épreuve ?
– À ta jument ? C'est ce que tu voudrais que je te dise,
pas vrai ?
– Oui, sans accorder aucune faveur à ma jument.
– Eh bien, si je rapportais cette scène de ta vie dans un
livre, je ne dirais pas que c'est ta jument qui t'a sauvé.
– Qui, alors ?!
– Tu as dit que ta mère priait pour toi, quand elle a
entendu les détonations. Je crois que ce sont les prières de ta mère
qui t'ont sauvé. Cette opinion se fonde sur le sentiment et la raison.
Il suffit de croire en Dieu qui penche sa tête miséricordieuse sur les
supplications d'une mère saisie par la crainte de perdre un bon fils.
António Joaquim ne répondit pas. Il n'était pas
d'humeur à discuter sur une matière de nature à entraîner
d'avilissantes confrontations.
Je continuai :
– Ton histoire est arrivée à point pour offrir une
facétie, et une parodie au titre de mon misérable roman. Moi, comme tu
vois, j'ai écouté le dénouement de ta narration avec une gravité de
penseur. C'est une femme qui t'a sauvé, mon cher António Joaquim ; mais
une femme-mère, de celles qui intercèdent pour leur enfant, dont les
justes requêtes ne sont jamais déboutées au tribunal divin. Eh bien, si
tu me disais qu'à la même heure, mademoiselle Maria Clara, ta fiancée,
qui devait devenir la moitié de ton âme, priait pour toi — il se peut
qu'elle l'ait fait — je te dirais qu'il y a eu deux femmes pour te
sauver. Un ange — permets-moi de dire un ange tant que tu ne me
fermeras pas la porte du ciel — emporterait sur l'une de ses ailes la
supplique d'une mère, sur l'autre, celle d'une vierge. Le Seigneur
sourirait devant le saint amour de toutes les deux, et tu serais sauvé
par deux amours.
– C'est entendu ! rétorqua António Joaquim, mais
n'anéantis pas complètement la poésie de ma jument !…
– Je n'en ai absolument pas l'intention. Ta jument
est-elle encore vivante ?
– Oui.
– Bon ; donne-lui beaucoup de grain et une vieillesse
paisible. C'est en cela que consiste la véritable poésie des juments.
Et quand tu conteras cette page de tes amours, donne-lui un titre plus
humain, en rendant justice aux prières de ta mère.
III
MAUDIT SOIT CELUI D'ENTRE VOUS QUI JOUERA
Peu après, António Joaquim m'administra deux tapes sonores
sur les
épaules, et s'exclama :
– Tu dois avoir pas mal d'argent
à gauche.
– Qui, moi ?
– Et comment ! Il n'y a qu'à faire le compte des livres
que tu as publiés !... Écoute, j'ai entendu grommeler qu'on ne peut
t'attribuer certains de tes romans… Des calomnies !
– Des calomnies, réellement, mon ami. Certains, disent-ils
? On ne peut m'attribuer la propriété d'aucun des livres qui circulent
sous mon nom. Ils appartiennent tous à des éditeurs.
– Mais ce qu'on dit, c'est que tu ne peux matériellement
être l'auteur de ce qu'on lit sous ton nom.
– Ah! J'ai compris… Eh bien, je suis matériellement cette
malheureuse machine qui a écrit tout cela, tout ce lest dans les cales
du navire des lettres nationales, qui navigue à l'estime.
– Mais tu es riche ou pas ? Dis-moi la vérité !
– Oui. Je possède des fermes avec des jardins, en
comparaison desquels les jardins suspendus de Sémiramis sont des landes
impraticables. J'ai des palais qui seraient digne d'un prince
asiatique, s'ils n'étaient plus dignes de moi. Mes équipages de
frisons, mes landaus, mes
livrées…
António Joaquim m'interrompit :
– Parle sérieusement, mon vieux… Tu jouis d'une
indépendance aisée, et tu prends le chemin de…
– Mourir…
– Avec cent contos, et une statue dans ta région. Aux
frais de la patrie reconnaissante.
– Une statue de l'effroi que tu m'inspires, mon cher
António ! Si tu n'étais amusant, tu serais fou ! Tu crois donc que je
vis de mes romans ?
– Je l'ai cru…
– Que nenni… Je vis de gloire. J'ai découvert, en moi, un
second appareil digestif, qui élabore, sous forme de substance
nutritive, la gloire.
– Cela me semble utile ; acquiesça mon ami, mais il serait
juste que tu récupérasses un dixième de l'argent que tu as accordé à
tant de gens…
– À qui ?!
– Aux personnages de te romans. Par exemple à cette Augusta de la rue Arménia, dans ton
roman… Où se trouve le bonheur ?…
Quatre-vingts contos sous un planche ! Presque une banque ! Il ne
manquait que quatre pieds à cette planche pour soutenir tout-à-fait la
comparaison. Quatre-vingts contos !
– J'ai également appauvri beaucoup de personnages : l'un
compense l'autre.
– Toute cette galette, c'est toi qui l'as inventée ? Sache
donc que je connais une histoire où l'on voit apparaître beaucoup
d'argent sous une planche ; j'en possède une partie, comme tu pourras
tout de suite le constater. Regarde.
António Joaquim tira d'une sacoche d'argent deux doublons
portugais d'une valeur de quarante-huit mille réis.
– Tu en as trouvé beaucoup ? lui demandai-je.
– Ce n'est pas moi qui ai soulevé la planche. Je vais te
raconter cette histoire ; et, si tu en doutes, rends-toi à mon village,
et je te la prouverai avec le propre témoignage du détenteur de ce
trésor.
Il doit y avoir plus ou moins trente ans, un bon laboureur
de mes voisins, du nom de João do Cabo, a épousé Maria da Capela, une
jolie fille, selon ma mère, la plus riche des dix paroisses à l'entour.
Elle était orpheline quand elle se maria, contre la volonté de ses
oncles, qui avaient des boisseaux d'argent, d'après le peuple.
La jeune fille s'en fut chez son mari, en disposant des
biens de ses parents, mais maudite par ses oncles, qui ont résisté à
toutes les tentatives de mes parents pour les réconcilier avec leur
nièce.
João do Cabo était un stupide extravagant. Il se mit à
parier de l'argent à des jeux de hasard chez des prêtres, qui étaient
nos voisins ; il perdit et gagna de petites sommes ; il se laissa
prendre au vice, et la cagnotte eut vite fait de lui paraître
insignifiante, qu'il pouvait gagner chez les prêtres. Il allait jouer
toutes les semaines à Braga, et aux foires de l'année. Il perdit
beaucoup d'argent qu'il avait récupéré en hypothéquant ses biens. Mon
père lui consentait des prêts quand il ne savait pas encore à quoi
étaient employés ces emprunts répétés ; mais en se refusant à seconder
la ruine de João do Cabo, il n'obtint aucune amélioration, ni aucun
amendement dans la conduite du malheureux. Les confréries de Très Saint
Rosaire, et de bien d'autres choses fort saintes, confiaient de
l'argent au joueur, car ses membres avaient conscience du but pour
lequel ils lui faisaient des prêts.
La valeur de cette maison était si importante que João a
pris dix ans pour la dissiper. L'espoir qui le poussait à sacrifier ses
derniers contos de réis, c'était le capital accumulé par les oncles de
sa femme. Il comptait sur cet héritage qui lui permettrait de racheter
ses domaines. La rumeur courait, et il était de notoriété publique, que
l'or des prêtres, passé de main en main, d'un oncle venu du Brésil,
valait plus que les terres des deux paroisses les plus fertiles du
canton.
L'un des deux prêtres mourut, laissant par testament ses
biens à l'autre. La poitrine soulagée du laboureur se mit à respirer ;
il avait fait la moitié du chemin.
Le joueur avait fini de mettre à l'encan ses meilleurs
domaines, au bénéfice de la confrérie du Très Saint Rosaire, quand
l'autre oncle de Maria mourut brusquement.
L'on poussa des cris de joie dans la demeure de João. L'on
courut à la maison du défunt ; l'on abrégea les funérailles et
l'enterrement autant que possible, sans aucune considération pour la
paroisse ; et l'on s'empressa de fouiller les tiroirs, les bahuts, les
armoires, les sommiers, tout ce qui présenterait un volume assez grand
pour contenir quelques boisseaux d'argent. L'on ne trouva que quelques
douzaines de cruzados nouveaux dans une sacoche de lin.
João passa aux excavations dans les caves, les pressoirs,
les magasins ; ils creusèrent des trous dans les fondations de la
maison ; aucune trace des boisseaux d'or, pas même une livre pour payer
les dépenses qu'entraînaient ces explorations !
Les terrassiers renoncèrent, et João do Cabo se résigna à
récupérer la valeur du patrimoine des deux prêtres, évalués à deux
contos réis.
Il semble que sa malchance et son désespoir exaspéra son
vice pour pour le jeu. Le laboureur vendit un des patrimoines, et
déversa le produit de la vente dans ce tourbillon ; il vendit la bonne
maison où il vivait ; il vendit l'autre patrimoine, il vendit tout en
l'espace de cinq ans, ne gardant pour lui qu'une masure dans l'aire, où
ses parents faisaient entreposer les fruits sur de la paille. C'est mon
père qui a mis à l'encan toutes les propriétés de João do Cabo, et lui
a conseillé de garder l'entrepôt de fruits pour avoir une chaumière qui
l'abriterait de l'hiver, ainsi que sa femme et les six enfants qu'il
avait.
João do Cabo finit par être réduit, avant d'avoir atteint
la quarantaine, à une extrême pauvreté. Mon père se chargea de procurer
des moyens d'existence à ses enfants, qui étaient tous par bonheur du
sexe masculin. Il envoya les plus âgés au Brésil, il plaça les autres,
en tant que commis, dans des boutiques de Braga et de Porto. Maria fut
reçue chez nous, et employée comme domestique ; mais ma mère, qui la
tutoyait, ne lui confiait aucune tâche. Elle pleurait avec la pauvre
femme, et lui apprenait à attendre les richesses du Ciel.
Tout le monde racontait que João do Cabo se serait laissé
mourir de faim, s'il n'y avait eu personne pour lui tendre un bol de
bouillon. Tout le monde se trompait. Mon père l'aurait assis à sa
table, s'il l'avait voulu : il refusa cette aumône, sans aucun orgueil,
en disant qu'il pouvait encore travailler et qu'il lui fallait faire
pénitence.
Les mains du malheureux étaient aussi délicates que les
nôtres : elles ignoraient la dureté du manche d'une houe. Il voulut à
plusieurs reprises défricher les broussailles, et lâcha son outil,
parce que ses mains perdaient leur peau. La populace grossière et
méchante des villages se moquait de lui. Les journaliers qui le
voyaient, à côté d'eux, gémissant à chaque faible coup de houe qu'il
donnait à la racine d'une cytise, le regardaient de travers, ils
exultaient de voir ramené à leur niveau le riche d'une autre époque,
qui jetait dans leur chapeau le salaire de chaque semaine en les
traitant de fainéants.
Ce rire insultant c'était le vinaigre avec lequel on
épongeait la plaie du malheureux. Il songea à se dérober à la vue de
ces gens-là ; se cacher pour travailler là où n'arriverait pas la
lumière du soleil.
– Je ne vois pas comment il y serait arrivé !… fis-je
remarquer.
– Il est étonnant que tu ne le voies pas, tu es un
romancier ! fit observer António Joaquim. Il devint mineur. Tu as là un
fort simple expédient. Il se cacha de la lumière du soleil en
travaillant dans les mines qui appartenaient à mon père, des mines de
propriétés qu'il avait. C'était une vraie pénitence ! Même aux heures
de repas, il ne voulait pas sortir à l'air libre. Il venait à l'entrée
de la mine chercher sa corbeille ; il mangeait à la clarté de quelque
"soupirail" par lequel on déversait le gravier, et retournait
travailler jusqu'à ce que l'extérieur fût plus obscur que les ténèbres
qui régnaient à l'intérieur.
Au bout de trois années de ce dur labeur, ses cheveux
blanchirent, il eut les reins cassés, les traits altérés, cela faisait
pitié de le voir ! Mon père eut beau dire et faire, il n'y eut pas
moyen de le tirer des mines, ni de changer ses vêtements, avant qu'ils
ne partent en lambeaux, pourris par l'humidité des galeries
souterraines. Les jours sanctifiés, sa femme allait dîner avec lui dans
la "maison aux fruits". Ils se repaissaient tous les deux de leurs
larmes. Maria lui tenait le langage religieux de ma mère ; elle
l'exhortait à la patience, et à faire confiance au repos qu'il
trouverait dans sa patrie céleste. Son mari l'écoutait en silence, ou
lui disait : "Comment veux-tu que je montre plus de patience, Maria ?!"
Au cours de l'hiver 1853, João do Cabo fut saisi de
fièvres, et tomba sur son lit, quand il n'en put mais. Sa femme lui
apportait de quoi se nourrir dans la masure, et revenait chez nous au
crépuscule. Ma mère l'obligea à passer la nuit auprès de son mari et
lui fit installer une banquette.
L'une de ces nuits, João qui grelottait de froid demanda à
Maria de lui faire une bonne flambée.
– Il n'y a pas de bois ici, dit-elle, mais je vais dehors
récupérer quelques triques.
– Je ne veux pas d'une flambée de triques, répondit João,
fais-moi des fagots avec n'importe quoi.
– Avec quoi ? Que Dieu me vienne en aide, je ne sais pas
avec quoi je pourrai faire des fagots.
João sauta sur la plancher en claquant des dents, et dit :
– Apporte ici la chandelle, Maria, et cette petite houe.
Sa femme s'approcha avec la houe.
– Que vas-tu faire ? demanda-t-elle.
– Arracher une planche.
– Que le Seigneur te vienne en aide ! fit-elle. Si tu
enlèves le plancher, l'humidité de la terre va te faire du mal, João !
– Laisse-moi. Je mourrai aussi bien comme ça que grillé.
Il tira de toutes ses forces le grabat en cerisier, où il
avait sa couchette, et choisit la plus vermoulue des lattes du
plancher, et glissa le tranchant de sa houe entre les joints, la
souleva, et coinça dessous le fer de son outil. Puis, s'en servant
comme levier, il fit pression sur la latte au point de la fendre par le
milieu, parce que les clous solides, à l'autre bout, ne cédèrent pas à
ses efforts. João introduisit ses doigts dans l'orifice pour enlever le
reste de la latte, et ressentit, sur leur épiderme, une extraordinaire
impression de froid. Il tâtonna sans savoir de quoi il s'agissait, et
tomba sur un objet lisse et poli comme du fer-blanc. Il retira sa main
: il fixa sa femme de ses yeux spasmodiques, sans prononcer un seul mot.
– Qu'est-ce que c'est ?! demanda-t-elle au bout de
quelques secondes.
– Ô femme ! balbutia João avec un geste de fou.
– Qu'as-tu, João ?…
– Et si c'était ça ! s'exclama-t-il.
– Ça quoi ?! répondit Maria, sans vouloir l'entende. Tu es
fou, mon homme ?! Si c'était quoi ?
– L'argent !… L'argent !…
– Mais qu'est-ce que tu vois ?!
– Je ne sais pas, je ne sais pas… Laisse-moi reprendre mon
souffle… Je n'ai plus froid… Je suis brûlant… Demande à notre Seigneur
que ce ne soit pas une illusion, Maria ! Prie, prie, la pénitence que
je m'inflige depuis quatre ans mérite que Dieu nous prenne en pitié !…
Maria accrocha le crochet de la chandelle au montant de la
couchette, et se mit à genoux pour prier, les mains levées.
Entre temps João frappa la terre aplanie sous la latte de
la pointe de sa houe, et en tira un son métallique.
– Ô Seigneur Jésus du Mont ! s'exclama-t-il, tandis que
Maria invoquait le Vierge Mère de Jésus.
Le fer tomba de la main de son mari, ses lèvres se
dilatèrent, esquissant un rire grimaçant d'aliéné. Il mit d'abord les
mains sur la poitrine ; puis il embrassa sa femme, baignée de larmes ;
enfin, tout son corps pris d'une convulsion, il reprit son outil en
main et lui
dit :
– Aide-moi… J'ai peur de mourir de joie !
Les clous sautèrent. Maria tira sur la latte dont elle
arracha les morceaux avec la force de trois hommes. João écarta la
légère couche de terre qui recouvrait deux caissons de fer-blanc qu'il
s'efforça d'extraire, après avoir creusé avec ses ongles la terre tout
autour. Comme chacun était d'une longueur de deux empans, sur une
hauteur et une largeur d'un empan, les bras du malade n'arrivaient pas
à soulever le poids imposant des caisses, Maria se mit en face de lui
pour l'aider. Quand ils eurent tiré le second, ils virent une petite
boîte de fer-blanc pendant à un anneau du caisson, par une chaîne
métallique. Ils ouvrirent la petite boîte et trouvèrent deux clés. Ils
voulurent s'en servir pour ouvrir les caissons ; mais les cadenas
étaient rouillés, et les pènes des serrures ne coulissaient pas. João
brisa les languettes avec une tarière. Il ouvrit le premier caisson, et
vit quelques sacs en peau de tapir. Il en tira un, et détacha les
courroies de cuir tressé ; et il vit des pièces d'or. Il déposa ce sac
sur les autres, et se mit à lancer à grands cris une délirante
apostrophe à la Divine Providence.
Ma mère était encore debout, avec les servantes au foyer.
Elle tendit l'oreille et dit, tout émue :
– J'entends crier João ! Allez voir ce qui se passe !
Les filles eurent peur et n'y allèrent pas ; parce que le
peuple, ce romancier échevelé, avait imaginé que les âmes en peine des
prêtres, des oncles de Maria, rôdaient autour de la maison. Ma mère
alla appeler mon père au lit, lui raconta qu'elle entendait des cris,
et l'engagea tendrement à venir avec elle.
Les deux vieillards frappèrent à la porte de la cabane aux
fruits, tandis que João aspergeait d'eau le visage de Maria, qui avait
perdu connaissance. Ma mère leur parla de l'extérieur. On alla lui
ouvrir la porte.
– Qu'avez-vous ? demanda-t-elle, voyant sa pauvre Maria
assise par terre, appuyée aux pieds de la couchette.
– Nous avons… nous avons… bafouilla João.
– Qu'est-ce qui se passe ?! demanda mon père.
– Nous avons là deux caissons pleins d'or ! s'exclama le
mineur.
– As-tu perdu la tête, João ?! cria mon père
– Grâce à Dieu, pas du tout ! Regardez ! Regardez !
Les deux vieillards virent, à côté de la fosse ouverte
deux caissons de fer-blanc.
Quand Maria retrouva ses esprits, elle était dans les bras
de ma mère.
João do Cabo ne ressentit plus ni froid, ni chaleur,
durant l'heure qui suivit, c'était la température du paradis qui lui
régalait les poumons.
Mon honorable père toucha la valeur de toutes les
propriétés qu'il lui avait achetées, et les lui rendit sans rien
demander pour les travaux d'amélioration. Les deux doublons que je t'ai
montrés sont les restes de soixante mille cruzados, ou plus. Avec le
trésor qu'il avait trouvé, ses biens une fois restaurés, il put en
acquérir d'autres de même prix.
João fit venir ses six enfants chez lui : il en a trois
qui vont prononcer leurs vœux ; un à Coimbra ; et deux qui travaillent
aux champs.
C'est le plus heureux des pères et le meilleur des hommes.
De temps en temps, il réunit ses fils, pénètre avec eux
dans l'une des mines où il a travaillé, et leur fait mesurer l'étendue
et l'intensité des angoisses qui l'y ont fait blanchir les cheveux. Il
conclut toujours son récit par ces mots :
– Maudit soir, mes enfants, celui d'entre vous qui jouera !
IV
LA FABRICANTE DE CHAPELETS
Pourquoi n'en tires-tu pas un volume ? me demanda António
Joaquim.
– Je vais voir si j'en tire six, mon ami. Auras-tu
beaucoup d'histoires
à me raconter ? Écoute, fils. Ah ! Si je pouvais trouver dans
cette litière assez de squelettes pour les cent livres que je compte
écrire en dix ans !
– Vous traitez donc de squelettes
les histoires que vous
récupérez en tendant l'oreille ? L'expression est plutôt pertinente,
vue la maigreur des livres que vous faites !… Quelles histoires veux-tu
? Des histoires d'argent ?
– Et sans argent ; elles sont toutes bonnes.
– En veux-tu une qui s'est passée il y a trois mois dans
mon district ? Si tu en doutes, va vérifier sur place.
– Je te crois, mon vieux ; et si ce n'était pas le cas, je
n'irais pas non plus me renseigner. Je te dispense de me fournir des
preuves que les lecteurs ne me demande pas.
– Voici l'histoire :
Au temps de l'invasion française, il y
avait, dans ma région, une jeune fille de dix-sept ans, la fille d'une
femme qui fabriquait des rosaires en os d'une telle perfection et d'un
tel éclat que, même aujourd'hui, on dirait de l'ivoire, ils surpassent
en finesse les plus beaux que l'on achète à Rome. Rosalinda, la fille
de la fabricante de chapelets, montra plus d'imagination que sa mère
dans leur confection : elle taillait des croix, les fleurissait,
façonnait des piédestaux, elle parvint même à sculpter de toutes
petites images, sinon correctes, fort admirables dans la proportion des
formes.
Outre qu'il s'exerçait à l'intérieur, qu'il était propre,
et bien utile aux âmes, ce métier s'avérait fort rentable, vu le coût
modeste de la matière première, nonobstant la concurrence des
couteliers de Guimarães dans l'achat des os dont ils faisaient des
manches pour leurs outils qui ont à présent perdu le plus clair de leur
valeur.
Les fabricantes de chapelets menaient une vie aussi aisée
que joyeuse, elles pouvaient puiser dans leur tirelire en cas de
besoin, elles étaient mises comme aucune des cultivatrices les plus
cossues.
Pour ce qui est de ses habitudes, les filles les plus
honnêtes et les plus scrupuleuses avaient bien des choses à apprendre
de Rosalinda. Ses principales préoccupations, c'était le culte divin,
sa mère, et le travail. À l'église, elle se distinguait par son
attitude révérencieuse ; et aussi, parce qu'elle assistait à la messe
avec son livre. Parmi les filles de sa génération, elle seule était
parvenue à apprendre à lire, quand l'abbé ouvrit une école gratuite
pour les deux sexes. S'agissant du mariage, on lui proposa quelques
jeunes artisans, comme des maçons, des tisserands, des charpentiers ;
mais Rosalinda déçut leurs espoirs, en alléguant qu'elle était encore
bien jeune. Cependant, les vieilles, qui étaient des gamines en ce
temps-là, disaient que l'orgueil de la fabricante de chapelets visait
bien plus haut, et fredonnait cette chanson populaire :
Celui que je veux ne me veut pas
Celui qui me veut, je m'en moque.
Ces deux vers entamaient quelque peu son crédit dans
l'esprit de ses prétendants ; mais, selon les personnes moins éprises,
vu qu'elle portait plutôt son choix sur les aînés des principales
maisons, Rosalinda avait parfaitement le droit d'être folle sans être
déshonnête.
En ce temps-là, un officier de l'armée française commandée
par Loison, pris sous le feu des guérillas, s'écarta de son détachement
et tomba, blessé, dans un bois près de la maison des fabricantes de
chapelets ; il se cacha dans un buisson de genêts pour fuir la fureur
carnassière du peuple.
Rosalinda avait vu du vasistas de sa chambre le combat
entre les Français et la guérilla, et l'arrivée de l'officier dans le
bois. Dès la tombée de la nuit, quand sa mère fut sortie prendre des
nouvelles, elle s'approcha des genêts, et vit des gouttes de sang. Elle
les suivit à la trace, et tomba sur un aimable Français prostré, qui
n'arrivait pas à respirer, et blessé au front. Elle osa s'agenouiller
convulsivement auprès du bel agonisant, et appuyer légèrement sa main
au bras qu'il avait sur la poitrine. Le Français, à ce que je crois,
ouvrit les yeux, vit la svelte paysanne, et se souvint du héros de lord
Byron, cet éternel Don Juan, lequel, rejeté sur la plage par les vagues
qui n'avaient pu le dévorer impitoyablement, ouvre ses yeux mourants et
voit le jolie fille du pirate.
Le Français demanda de l'eau. Si un jour tu fais imprimer
ce conte, tu pourras dire que le jeune officier lui demanda son cœur,
en élevant la voix comme qui jouit d'une parfaite santé ; dis ce qui
t'arrangera ; mais, pour être tout à fait exact, il a demandé de l'eau
; après avoir bu de l'eau excellente de notre Minho, il retrouva des
couleurs, et demanda un bout de pain. Comme si l'amour lui donnait à
cet instant la science infuse des langues étrangères, la jeune fille
comprit qu'il voulait manger.
Elle retourna chez elle, et lui apporta quelques œufs durs
et un bol de lait de vache. Le Français joignit ses mains en
signe de reconnaissance, tira de la poche intérieure de son uniforme
quelques pièces d'or, qu'il offrit à sa bienfaitrice. Rosalinda refusa
d'une façon véhémente en faisant de grands gestes, et lui dit, à sa
façon, de rester là ; elle retourna chez elle raconter à sa mère ce qui
lui était arrivé, et lui demander, baignée de larmes, de l'accompagner
dans le bois.
Elles s'y rendirent et, peu après, appuyé sur leurs
épaules, par nuit noire, le Français fut recueilli dans la chaumine
propre et gaie des fabricantes de chapelets.
La pièce, à l'intérieur, où elles travaillaient, devint
leur alcôve, et leur chambre, plus en retrait et assombrie par des
chênes, celle du malade.
Le Français leur apprit à renouveler le pansement qu'il
avait à la tête à la suite d'un coup de faucille, et à soigner sa jambe
meurtrie par une pierre. La blessure à la tête cicatrisa rapidement ;
mais l'os du tibia fracturé mit du temps à se ressouder. Il y avait
plus d'un mois que l'officier était hébergé chez ces aimables créatures
qui passaient la nuit à son chevet. Après ce bref espace de temps,
Rosalinda savait ce qui pouvait s'avérer, en français, le plus utile
pour gouverner une maison. L'officier lui donnait des leçons, en
désignant et nommant, une à une, les choses qui l'entouraient, et, à
partir de celles-ci, il en induisait d'autres, invisibles, en recourant
à un système si ingénieux que Rosalinda, avec le soutien de son cœur,
mit au point un jargon beaucoup plus français que celui des jeunes
filles sorties de nos collèges, et moins proche du patois que celui de
certains traducteurs de romans.
J'admets que Rosalinda, et ce particulier dont nous
pouvons omettre le nom ont été capables d'inventer une langue à leur
usage pour s'entendre. Et toi ?
– Je l'admets, moi aussi, ai-je répondu avec la gravité
que requérait philologiquement cette question. Je crois que la première
forme de langage est née avec le premier colloque amoureux entre une
femme et un homme. Traitons cet important problème des langues, si cela
te convient. Commençons par le paradis terrestre, si tu ne veux pas
remonter plus loin.
– Mais, si cela te va, objecta António Joaquim, finissons
cette histoire, nous aborderons ensuite cette question…
– Parce que cette histoire a une fin ?!
– Elle ne fait que commencer.
– Tant mieux ! J'allais te dire qu'il n'y avait pas un
chapitre à tirer de ta Rosalinda…
– La mienne ?! Celle du Français, si tu veux bien.
– Ils se sont donc aimés ?
– Et ils se sont enfuis, dès qu'il eut soigné sa jambe et
sa tête.
– Il a bien payé l'hospitalité de la vieille fabricante de
chapelets, qui naturellement en fut si affectée qu'elle mourut de honte
et de chagrin.
– Elle n'est pas morte. Elle a continué à travailler à ses
rosaires. Quand on lui demandait des nouvelles de Rosalinda, elle
répondait : "Je n'en sais rien." La disparition de la jeune fille, et
la sérénité de la vieille excitèrent la curiosité. J'ignore quel
fonctionnaire de justice s'est arrogé le droit d'interroger la
fabricante de chapelets sur ce qu'était devenue sa fille. On
l'intimida, et elle avoua que sa Rosalinda était partie épouser en
France un soldat de l'armée française, avec son consentement.
Dès que cela fut divulgué, la population de trois
paroisses voulut aller brûler la maison de la vieille, et venger la
nation en rôtissant la jacobine qui avait donné sa fille à un
hérétique, alors que le patriotisme lui commandait d'achever le
moribond dans le bois où elle l'avait trouvé. C'est mon père qui retint
le bras de la fureur populaire.
À partir de ce moment, la mère de Rosalinda vécut comme
une lépreuse, ou une excommuniée dans sa paroisse. Personne ne lui
vendait d'os, ni ne lui achetait de rosaires Les bigotes ont cessé de
prier avec de chapelets qu'elle aurait fabriqués. La pauvre femme
changea de région ; je crois qu'elle se rendit à Porto, et qu'au bout
d'un certain temps, elle partit pour la France, où l'appelait sa fille.
Ayant appris qu'elle s'était enfuie, le peuple ne se dispensa pas de
réduire en cendres sa maison, et d'asperger ces cendres d'eau bénite,
sans oublier de se livrer à d'autres exorcisme. J'ai entendu des
vieillards raconter qu'aux alentours de la maison rasée, cela puait le
souffre à plein nez, un signe évident qu'une légion de démons avait
bourgeonné en ces lieux.
Au bout de quelques années, le souffle de la civilisation
dispersa les miasmes sulfureux. Peu de gens parlaient des fugitives ;
et si la nouvelle génération les mentionnait, c'était sans haine, et
peut-être avec une ombre de poésie romantique. Au moins moi, quand
j'étais jeune homme, j'allais m'asseoir sur les décombres de la maison
des fabricantes de chapelets, et je rêvais de Rosalinda et du Français.
Je m'imaginais sa chambre, avec la vitre à travers laquelle elle avait
vu entrer le blessé dans le buisson de genêts ; j'allais au bois
chercher l'endroit où elle l'avait peut-être trouvé ; je m'arrêtais
près de la porte par où ils étaient entrés dans la maison qui leur
offrait son abri. Je composais mon roman avec une touche de couleur
locale, et m'abandonnais à mes émotions ; je faisais part de ces
réflexions à ma mère, qui avait connu Rosalinda, et lui demandais de me
la décrire pour la centième fois.
Je voulais que l'on cherchât à savoir si elle était encore
vivante. C'est devant mon abbé que j'épanchais ces désirs puérils. Le
prêtre me demandait si je voulais aller en France châtier le ravisseur
de notre belle compatriote ; et parmi ces balivernes et d'autres
du même tabac, il me promettait d'écrire au roi Louis-Philippe,
conformément à mes exigences, une lettre, à laquelle le monarque ne
manquerait pas de répondre minutieusement.
J'avais atteint l'âge de vingt ans quand mon abbé me dit
qu'une personne lui avait demandé à Porto s'il se souvenait avoir
connu, dans la paroisse de ***, une Rosalinda qui s'était enfuie avec
un officier français. Et il ajouta que le Français l'avait épousée,
qu'il était général, que son informateur les avait tous les deux vus à
Baden Baden, où ils prenaient les eaux, et qu'il avait parlé en
portugais avec Rosalinda, qui était devenue une vieille.
Je t'avouerai que le roman de mon enfance s'effrita
quelque peu à cette nouvelle. La poésie s'accorde mal avec des tableaux
respirant le bonheur. Ce qu'elle veut, ce sont des scènes où l'on verse
force larmes. Une fille du ciel, il semble qu'elle ne soit descendue
sur terre que pour pleurer. C'est comme ces fleurs qui se ferment aux
plus fortes chaleurs du soleil, et s'ouvrent dans la mélancolique
obscurité de la nuit.
– Le dissolvant de ta poésie, ai-je fait observer, c'est
que l'on t'a dit que cette femme avait vieilli, mon cher António
Joaquim !…
– Peut-être… Au bout de dix ans, est arrivée à Braga une
dame âgée, portant le deuil, avec deux domestiques ; elle a loué une
maison modeste dans les faubourgs de la ville. Au printemps de cette
année 1850, cette dame, que ses servantes appelaient simplement madame,
a visité le Minho en litière, et s'est retrouvée dans ma paroisse. Elle
a dit que l'endroit lui plaisait beaucoup, et manifesté le désir de s'y
arrêter quelques jours, ce qu'elle ferait, si elle trouvait une maison
à louer. Mon père avait une maison de métayer vide, il la lui céda
gratuitement.
Cette dame — dont tu as déjà deviné qu'il s'agissait de
Rosalinda — accepta, en exprimant brièvement sa gratitude, la maison
qu'on lui offrirait, et se fit apporter de Braga son bagage, qui
consistait en quelques malles.
Elle sortait l'après-midi, de loin en loin, avec une
servante ou seule. Elle parcourait la courte distance qui la séparait
des ruines de la demeure des fabricantes de chapelets ; mais, si on la
voyait, elle se retirait pour ne pas attirer les yeux de la stupide
curiosité des cultivateurs. Mon père et moi, en compagnie de ma mère et
de ma femme, nous sommes allés lui rendre visite. Elle nous a reçus
avec un air qui respirait la politesse des palais. Elle ne nous a rien
dit de sa vie, nous ne lui avons rien demandé. L'on se sentait gêné en
la présence de cette splendide vieille qui montrait une telle prestance
et une telle grâce en s'asseyant, qu'elle semblait nous dire que nous
ne savions pas nous asseoir. Au moment de prendre congé, madame offrit
à ma mère un très précieux livre de prières, et à ma femme une broche
en or avec un camée d'une extrême pureté.
Elle a attendu quelques jours pour nous rendre notre
visite alors que nous n'y comptions plus. Ne trouvant aucun sujet de
conversation, ma mère évoqua les ruines de la maison des fabricantes de
chapelets. Elle écouta cette histoire sans rien dire, jusqu'à ce que ma
mère lui dît que son beau-père avait évité à la mère de Rosalinda de se
faire brûler par le peuple. Madame fit une grimace de dégoût, et dit :
– Encore heureux qu'il y ait eu un homme parmi les bêtes
sauvages.
Ma mère continua son récit, jusqu'à l'incendie de la
maison, et les superstitions du peuple au sujet du souffre et du démon.
Madame éclata de rire, et fit observer que le peuple nous
invitait à ne pas croire au démon ; et qu'il fallait beaucoup de foi
pour ne pas cesser de croire en Dieu, si la voix de Dieu est celle du
peuple, comme l'affirmait un proverbe blasphématoire.
La conversation allait s'achever sur cette sentencieuse
réflexion. Tout à coup, cette dame demanda à ma mère si elle avait
connu la fameuse fabricante de chapelets.
– Fort bien. J'ai soixante ans, et elle avait trois ans de
moins que moi. Nous sommes allées toutes les deux à l'école de monsieur
l'abbé ; mais il n'y a qu'elle qui ait appris à lire. Elle était fort
jolie, elle avait un air de citadine, et des expressions très douces.
Elle devait avoir à peu près votre âge. Grâce à Dieu, le Français l'a
épousée ; mais moi, continua ma mère avec la pardonnable ignorance de
sa vertu, je pense que les mariages, là-bas en France, ne sont pas
conformes aux principes de notre religion, et, si c'est le cas, ils ne
valent rien aux yeux de Dieu.
– Je crois que si, madame, répondit la dame, avec un
sourire affable. Le Dieu des Français est, selon moi, le Dieu de tout
le monde.
– Vous avez été en France ? demanda ma mère.
– Durant bien des années, madame. Et j'y ai rencontré
beaucoup de gens mariés qui vivaient en parfaite harmonie avec les
préceptes de notre sainte religion.
L'on se rendait compte que beaucoup d'autres questions
étaient restées bloquées dans la gorge de ma mère ; cependant cette
dame laconique se leva pour prendre congé. Ma mère lui montra alors un
rosaire en lui disant :
– Permettez-moi de vous offrir le plus beau rosaire que
j'ai, parmi ceux qu'a fabriqués Rosalinda.
La dame l'accepta, l'admira avec une émotion visible, et
la remercia en ces termes :
– Je vous suis bien reconnaissante de ce cadeau.
Après s'être un moment absorbée dans une profonde
réflexion, elle ajouta :
– Qui sait si la Rosalinda qui a fabriqué ces chapelets,
aura honte aujourd'hui d'avoir fait de ses mains un aussi bel ouvrage ?!
– C'est vrai ! dit ma mère.
V
Si j'écrivais ce roman, continua António Joaquim, je
garderais pour la
fin la surprise que je réserve au lecteur, en lui cachant l'identité de
cette étrangère. Mais comme, en bavardant avec toi, je ne ménage pas
mes effets, j'ai dédaigné le principal ressort de ce procédé.
– Et tu as bien fait, dis-je, parce que le principal
ressort des romans pleins d'invention finit par lâcher à force d'être
utilisé par les dramaturges et les romanciers. Certains croient étonner
le lecteur, et mettent en œuvre toute leur habileté à déformer la suite
naturelle des événements pour s'abandonner à la vanité de le
désarçonner. Or c'est le lecteur, à qui les romans ne sont pas
étrangers, qui est fort capable de surprendre l'auteur, en venant
souffler à l'oreille des personnages encapuchonnés jusqu'aux yeux qui
ils sont et d'où ils viennent, où ils vont, et le destin que l'auteur
leur prépare. Avec des lecteurs aussi prévenus, il est plus sûr et plus
modeste de se montrer sincère. Pas de leurres inutiles et ridicules à
leur crédulité, ce qui revient à les offenser et à les humilier. Si tu
écrivais le roman de Rosalinda, tu pourrais la cacher humblement
derrière cette vieille dame, tout le monde s'apprêterait à recevoir en
souriant cette nouvelle imprévue. Mets à ton débit, à charge de
revanche, cet avertissement, au cas, fort probable, où tu écrirais des
romans.
– Moi ?! fit António Joaquim. Moi, écrire des romans !…
– Qui sait ? J'ai bien le pressentiment que je finirai
laboureur, tu peux avoir celui que tu finiras romancier.
– Pas du tout, je ne l'ai pas le moins du monde.
– Tant mieux, mon ami. Cherche toujours à être utile à
quelque chose, et ne cesse d'occuper ton esprit à quelque branche de
ton travail ; parce qu'au moment où l'oisiveté te rendra inutile, tu
deviendras en écrivain affable, si tu ne deviens pas un écrivain
féroce. J'ai payé tes conseils de la même monnaie, qui est la moins
chère ; maintenant, si tu veux bien, revenons à l'histoire de
Rosalinda. Nous en sommes restés au moment où elle est sortie de chez
toi avec le rosaire que lui a offert ta mère.
– Elle a demandé un jour à mon père, poursuivit António
Joaquim, si un laboureur consentirait à lui vendre un terrain
pour y construire une maison avec un jardin, le tout d'une petite
dimension, à la façon des chalets
dans les montagnes suisses. Mon père
ne savait pas ce qu'étaient ces chalets
; mais il lui offrit un bout de
prairie gazonnée, ombragée par des marronniers. Madame exprima le désir
d'acquérir le terrain où se trouvait la maison des fabricantes de
chapelets, qu'elle en construirait une à cet endroit, les chênaies tout
autour lui plaisaient vraiment. Mon père répondit que le terrain était
disponible parce que sa propriétaire, si elle était encore vivante, ne
s'en souvenait sûrement plus, et qu'il n'y avait aucun parent qui pût
le réclamer. Elle précisa que la propriétaire ou les héritiers de cette
brousse pouvaient se présenter, ils seraient remboursés comme il faut
au triple de sa valeur.
Tout le monde fut étonné de la bizarrerie de cette dame,
et de la rapidité à laquelle, sur les ruines, s'éleva le plus gracieux
des cottages, sur le modèle
de celui qu'un Anglais avait fait récemment
construire à Vizela. On fut encore plus effaré de la voir passer
l'hiver dans le domaine de mes parents, en attendant la fin des
travaux, menés par les meilleurs maîtres artisans.
Nous sommes allés lui rendre visite chez elle au cours de
l'été 1851, nous avons apprécié la charmante nouveauté du mobilier de papier mâché, léger comme la
décoration d'une grotte de fées, dont le
toit serait fait de fleurs, et les murs des labyrinthes de plantes
grimpantes. Dans son cabinet, entre deux armoires de palissandre, d'une
facture répondant au goût ancien, nous avons vu un portrait en pied,
voilé d'un tissu obscur et transparent, à travers lequel on distinguait
les couleurs vives d'un uniforme couvert de médailles et de rubans,
avec, pendant à sa main droite, un bicorne emplumé.
Ma mère demanda si c'était le portrait de Dom Miguel, ou
de Dom Pedro, en souhaitant que ce fût plutôt le portrait du premier de
ces deux princes, elle pourrait prier silencieusement pour son salut.
La dame répondit que c'était le portrait de la seule
personne qu'elle eût aimé sur la terre, et qu'elle l'aimait encore au
ciel. Cela dit, un tel torrent de larmes jaillit de ses yeux que nous
en fûmes tous émus.
La mystérieuse dame obtint en 1853 l'autorisation de
construire un cimetière commun dans notre circonscription. L'assemblée
de la paroisse lui céda un terrain, et elle prit à sa charge tous les
travaux de nivellement, les fosses, la construction des murs et de la
chapelle. Elle fit aménager une sépulture modeste, avec une grille de
fer, sans inscription.
Au bout de quelques mois, est arrivé à Braga un cercueil
en plomb, avec des ossements, il s'est rendu, de là, à ma paroisse,
avec son cortège, avant d'être déposé dans la sépulture que Rosalinda
avait fait construire. L'on sut que c'étaient les restes de la mère de
cette dame, et rien de plus ; mais, au bout de quelques jours, sont
apparues ces lettres en fer sur la dalle de la sépulture :
CI GÎT MARIA GOMES,
NÉE
DANS CETTE PAROISSE EN 1760, ET DÉCÉDÉE
À PARIS EN 1820.
SA FILLE ROSALINDA
A FAIT ÉRIGER
CETTE CROIX SUR SA DALLE
EN 1853
Après avoir lu cela, mon père s'en fut, hors d'haleine,
raconter à la famille ce qu'il avait vu. Sans se soucier des vêtements
qu'elle prenait pour aller visiter cette dame, ma mère courut chez
Rosalinda, et se précipita dedans, comme du temps où elle venait
l'appeler pour aller avec elle à l'école.
Rosalinda la prit dans ses bras, la serra sur sa poitrine,
pleura de saudade et de joie, ressortant les mêmes expressions amicales
que dans leur enfance, elle était devenue une tout autre femme, posant
des questions sur tout et toutes les personnes décédées durant les
quarante dernières années.
Puis, nous y sommes tous allés ; et moi, je lui ai
raconté, en prenant ma mère à témoin, les romans que j'avais élaborés,
à son propos, sur les ruines de sa maison, qui fouettaient mon
imagination.
Rosalinda nous a fait un récit détaillé de sa vie. Dès
qu'il eut foulé le sol de la France, l'officier français l'épousa. Il
l'aima trente-deux ans autant qu'aux premiers quinze jours de leurs
fiançailles. Il l'amena avec lui à toutes les titanesques batailles de
Napoléon, en disant que, s'il devait être mortellement blessé, il
voulait mourir dans les bras de la femme qui lui avait offert sa vie,
qu'elle sacrifiait dans le plus ignoble des combats de sa carrière
pleine de triomphes. Ce brave était parvenu au grade de général, il
était mort en léguant à sa veuve d'abondantes ressources qu'il tenait
de ses parents.
La population de la paroisse s'arrêtait, autour de cette
luxueuse demeure, pour contempler la richesse de la fidalga, que
beaucoup de gens de son âge avaient connue quand elle polissait des
chapelets en os.
Cette admiration généra l'envie, et l'envie trouva un
exutoire dans la médisance.
Les bigotes et les patriotes disaient que la fortune de
Rosalinda, le Français l'avait volée au Portugal.
Certains affirmaient que c'était précisément lui qui avait
spolié, dans une église voisine, une demi-douzaine de saints de leurs
splendides ornements, lesquels devaient valoir vingt pintos [4] bien
pesés ; les sycophantes en sabots estimaient que la richesse de
Rosalinda provenait des ornements des saints. J'ai souvent surpris la
canaille qui se livrait à ces estimations, et résolu sommairement le
problème à coups de gourdin. J'ai cassé les têtes qui avaient été à
l'origine de ces estimations, et la médisance se fit une raison,
après cette saignée pratiquée sur ses intumescences de jalousie insane.
En 1855, j'ai reçu chez moi un excellent garçon à qui la
Régénération avait fait perdre son emploi parce qu'il était parti
défendre le gouvernement du comte de Tomar[5]. João Carlos avait
beaucoup d'instruction, et parlait couramment français. Rosalinda
prenait plaisir à se rappeler l'idiome de son mari en discutant de
littérature avec mon ami.
Par moi, pas par lui, cette dame connaissait la mauvaise
situation de João Carlos. Elle m'a consulté sur la façon dont elle
pouvait lui être utile sans le blesser. Je n'ai pu la conseiller, parce
que je connaissais l'excessive susceptibilité de mon ami.
Sur les instances répétées de ma mère, João Carlos resta
encore un an avec nous, où il enseignait, pour passer le temps, à mes
enfants le portugais, et, à moi, le français, que j'arrivais à peine à
traduire.
Dona Rosalinda lui demanda, l'année suivante, s'il voulait
bien aller à Paris vendre des valeurs bancaires qu'elle voulait
réaliser, et mener à bout des liquidations que son mari avait laissées
inachevées.
João Carlos se rendit à Paris où il resta six mois, comme
l'y obligeait sa commettante, qui le forçait à attendre la conclusion
de ses affaires qui rencontraient bien des obstacles.
Au retour de mon hôte, Rosalinda était malade, et
présentait des signes inquiétants. Il lui rendit compte de la mission,
qu'il avait remplie avec autant d'honnêteté que d'habileté. La dame
prit la moitié des sommes réalisées, et lui céda l'autre comme salaire,
et un précieux brillant pour le remercier.
– Est-ce pour me faire l'aumône, que vous me le donnez ?
demanda João Carlos, les yeux salés par des larmes de reconnaissance.
– Mon aumône, répondit Rosalinda en souriant, ce
sera ce rosaire que j'ai fait quand j'avais quinze ans.
C'était le rosaire que ma mère lui avait donné.
João Carlos lui baisa les mains.
Quelques jours après, mon ami a retrouvé son emploi, sans
l'avoir sollicité.
En apprenant qu'il partait pour Lisbonne, Rosalinda
l'appela à son chevet et lui dit :
– Je n'ai pas encore cassé la procuration que je vous ai
dressée, Monsieur João Carlos. J'ai besoin de vos services pour un
certain temps. J'ai vingt dots de deux cent mille réis pour vingt
jeunes filles sans fortune de cette paroisse. Je veux que vous vous
chargiez de rédiger les actes, de leur faire ces donations en mon nom,
et de remettre cette somme aux bénéficiaires. Je veux également donner
cent mille réis à chaque homme de plus de cinquante ans de cette
paroisse, parce que je pense que tous les hommes de plus de cinquante
ans se sont conjurés, il y en quarante, pour brûler ma maison. J'ai
besoin de me venger chrétiennement de ces patriotes, qui ont voulu
offrir ma mère grillée aux divinités portugaises de la patrie. Comme
ces gens-là sont mauvais, que celui qui le pourra s'attèle à la
tâche de les rendre meilleurs, ; et l'expédient le plus éprouvé pour
rendre meilleures les âmes viles, c'est de les confondre et de les
écraser sous le poids d'un peu d'or. Il se trouve, mon ami, que je ne
puis guère me dispenser de vos services pour une durée d'un an. Si mon
amitié, jusqu'ici inutile, et de plus en plus impertinente, mérite un
sacrifice, je vous demande de rester.
João Carlos resta. Sous la direction de ma mère, il dressa
la liste des jeunes filles pauvres en âge de se marier, et des hommes
de plus de cinquante ans. La volonté de la donatrice fut doublement
satisfaite, puisque les filles des hommes qui avaient incendié sa
maison furent dotées. Les pères et les filles furent de la sorte
confondus et agréablement écrasés par la phrase de Rosalinda. Une
confusion, et un écrasement que nous accepterons, de bon gré, de la
main des hommes et de Dieu, quand la vengeance du ciel et de la terre
éclatera sur nos têtes criminelles en éclairs de cent et deux cents
mille réis.
Le moment est venu de conclure.
Rosalinda souffrait d'une maladie de cœur. Elle racontait
qu'elle avait senti dans sa poitrine un tremblement douloureux quand
son mari avait fermé les yeux et que, depuis cette épreuve, jamais elle
n'avait cessé de se sentir affligée par le lacérant grignotage de la
mort, qui entamait l'organe qui avait été la source et le trésor
renfermant les joies de son existence durant trente-six ans.
Au début de l'année 1855, ses douleurs s'aggravèrent.
Rosalinda fit son testament et mourut brusquement quelques jours après,
alors qu'elle racontait, d'une voix faible mais claire, à João Carlos,
les derniers instants de gloire de Napoléon Ier.
L'héritier et l'exécuteur testamentaire de Dona Rosalinda
fut João Carlos. Ses bijoux, elle les légua à ma mère et à ma femme.
Elle m'a laissé, à moi, la montre de son mari, en me chargeant de
planter autour de sa tombe quelques pieds de genêts, arrachés à la
touffe qu'elle avait gardée intacte dans son jardin. C'est là
qu'elle avait trouvé l'officier français.
Le montant de cet héritage dispensa João Carlos de servir
les ministres qui, pour commencer, l'avaient réduit à demander l'aumône
; et seraient capables, la seconde fois, de l'envoyer au gibet.
VI
HISTOIRE DES FENÊTRES FERMÉES DEPUIS 30 ANS
Raconte-moi une histoire sans argent, ai-je demandé à mon
ami.
– Veux-tu donc une histoire sentimentale ?
– C'est ça.
– Une histoire de sentiments villageois ? Je ne puis t'en
raconter d'autres. Tu sais bien que j'ignore tout de la vie dans les
villes.
– Voyons ça ; il se peut que tu me rapportes des choses
fort originales !
– Où veux-tu en venir !… De l'originalité !
– Là où je dois aller. C'est que, dans les villes, il n'y
a pas de sentiment qui offrent la moindre originalité. Les passions,
bonnes ou mauvaises, présentent une telle analogie qu'on dirait qu'il
n'y a qu'une seule manivelle pour tous les cœurs. Cette identité est en
grande partie responsable de la monotonie de mes romans. Il y a deux ou
trois situations qui se dégagent plus ou moins de l'intrigue de vingt
de mes romans, élaborés, travaillés et écrits dans les villes. Quand je
veux retremper mon imagination exténuée, je vais la réchauffer à
l'enclume d'une existence champêtre. J'évoque des souvenirs de mon
enfance et de mon adolescence passées dans un village, et même mon
langage prend une autre tournure, simple sans affectation, coquet sans
les acrobaties langoureuses que lui donnent de tortueux stylistes
bucoliques. Dès que je tombe dans le travers de mettre au point des
scènes de la vie cultivée, je vois arriver la verbosité retentissante,
le style déclamatoire, les objurgations aux vices, les panégyriques,
extorqués à ma conscience violentée, d'exemples d'innocence, de vertu,
qui m'ont valu le discrédit d'un romancier de la lune. Et voilà qu'il
est question, mon ami, d'une histoire sentimentale.
– C'est l'histoire des fenêtres fermées depuis trente ans.
– L'Histoire des
fenêtres fermées depuis trente ans !
Voilà un titre original, si je ne me trompe.
– Il correspond à la réalité. Cela se passe dans ma
paroisse. Je connais la mère Felicidade Perpetua, le nom qui contredit
le plus, à ma connaissance, la vie de celle qui le porte. C'est une
femme de cinquante ans, une cultivatrice aisée, et la plus belle,
autant que faire se peut, des femmes de cinquante ans, avec une passion
dans l'âme, toute à ses labours, où la beauté se ternit vite.
Depuis trente-deux ans, elle représentait un modèle pour
des Raphael incapables d'imaginer des beautés. Encore à présent, il
m'arrive de la contempler avec je ne sais quelle tendresse, et je dis
souvent à ma mère :
– Il n'existe pas des cinquantaines comme celle-ci ! –" Si
tu l'avais vue, quand elle participait aux processions de la Sainte
Madeleine !…" répond ma mère.
Commençons par le début. Tu dois savoir que Felicidade
Perpetua était la fille unique d'un laboureur dont les biens devaient
valoir entre vingt-cinq et trente mille cruzados. Son père l'entoura
d'attentions, craignant que la vie aux champs ne gâtât sa complexion
délicate. Il comptait la marier à un laboureur aussi bien pourvu, lui
épargnant la disgrâce de s'astreindre aux travaux champêtres. On lui
offrit d'excellents mariages, mais Felicidade, qui faisait preuve de
volonté dans ses choix, refusait de prendre une décision, acceptant,
quoi qu'elle en eût, le mari que lui donnerait son père.
Avec la maison de ce cultivateur, il avait affaire au plus
grand propriétaire de ma paroisse en ce temps-là. C'était un homme de
soixante-dix ans, sans famille, hypocondre. On disait que le péché
avait rempli d'amertume l'hiver de sa vie, lui transperçant le cœur de
remords, assombrissant ses dernières années en les plongeant dans
l'obscurité des ombres éternelles. Cet homme avait, à cinquante ans,
abandonné une épouse avec une fille à la mamelle. La femme abandonnée
avait succombé au chagrin, et à la misère ; la fille, personne ne
savait si elle était morte dans l'obscurité comme elle était née, si
une main charitable l'avait ramassée sur les guenilles dans lesquelles
sa mère était morte.
– Elle est d'une tristesse, ton histoire ! lui ai-je
lancé. Je ne t'en ai pas demandé une qui fût aussi sentimentale !… Elle
finit par ressembler aux histoires des villes… Je croyais qu'il n'y
avait pas des choses comme ça dans les villages, mon ami !
– Je retire donc mon conte ?
– Tant qu'on y est… Mais charge-le du moins que tu pourras
de couleurs sombres. Ton style ressemble ici au mien. Quand tu m'as
parlé de la Madeleine des processions, j'ai pensé que tu allais me
remplir la poitrine d'arômes de romarin et de sarriette[6] avec les
spectacles religieux de ton joyeux Minho. Tout à coup, tu déçois mon
attente avec des haillons dans lesquels meurt une femme abandonnée avec
une enfant blottie contre son sein mort !… Reprends-toi, pour l'amour
de Dieu !… Tu es bien plus mauvais romancier que moi !… Si tu avais
avais vu dans quelles conditions j'ai écrit les romans qui font pleurer
ton épouse !… Il me suffit de te dire que j'écris toujours à la lumière
du crépuscule. Mes yeux n'en admettent pas d'autre. Quand les jours
sont baignés de la lumière d'un ciel éclatant, je ne prends de ce don
de Dieu que la languissante clarté d'un rayon filtré par des
transparents noirs. Mon cabinet de travail, durant les splendides mois
de l'année, est une continuelle tombée de la nuit. Cette obscurité,
portant naturellement à la mélancolie, qui se diffuse autour de moi,
finit par produire un effet sur mon imagination. Sans le soleil, la
terre est une chose qui fend le cœur et nous afflige, comme si elle
devait nous ramener au chaos primitif : mon âme, qui ne peut baigner
dans des océans de lumière, que tu fixes sans ressentir aucune douleur,
en est assombrie. Je me suis habitué à voir le monde extérieur plongé
dans la pénombre ; mon univers subjectif est peuplé d'idées
sombres. Et toi, mon ami, si heureux, qui respires à ce point la
santé à vue d'œil, qui restes à ce point en contact avec le soleil, les
arbres, les ruisseaux, et les fleurs, d'où tires-tu ce langage plaintif
?! Si tu me décrivais les joies de l'extraordinaire Felicidade sans me
raconter que son voisin cultivateur a abandonné la mère de sa fille…
– C'est un épisode nécessaire à l'intrigue.
– Vraiment ? Tu vas donc me dire maintenant que, rongé par
le remords, le laboureur est parti à la recherche de sa fille…
– Non : se voyant seul, il a pris comme intendant le fils
d'un journalier, son filleul. Ce garçon, qui est vieux aujourd'hui, et
s'appelle Lourenço Pires, a été en son temps un gaillard bien fait de
sa personne, qui jouait de la clarinette dans les bals populaires,
était bienvenu quand il fallait battre le blé ou le lin, qu'on trouvait
si on le cherchait, qui était apprécié par les jeunes filles, aimé de
quelques-unes qui ont, pour lui, fait semblant d'être possédées pour ne
pas se marier en respectant la volonté de leur père.
Perpetua s'est éprise de Lourenço. L'inaccessible, la
noble jeune fille, si courtisée par les cultivateurs aisés, qui
semblait ne se parer que pour emporter sa dot dans une maison
blasonnée, a aimé l'intendant de son voisin. Les vieux racontent que,
durant les nuits chaudes, quand son parrain s'enfermait avec ses
remords dans la pièce la plus reculée de sa vaste bâtisse en pierres de
taille, Lourenço s'en allait sur la grand place, ombragée par de
gigantesques chênes, et que là, assis sur un billot de bois, il
chantait, en faisant des arpèges sur sa guitare, entre autres couplets
émouvants :
Du roi je fus un
canari,
Mais, de ma cage envolé,
Je suis le chardonneret
Des fillettes d'aujourd'hui.
On dirait que c'est ce style que tu veux.
– Voilà qui est mieux. Cette niaiserie est beaucoup plus
sincère que d'autres encore plus sottes que l'on écrit dans les villes.
– J'allais le dire, si tu ne l'avais fait ; et le premier
exemple qui me venait à l'esprit, c'était toi.
– Moi ?! Merci !… Je saisis cette occasion de savoir quand
j'ai été plus idiot que monsieur Lourenço Pires.
– Quand tu as écrit et publié cette poésie où l'on pouvait
lire ces trois vers :
Je suis un martyr
de l'amour ;
Je suis un ange qui souffre
Il n'y a pas de plaisir qui me sourie !
Est-ce de toi ?
– Probablement ; il n'y a pas de bêtise que je n'aie pas
écrite.
– Fort bien : quand il disait qu'il était un chardonneret,
Lourenço était moins grotesque que toi quand tu as dit que tu étais un
ange. Un ange, toi !… Quel ange !… C'est lorsque tu as proclamé ton angélisation, que je t'ai pris à
manger des huîtres crues à l'Aigle
d'Or. Essaie de te rappeler ! C'est alors que j'ai commencé à ne plus
croire aux poètes, et à croire aux huîtres…
– Je m'en souviens fort bien, mon ami. C'est à ce
moment-là que je me suis abîmé le foie et la rate. Les trois vers, que
tu foules au pied avec une judicieuse ironie, trahissent un
ramollissement du cerveau. Tant que nous y sommes, quand tu estimeras
que l'ange a été suffisamment châtié, raconte-moi l'histoire du
chardonneret.
– Il a été aimé, aimé comme tous les crétins qui vont
droit au cœur des femmes par des chemins tout à fait dépourvus de sens
commun.
Elle donna suffisamment de courage à Lourenço pour la
demander à son père.
Le vieil homme a pensé mourir d'étonnement et de chagrin,
quand Felicidade Perpetua lui dit qu'elle n'en épouserait pas un autre…
Tu vas entendre à présent une bien triste péripétie de ce conte. Je
vais te la rapporter brièvement et sèchement. Au bout de quelques mois,
la jeune fille, en larmes, dit à son père je ne sais quoi de si
désolant que le vieillard sortit de chez lui en hurlant pour battre la
campagne, et passa trois jours et trois nuits dehors. On le ramena sur
une civière. La fièvre lui avait fait perdre l'esprit. Il vit sa fille,
et ne la reconnut pas. Il retrouva sa tête pour lui pardonner ; et
rendit l'âme en lui pardonnant.
Perpetua fut secouée de sanglots sincères ; mais la
vindicte publique, malgré le pardon de son père, ne lui pardonna pas.
L'infortune de la jeune fille était notoire. Les mères de famille se
déchaînèrent contre elle, la désignant comme un exemple, retournant le
couteau dans la plaie du déshonneur pour en souligner l'immondice et la
turpitude aux yeux de leurs filles. Celles-ci, qui l'avaient prise en
haine à cause se ses airs de grande dame, et de ses afféteries, se
vengeaient en l'accablant de leurs quolibets et de leurs rires.
Perpetua s'empressa de faire publier les bans pour épouser
Lourenço Pires. Celui-ci, heureux de cette suite d'événements qui lui
avaient procuré la main d'une belle fille et une maison qui valait son
prix, alla parler à l'abbé, à qui il présenta ses certificats.
Le premier dimanche, au moment où l'abbé achevait la
lecture les bans, une jeune fille d'une autre paroisse sortit de
l'assistance et, s'arrêtant sous le porche de l'église, annonça que
Lourenço Pires lui avait perfidement promis le mariage, et porté
atteinte à son honnêteté.
Il s'ensuivit une grande agitation. Perpetua qui assistait
à la messe dans un recoin obscur entre le bénitier et le confessionnal,
sortit de l'église en larmes. Lourenço…
Ma rancœur était si grande contre ce maudit qui, dans
l'ordre des oiseaux, méritait d'être rangé dans l'espèce des vautours,
que je l'interrompis :
– Le chardonneret…
– Le chardonneret s'éclipsa, lui aussi, par une autre
porte, fumant de rage. L'abbé mit fin à ce désordre et aux criailleries
des femmes qui faisaient de ce scandale une farce, et continua sa
messe. Il appela ensuite la femme qui s'était manifestée à la lecture
des bans, enregistra les témoignages, et intenta le procès qui fut
confié à la chambre ecclésiastique de Braga.
Perpetua vint demander de l'aide à ma famille, et quitta
sa maison. Mon père défendit à Braga la requête de Lourenço Pires. Les
preuves contre le séducteur étaient minces, et entamées par des témoins
qui mirent en cause, dans leurs dépositions, l'honnêteté de
l'intrigante. Le procès, un avilissant amas de déballages abjects,
comme le sont d'ordinaire ces affaires mettant en jeu un prétendu
honneur, s'éternisa plus d'un an sans qu'on parvînt à un arrêt.
Soustraite entre-temps aux moqueries stupides et cruelles des
villageois, Perpetua trouva une âme compatissante en ma mère, et les
yeux d'un charitable amour pour la voir avec un enfant en bas âge dans
les bras, dont mes parents furent parrain et marraine.
À cette époque, un prêtre vint d'une autre région, loin de
la nôtre, trouver le cultivateur qui protégeait Lourenço.
Ce prêtre venait raviver ses remords en lui annonçant
l'existence d'une femme de vingt-trois ans, fille d'une certaine
Quiteria qui, avant de mourir, dans un village aux environs du Gerês,
avait demandé à un autre prêtre d'écrire son histoire, afin que sa
fille sût un jour ou l'autre qui était son père. Cette histoire, le
prêtre qui l'a écrite, l'a gardée sous la main pour la remettre à la
jeune fille quand elle serait capable de tirer parti des renseignements
qu'on lui donnait sur sa naissance. Mais vu que le rédacteur était
décédé avant la date où il pourrait confier à la jeune fille cet
important document, et que la famille du défunt ne fit aucun cas de ce
papier mêlé à d'autres sans valeur, il s'est passé vingt ans avant
qu'un autre clerc de la même famille, en examinant de vieux papiers
dont ses tantes comptaient se servir pour envelopper des écheveaux de
lin, tombât sur celui-là, et déployât tous ses efforts pour trouver
l'adresse de Maria, la fille de Quiteria.
D'étape en étape, il finit par tomber sur elle dans le
canton de Montalegre où elle travaillait pour des agriculteurs. Elle
jouissait d'une bonne réputation et de l'estime de ses patrons. Un
autre prêtre de la famille se chargea de faire connaître ce document,
dicté par Quiteria à l'article de la mort, avec de tels détails, que le
vieux laboureur, à la lecture des conseils que le rédacteur, au nom
sans doute de cette mère infortunée, donnait d'outre-tombe à sa fille,
cria tout ce qu'il savait et confessa tout ce qu'on voulut, en
demandant qu'on lui amenât sa fille aussi vite que possible, avant que
le démon le cueillît, sans qu'il eût mérité le pardon pour ses énormes
fautes.
Quelques jours après, le riche laboureur recevait chez lui
sa fille et, dans sa joie délirante, lui jetait eu cou quatre cent
mille réis de chaînes d'or, avec de si grands cœurs, que sa poitrine
haletante, malgré son émotion, ne les faisait même pas trembler.
Maria Martins était dès lors la plus riche héritière de
cette région du Minho ; mais elle pouvait par contre se vanter d'être
la femme la plus laide de la province.
Maintenant encore, lorsque je la rencontre, je me dis :
"Tant que cette femme sera vivante, il sera impossible de concevoir
plus idéale horreur de la laideur humaine."
C'était, à ce qu'on dit, le visage de son père révisé par
les Parques.
VII
Ce démon, poursuivit António Joaquim, s'est amouraché du
filleul de son
père. Lourenço Pires était une irrésistible brute ! S'il n'y avait eu
le sortilège de sa guitare et de sa clarinette, je penserais que ses
yeux lâchaient des torrents magnétiques ! Il semble qu'une femme ne
pouvait le regarder en face sans se sentir aussitôt infectée par
l'amour.
Malgré le procès en cours à Braga, Maria Pires[7] ne se
sentit plus. Elle se confia à son père qui ne jugea pas cette
confidence malvenue ; il lui fit toutefois observer que Lourenço serait
forcé d'épouser l'une des deux jeunes filles quand l'affaire serait
résolue à Braga.
Maria ne baissa pas les bras, et Lourenço ne se déroba pas
aux tendres avances de la richarde, qui, tous les dimanches, avec
l'assentiment de son père, dont la tête commençait à grouiller, se
harnachait d'or, et mettait quatre foulards de soie sur la tête, les
uns par-dessus les autres.
Dis-moi, toi, si oui ou non, il l'était, irrésistible !… Des
aînés de bonne famille, avec tout le respect qu'ils devaient à leurs
illustres ancêtres, vinrent demander la main de Maria. Le laboureur
s'en remettait à sa fille ; et elle disait, avec l'assurance d'une
femme éblouie, que l'élu de son cœur était Lourenço.
Un jour qu'il étalait au soleil des haricots dans l'aire,
Maria cueillait des choux dans le potager.
Que tableau inouï ! Si les paysagistes pouvaient profiter
de ce spectacle enchanteur !
En sautant dans l'aire par le portillon du potager, Maria
laissa tomber un bouquet de fleurs bien laides, que la nature avait
faites exprès pour elle, il était composé de tournesols et de
marguerites. Lourenço s'en aperçut et dit, avec une idée derrière la
tête :
– Pour qui vous l'avez fait, ce bouquet ?
– Pour qui le mérite.
– Ce n'est pas pour moi ?
– Allez savoir…
– Attention à ce que vous dites, Mademoiselle Mariquinhas
!…
– Ce qui est dit est dit, Monsieur Lourenço.
Les deux parties furent à ce moment-là déboutées à Braga.
Le fils du journalier parcourut, avec les yeux de son âme, les
parcelles cultivables, les planches de terre, et les montures de la
future héritière de Joaquim Martins. "Tout ça peut être à toi !" a
soufflé le démon à l'âme abjecte de ce goujat. Aussitôt, le visage
tendre, baigné de larmes, de Felicidade s'évanouit derrière la
rustaude, qui se délectait à contempler son stupide chéri. Elle avait
ramassé les fleurs, elle les lui donna avec un sourire niais que aurait
fait pleurer un satyre de dégoût. Lourenço suspendit les fleurs aux
boutonnières de son gilet, et lui débita de galantes gaudrioles, après
lesquelles la jeune fille quitta la place en contenant à grand peine
les cabrioles de son cœur. Elle raconta ce qui s'était passé à son
père, et le vieillard, de plus en plus gâteux, partagea la joie de sa
fille.
Le tribunal ecclésiastique autorisa Lourenço à épouser
Felicidade. Mon père annonça l'heureuse nouvelle au garçon qui ne s'en
montra guère ému. Au comble de la joie, la jeune femme, que nous
hébergions, s'en alla chez elle, avec son enfant de huit mois, veiller
à tous les préparatifs domestiques afin que sa maison fût prête pour
l'arrivée de son époux. Sans consulter l'intéressé, l'abbé procéda à la
lecture des seconds bans. Lourenço disparaît alors de son village, sans
que personne ne sache où il est parti.
On disait qu'entraîné par la main de la Providence, il
était allé se marier avec la fille qu'il avait séduite auparavant.
Felicidade retourna chez ma mère, plongée dans une anxieuse détresse.
Au bout de quelques jours, l'on apprend que, moyennant
quelques pièces tirées du coffre de son parrain par la main de sa
présomptive héritière, Lourenço avait obtenu à Braga une licence pour
se marier avec Maria Martins dans n'importe quelle paroisse de
l'archevêché. Quand la nouvelle arriva ce cynique crétin était marié.
Quelques parents de Felicidade encerclent sa maison pour le tuer. Le
père de la fiancée entend les coups de feu, qui entament les fenêtres,
et finit de perdre l'esprit. Il lui fallut peu de jours pour passer de
la sénilité à la mort.
Lourenço s'enfuit avec son épouse pour rejoindre des
propriétés qu'ils avaient à Cabeceiras de Basto, ils y restèrent un an.
Durant ce temps, croyant se venger, Felicidade songe à se
marier. C'est en cela que consiste le comble du désespoir : la mort
n'est pas aussi terrible.
Elle trouve un mari : c'est le fils d'un pauvre
cultivateur, une bonne âme que la Providence lui aurait envoyée, si la
Providence avait l'habitude d'apporter sa contribution à ces romans du
genre humain dont les péripéties ne présentent aucune originalité. Cet
homme cajole le fils de Felicidade avec une tendresse paternelle. Quand
il la voit pleurer, il veut boire ses larmes, mais elle ne cesse de
pleurer. Et puis, la pénitente ne permet pas qu'on ouvre les fenêtres
qui donnent sur la maison de Lourenço. Son mari respecte l'impérieuse
volonté de sa femme ; et plus jamais, la lumière du soleil n'a
réchauffé le sol humide de cette maison.
Trente ans se sont écoulés. Felicidade vieillit : elle a
des fils qui sont devenus des hommes ; les volets de la fenêtre sont
déjà vermoulus ; mais il n'y a pas une seule heure où l'air ait pénétré
dans les chambres, qui se détériorent et s'en vont en lambeaux.
Trente ans se sont donc écoulés.
Il est temps d'aller chercher dans la maison de Lourenço
Pires la justice du ciel.
Il a eu quatre fils de sa femme, Maria Martins.
Nous parlerons d'abord de la femme. Il semble que l'esprit
le disputait au corps pour voir lequel deviendrait le plus repoussant.
Quand elle vit son mari pris de remords qui ne lui enlevaient pas
seulement sa gaieté, mais jusqu'à l'embouchure de sa clarinette, elle
se mit à le poursuivre de questions brutales auxquelles, n'en pouvant
plus, il répondit un jour en lui administrant quelques coups de poing.
Peu à peu, devant l'accroissement des poussées de bile de son épouse,
exaspéré, il passa du poing au bâton, et lui infligea de bonnes volées,
comme pour alléger, en la bastonnant le poids de ses péchés. À force de
recevoir des raclées, la mégère finit par filer doux, et par éviter son
mari comme un fou furieux. Chaque fois que Lourenço apercevait
Felicidade, avec ses sept enfants, joyeux, autour de leur mère, comme
sept séraphins, prêts à la consoler, il se cachait pour pleurer, et
s'enfuyait pour qu'elle ne le vît pas. Un jour, alors que le fils de
Felicidade passait tout seul à côté de lui, il voulut l'embrasser ;
mais le gamin de sept ans partit en courant, et en appelant sa
mère à grands cris.
Les quatre fils légitimes de Lourenço, c'était comme la
portée d'un couple de loups. Dès l'enfance, ils manifestèrent la
férocité de leurs instincts. Ils se donnaient des coups de dents, et
mordaient leur mère au visage.
Leur père avait destiné l'un au sacerdoce, un autre à la
médecine, un autre à l'étude du droit, et le quatrième devait devenir
le maître de la maison.
Après avoir donné des preuves irréfutables de son
incapacité pour les lettres, l'aîné entra dans la carrière des armes.
Au bout d'un an d'une immonde vie, lourde de scandales et de débauches,
digne des bas-fonds, il put quitter le service, et se présenta chez lui
pour réclamer de l'argent afin de s'établir comme négociant en alcool.
Son père eut peur de lui, et lui donna la somme qu'il dépensa en se
livrant au libertinage, puis revint à la maison pour voler tout ce
qu'on ne lui donnait pas de bon gré. C'était là le fils que l'on
destinait au sacerdoce.
Celui qui devait devenir médecin, recalé à la première
année, se noya trois ans de suite, sans revenir chez lui, dans l'alcool
au point de devenir tout à fait abruti. Son père alla le récupérer dans
les bouges de Coïmbra, et le ramena. Le garçon persista dans son
ivrognerie ; et, dans l'un de ses fréquents accès, il braqua une
carabine sur le visage de son père, et lui laissa la vie en échange
d'une bonbonne de tord-boyau. Ce malheureux eut la chance de mourir
noyé dans un puits, où il avait voulu rafraîchir les vapeurs de
l'ivresse.
Le troisième fils, qu'on avait envoyé étudier les lois, a
traîné six ans en classe préparatoire, pour obtenir à la fin trois rr[8] en latin. Il revint chez lui en se donnant
le titre de
docteur[9]. Son père
l'embrassa, en lui affirmant qu'il représentait sa
seule consolation. Un jour il s'en fut à Braga, où il parla de son
docteur de fils. Un informateur sans entrailles lui raconta les
prouesses du jeune homme. Lourenço prit très mal le mensonge de son
fils, s'emporta, voulut lui faire tomber sa licence du dos à coups de
gourdin ; mais l'apprenti latiniste qui n'était arrivé à rien au bout
de sept ans, se saisit du tromblon de son frère de mémoire avinée, et
fit face, en bombant le torse, au pieu menaçant.
Le quatrième, qui devait rester à la maison, se rendit à
une fête populaire, y vit une chanteuse qui lui avait laissé de bons
souvenirs, apprécia son talent de versificatrice et se prit de passion
pour elle. Il la suivit jusque dans sa paroisse, bien qu'on lui dît
qu'il s'agissait d'une journalière pauvre, vicieuse, et méprisable. Il
la ramena dans sa région, et demanda à l'abbé de les marier. Prévenu de
cette ignominie, Lourenço fit chasser la fille de la masure où elle
vivait. Son fils alla la rechercher, après avoir volé trois chaînes
d'or de sa mère, et tout ce qu'il put. Il parcourut ce monde six mois
durant, et revint avec elle, marié fort légalement, pour habiter chez
sa mère, qui se cachait au grenier, épouvantée par les menaces de sa
bru.
La maison du père de Maria, de ce riche cultivateur, est
réduite à moins que ce que possède Felicidade Perpetua.
Lourenço inspire la pitié aux gens qui l'avaient pris en
haine. Ses trois fils, aussi pauvres les uns que les autres,
l'insultent. Et lui, atteint de démence, tremble en leur présence, ou
s'enfuit dès qu'il entend leurs pas.
Quand ses yeux tombent sur les cinq fenêtres fermées de la
maison en face, il meugle comme un taureau piqué par une banderille.
L'autre femme, dont il avait provoqué la perte, une mendiante en
haillons, l'attend, le guette, surgit brusquement devant lui, pour lui
lâcher au visage un éclat de rire, qui le met en fuite. Cela se produit
une fois par semaine depuis dix ans. Et cet homme reste vivant ! Il a
cinquante ans ; son visage émacié, la courbure de son épine dorsale
trahissent la décrépitude du criminel, enchaîné au gibet de la vie. Le
mépris de ses enfants va jusqu'à lui refuser son pain. On me dit que ce
malheureux a souffert de la faim. Quand il va se plaindre à la justice,
il inspire la pitié ; mais personne d'autre n'ose frapper aux portes de
ces trois cœurs de bronze, sorties des entrailles maudites d'un tel
père.
Rendons-nous à présent chez Felicidade Perpetua.
Les larmes de cette femme, sur le visage de laquelle
éclate la splendeur de la pénitente pardonnée, tombent sur le giron de
ses humbles filles. L'aîné, chéri par les enfants de l'autre père,
dirige les labours, c'est le plus travailleur dans ce domaine, qui
appartient entièrement à ses frères, il touche une part infime de ce
qu'elle rapporte. Ça fait bien des années que le mari de Felicidade est
mort : à sa dernière heure, il a demandé à sa femme de faire beaucoup
d'économies pour laisser quelques ressources au fils qui n'était pas de
lui.
Trois de ses garçons sont partis pour le Brésil, et tous
ont fait fortune, guidés par les principes que leur dictait l'honneur.
Il semble qu'ils rivalisent entre eux pour offrir à leurs frères et à
leur mère des cadeaux et de l'argent, qui permettent à la maison de
s'agrandir. Leur frère aîné est traité sur le même pied que les autres.
Les filles sont les perles de ma paroisse ; leurs grâces
s'évanouissent, quand on considère la beauté de leur vertu.
Et pourtant, ces fenêtres n'ont plus jamais été ouvertes,
et Felicidade a encore des larmes à verser.
J'aimerais pouvoir te dire les mystérieuses peines que
ressent cette âme, quand lui apparaît subitement Lourenço Pires,
l'ancien, dont la démarche poussive donnerait à penser qu'il traîne
derrière lui la dalle de son tombeau, en cherchant un bout de terre où
se cacher en proie à sa déchirante agonie.
Je ne sais ce qu'elle pense.
J'ai surpris un jour ma mère à déplorer, devant
Felicidade, la misérable fin de Lourenço. Cette pauvre femme joignit
ses mains suppliantes et dit : "Dieu sait que je lui demande tous les
jours de rappeler à lui cet infortuné."
Un autre jour, ma mère m'a dit qu'elle avait demandé au
fils de ne pas fuir son père ; de lui parler au contraire avec
affection.
J'ai vu, peu après, au milieu d'un bois épais où je
chassais, Lourenço Pires assis à côté de son fils, qui le contemplait
en silence. De temps en temps, il lui prenait les mains, qu'il couvrait
de baisers, en balbutiant des mots que je n'ai pu entendre.
J'ai demandé au filleul de mon père ce que lui disait le
vieillard. Il m'a répondu que c'étaient des mots sans suite ; mais
qu'il pleurait beaucoup et lui demandait pardon.
Tu as là une histoire sentimentale. Que Dieu m'épargne la
peine de la lire en six volumes de ton cru, et qu'Il évite à tes
lecteurs que ce conte remonte à ta mémoire, quand ton imagination sera
fatiguée.
Nous nous trouvons à Amarante, ajouta António Joaquim.
Mettons pied à terre, et partons à la recherche de notre Vasco Peixoto,
qui possède un terrain, tout droit tiré du Paradis Terrestre, plein de
pêchers. Je ne sais si Bernardo de Brito le confirme ; mais les pêches
de Vasco Peixoto descendent, par sa branche mâle, de la pomme qui a
fait pécher Ève et son mari. [10]
VIII
LA CROIX SUR LA COLLINE
Nous avons passé la nuit à Amarante dans une auberge où
j'avais vu,
quelques années auparavant, trois belles créatures, les filles d'une
femme ronde et grave qui la tenait.
La mère et ses filles s'étaient éparpillées ; c'était
entre les mains d'une autre famille qu'était tombé cet hôtel qui avait
renoncé à la couleur toute portugaise du nom d'estalagem[11] de la ***.
C'est le nom du propriétaire que l'on ne peut, quoiqu'il soit
portugais, écrire dans cette chronique périssable : il restera
éternellement fixé dans la mémoire des étudiants qui, il y a vingt ans,
y ont laissé leurs propres cœurs, et les os des énormes poules qu'ils
ont désossées.
J'ai demandé des nouvelles des anciennes propriétaires de
cette auberge qui m'avait laissé de bons souvenirs. On me dit que la
mère s'était retirée pour se reposer en profitant de ses domaines : que
deux de ses filles avaient fait de riches et honnêtes mariages ; et que
la troisième… Quelle douleur en mon cœur, quelle écœurante histoire !…
On ne la peut raconter ! Il faut franchir un vaste bourbier de sang et
de larmes pour passer de la pudique alcôve d'une femme sans tache au
grabat d'un hôpital, la dernière étape d'une débauche qui vous prive de
tout appui. Il n'y a pas d'histoire pour la malheureuse que nous
appelions il y a quinze ans, quand nous étions étudiants, "la fleur du
Tâmega[12]". La Divine
Providence a ouvert les immenses trésors de sa
miséricorde en la tuant.
Nous avons vu le soleil se lever, le lendemain sur les
hauteurs de Pildre. De là, avec la longue-vue de mon ami, j'ai cherché,
entre les branchages les créneaux du portail manuélin de la demeure de
Frigim. Cette maison avait appartenu à José Augusto Pinto de Magalhães,
un personnage qui a ouvert, il y a dix ans, une chronique riche
d'infortunes, close avec elle dans un cimetière de l'Alto de São João à
Lisbonne. J'y avais passé une nuit, il y a douze ans. J'ai évoqué
devant António Joaquim la mystérieuse tragédie de José Augusto. C'était
une bonne occasion de vous la raconter, cher lecteur ; mais, le mois
prochain, flottera "sur la rivière du sombre oubli et du sommeil
éternel" encore un livre de moi, dévoilant la face énigmatique de cette
désolante infortune, que le monde impitoyable a voulu expliquer par une
calomnie encore plus abjecte.
Quand nous avons aperçu le majestueux édifice d'Alemtem,
mon ami m'a prié de braquer ma longue vue en haut d'une colline, où
l'on distinguait une croix surmontée d'un porche, avec son candélabre
suspendu au dais qui formait une voûte.
– Cette croix pourrait inspirer un joli roman, dit António
Joaquim, je le qualifie de joli, parce qu'il illustre une sublime
philosophie. Je suis allé, il y a quelque temps, acheter un poulain
dans cette paroisse, et j'ai fait la connaissance, chez l'acheteur,
d'une personne, un modeste laboureur, que les gens de la région
appellent "Manuel le Brésilien". Me fondant sur ses vêtements rapiécés,
où la terre formait des croûtes, je me suis dit que l'épithète de
Brésilien était une épigramme populaire, un surnom que la canaille ne
manque pas de donner à ses compatriotes qui sont revenus pauvres du
Brésil.
Voici ce que m'a raconté un autre laboureur là-dessus.
Quand Manuel da Mó avait vingt ans, et cultivait
joyeusement ses terres, avec du foin plein les bottes, on vit arriver
dans la paroisse trois Brésiliens, fils d'un fermier, qui achetèrent
des domaines pour le triple de leur valeur, puis édifièrent de superbes
demeures, de quoi délasser les yeux en mortifiant l'envie.
Dès l'arrivée des Brésiliens, Manuel perdit sa bonne
humeur, le sommeil, et son appétit. Une idée le taraudait, s'en aller
au Brésil. Sa mère sexagénaire pleurait jour et nuit, depuis que son
garçon, son fils unique, s'était mis tête d'aller chercher assez
d'argent pour faire construire une maison identique à celle de ses
voisins, défricher des hauteurs, ouvrir des galeries, pour tirer de
leurs entrailles, assez d'eau pour arroser les terres que la sécheresse
rendait improductives. Les lamentations de la vieille n'arrivèrent pas
à le retenir, non plus que les doléances de Marcolina do Eirô, son
amoureuse depuis deux ans, son premier amour, une belle en un mot, avec
une dot de dix contos, et six chaînes d'or.
Manuel demanda des lettres de recommandation aux
Brésiliens, qui voulurent sincèrement le dissuader de réaliser ce
projet. Ils lui dirent qu'il était, en ce qui le concerne, trop tard
pour se rendre au Brésil ; que c'était une rude sottise d'abandonner sa
patrie et ses biens pour aller en engranger d'autres sous un climat
malsain ; que la misère excuse l'ambition de ceux qui abandonnent leur
famille, et vont mettre leur existence en jeu afin de trouver un moyen
d'y subvenir ; tandis que Manuel, en tant que cultivateur aisé, n'en
avait aucune de laisser derrière lui sa vieille mère pour s'occuper de
ses terres. Ils lui expliquèrent ensuite les travaux auxquels ils
avaient dû s'astreindre pour gagner leur indépendance, après avoir
trimé trente ans, en sacrifiant les plaisirs de presque une vie entière
dans l'espoir de se reposer à la fin de leur vie. Ils initièrent sur ce
point, détaillant une à une les peines qu'entraîne le fruit si cher que
peu d'entre eux, qui étaient parvenus à le cueillir, ramenaient en
revenant du Brésil, par rapport au grand nombre de ceux qui y
succombaient dans le dénuement, écrasés sous le poids d'un travail que
leur patrie n'impose pas au plus dépourvu de ses enfants. Ses
conseillers sincères lui demandaient si cela valait la peine de gâter
les trente meilleures années de sa vie, de s'astreindre à renoncer à
ses plaisirs, pour gagner à la fin quelques poignées d'or, dont l'on
profitera en s'accordant des plaisirs quand l'on n'a plus envie de les
savourer. À chaque pas, la maladie rappelle au vieillard riche et
triste que l'on creuse sa tombe !…
Cela ne fit aucun effet sur l'esprit de Manuel da Mó. Il
se convainquit que les Brésiliens ne voulaient pas qu'il leur fît de
l'ombre ; il garda ses soupçons pour lui, et s'en alla demander dans
d'autres paroisses des lettres de recommandation. Partout, on lui
répétait les conseils de prudence de ceux qui avaient connu ces
épreuves ; tous lui remirent toutefois ces lettres.
Marcelina do Eirô fit une dernière tentative, en menaçant
ce garçon instable de s'empoisonner avec de l'arsenic, ou de se marier
avec un autre. Pour Manuel, aveuglé par l'envie, Marcolina pouvait
aussi bien aller s'agenouiller avec le João de la mère Custódia, ou le
Bento de la Lomba sous l'arc de l'église, que vomir ses tripes et ses
boyaux lacérés par l'arsenic. Il empaqueta furtivement son costume, fit
certifier son passeport, et s'embarqua.
Cependant, la veille de son départ, en passant là-bas, au
sommet de la colline où tu as vu la croix, il fit une prière à Dieu,
lui demandant de l'aider à revenir riche dans son pays, il s'engageait
à faire dresser à cet endroit une grande croix de pierre avec son
porche ; et d'alimenter, tant qu'il serait vivant, toutes les nuits, la
lampe du sanctuaire en huile.
– Il est donc clair qu'il est revenu riche ! dis-je.
– Nous y venons. L'homme alla présenter ses lettres, et
les négociants lui demandèrent, sur le même ton, quel était son métier.
Manuel ne découvrit qu'à ce moment-là qu'il n'en avait aucun. Il eût
voulu répondre que son métier, c'était de s'enrichir le plus vite
possible ; mais ceux qui l'interrogeaient ne lui donnaient pas le temps
de trouver une réponse. Il finit par révéler qu'il était parti de chez
lui pour être négociant. Son interlocuteur effaré l'invita à faire du
commerce, et à s'établir, après avoir présenté des lettres de crédit,
s'il n'avait pas amené du Portugal la bosse du commerce. Quand on lui
parla de bosse, Manuel devait regarder leurs quatre pieds[13] pour se
convaincre qu'il en avait bien assez.
Il finit par dépenser les derniers pintos qu'il avait
emportés de chez lui au fond du bas où sa mère les gardait, sans avoir
trouvé d'emploi. Les larmes aux yeux, il avoua le dénuement dans lequel
il se trouvait à une des personnes à qui il avait remis une lettre, et
qui lui avait fait le meilleur visage. Le négociant, qui avait des
domaines à Cantagalo, l'envoya manier une bêche dans ses plantations de
café, avec un salaire de dix mille réis par mois. Le garçon n'attendit
pas d'avoir touché son premier mois : le brasier de ces brousses
vierges, transformées en bûcher, et le soleil, qui lui frappait de
plein fouet le dos, lui donnèrent une idée de l'enfer. Le pauvre homme,
dégoulinant de sueur, se souvenait de la fraîcheur de ses bois, de
l'herbe de ses champs, des deux chênes séculaires, qui prodiguaient
l'ombre de leurs branchages à sa petite maison, au bord d'une rivière.
Et il pleurait en maudissant la richesse de ses voisins brésiliens, en
oubliant qu'il aurait dû les bénir pour les conseils qu'ils lui avaient
donnés.
Manuel revint à Rio demander de l'aide à un autre
négociant, qui lui proposa généreusement une avance pour regagner le
Portugal, vu qu'aucun moyen de gagner sa vie ne lui allait.
– Je vais donc m'en retourner comme je suis venu ? demanda
Manuel de Mó.
– Non, Monsieur, vous vous retrouverez plus démuni que
vous n'êtes venu, répondit le négociant.
Le jeune homme fut affecté par ce désolant sarcasme et dit
qu'il travaillerait jusqu'à en mourir ; mais qu'il ne reviendrait pas
pauvre au pays.
Dans ce cas, répliqua le négociant, restez dans les
domaines de Cantagalo, c'est un endroit parfait pour mourir vite.
– Je voulais être caissier, dit Manuel.
– Écrivez ici votre nom, dit le négociant.
Manuel prit la plume comme s'il empoignait une tarière, et
transperca le papier trois fois avant d'écrire le M.
– C'est bon, c'est bon, fit l'autre en souriant, je vois
que vous utilisez la lettre anglaise !… Et vous voulez être caissier !
Vous étiez mieux taillé pour montrer aux gamins les lettres de
l'alphabet. Quand on écrit de la sorte, on n'a rien d'autre à enseigner
que l'écriture. Voyons comment vous vous débrouillez en calcul.
Faites-nous là une division avec virgules. Mettez là…
Manuel écarquilla les yeux, et s'écria :
– Quoi ?
– Connaissez-vous la règle de trois ? Connaissez-vous les
quatre opérations de l'arithmétique?
– Je ne sais rien de tout cela, Monsieur !
– Vous ne savez pas faire des comptes ?!
– J'en sais assez pour me débrouiller ; mais pour ce qui
est de… comment dit-on ?… au besoin, on compte sur ses doigts.
– Eh bien, mon ami, rétorqua le Portugais compatissant,
allez-vous-en ; fuyez le Brésil, si vous ne voulez pas y laisser vos
os. Vous ne pouvez compter que sur votre bêche ; bêche pour bêche,
allez travailler au pays : un salaire de quatre vinténs par jour
là-bas, c'est mieux que trois pataques [14] au Brésil.
– Grâce à Dieu, j'ai des champs où je peux travailler,
répliqua Manuel.
Mes terres valent quatre-vingts contos.
– Alors vous êtes laboureur, vous avez des champs, et vous
venez chercher la fortune au Brésil ? Je n'ai qu'une chose à dire, si
vous ne voulez pas partir pour le Portugal, allez au Diable, je ne
discute pas avec des fous.
Manuel s'en alla confus, le cœur plongé dans les ténèbres.
Sans parler des noirs qu'il voyait, tout lui semblait avoir la couleur
de son âme.
L'ambition avait donné à son esprit la trempe du fer. Il
lui semblait impossible de se trouver à Rio, d'avoir envie de manger,
et pas une seule pataque. Il se promenait dans les rues de Quitanda et
d'Ouvidor. Il écoutait le tintement de l'or et de l'argent qui
jaillissaient en flots blancs et jaunes des comptoirs. C'était Plutus,
le démon ou le dieu moqueur de la richesse qui lui faisait des grimaces
à l'intérieur des boutiques regorgeant de merveilles. Le malheureux
était ébaubi devant les vitrines des bijoutiers ; même l'éclat des
brillants se réfractaient dans les ténèbres de son âme.
Il était pris de bouffées de rage contre ces hommes qui le
voyaient passer ainsi, et le considéraient comme s'ils voyaient dans
ses yeux l'intention de s'attaquer à leurs propriétés.
Dans l'une de ces excursions, Manuel da Mó crut voir un
jeune homme d'une paroisse voisine de la sienne. Il eut le courage de
lui demander s'il était bien Francisco Tamanqueiro[15]. L'autre lui
jeta un regard sombre, et lui dit :
– Je m'appelle Francisco António Guimarães Coelho.
– Veuillez m'excuser, j'avais cru que vous étiez un gars
de ma région.
C'était le cas ; mais le nom de Tamanqueiro qui lui venait
du métier de son père, blessa l'oreille du commis qui s'était fait Guimarães Coelho pour donner à sa
signature une sonorité assez belle
pour prétendre, un jour, au titre de vicomte de Guimarães, ou baron de
Coelho.
Manuel passa son chemin ; il se retrouva, peu après, dans
les bras d'un homme mal vêtu, qui lui cria aux oreilles :
– Qu'est-ce que tu fais là, Manuel de Mó ? Tu ne me
remets pas ?! Je suis Caetano da Chã dos Codessos !
Manuel le regarda deux fois de haut en bas, et murmura,
avec une certaine froideur :
– Tu en baves ici ?
– Ça oui !… J'ai crevé la faim, Manuel ! Maudit soit celui
qui m'a mis en tête de venir au Brésil. J'y suis depuis trois ans ;
j'ai passé un an et demi à l'hôpital ; l'année d'après, je ne gagne pas
de quoi manger, et me voilà tantôt charretier, tantôt maçon. J'ai beau
faire, je n'arrive pas à me payer le billet de retour. Je me demande
maintenant si je vais aller travailler à Nova Friburgo, afin de réunir
trente-cinq mille réis pour la traversée. Raconte-moi ta vie, toi, tu
avais une si jolie maison avec des champs, et tu es venu traîner par
ici ta carcasse !… Tu me paies le dîner ?
– Je n'ai pas un vintém, dit Manuel en essuyant ses larmes.
L'autre malheureux l'accompagna dans une taverne, et tua
sa faim ce jour-là. Puis il l'emmena avec lui, comme maçon, et assura
sa subsistance deux mois, au bout desquels Manuel fut pris de fièvre,
et pensa mourir.
Grâce à la charité du négociant, qui avait plaisanté sur
ses capacités de calligraphe et de comptable, entouré de soins, Manuel
se rétablit, et décida de rentrer au pays. Plein de reconnaissance pour
la bonté de son compatriote, qui avait fait de lui un maçon, il accepta
une avance pour leur retour, à tous les deux.
Quand il apparut chez lui, sans qu'on s'y attendît, sa
mère était encore vivante, et Marcolina do Eirô célibataire. Sa mère le
serra contre son cœur ; et la jeune fille, sachant qu'il se cachait
tellement il avait honte, alla d'elle-même le trouver pour lui assurer
que son cœur était resté le même, s'il voulait continuer à la
fréquenter. Ces honnêtes relations en entraînèrent d'autres qui leur
procurèrent les plus saintes et les plus louables délices. Manuel se
maria, et se retrouva plus que rémunéré de ses souffrances un an durant
au pays de l'or et de l'esclavage.
– Mais la croix ? dis-je. Qui a fait dresser cette croix ?
Manuel da Mó. Il m'a dit qu'il a tenu l'engagement qu'il
avait pris avant de partir pour le Brésil, parce qu'il en était revenu
tellement riche qu'il n'enviait la richesse de personne, et qu'il se
considérait pour cette raison comme l'homme le plus riche de la terre.
Il veut dire que l'expérience du monde, et particulièrement celle de la
vie désolante de ceux qui vont au Brésil pour s'enrichir, est un trésor
que Dieu accorde à ceux qui veulent voir dans le renoncement aux biens
superflus le véritable bonheur.
Voilà pourquoi je t'ai dit, conclut António Joaquim, que
l'histoire de cette croix illustrait une sublime philosophie, que tous
les chrétiens ne découvrent pas.
IX
LA GRATITUDE
– Il me revient une autre histoire de Brésilien,
poursuivit António Joaquim, et j'ai l'impression qu'il va m'en revenir
encore trois du même tabac.
– Je suis impatient ! répondis-je, ne me tenant plus de
joie. Comme je t'aime, António ! Tu es une fleur, une bibliothèque
inédite pour dames ! Je vois que tu t'es fait une spécialité des
Brésiliens bienveillants et honnêtes.
Tant mieux ! me dis-je maintenant. Il y a douze ans, les
lettres nationales, particulièrement dans le genre du feuilleton,
brocardaient les Brésiliens, tandis que l'article de fond les appelait
affectueusement nos frères d'outre-mer, en exprimant une telle
tendresse, si chargée de nostalgie, que cela fendait l'âme de
l'entendre ! Puis comme, en gagnant de l'âge et du sens, les
feuilletonistes étaient passés personnellement aux articles de fond,
tandis que ceux qui les rédigeaient devenaient, les uns, diplomates,
comme Cunha Sotomaior et João Coelho ; d'autres, ministres, comme
António de Serpa et Mendes Leal ; d'autres, évêques, comme
António Alves Martins. Et les feuilletonistes, dans l'espoir de devenir
diplomates, ministres et évêques, on commencé à se montrer avant tout
sérieux, circonspects, et amis de tous les gens qui déversent sur le
Portugal les flots aurifères du Pactole, que l'on appelle vulgairement
de l'argent.
Cela ne pouvait cesser.
L'homme a entamé, ces dernières années, un nouveau
processus de fusion pour se convertir en valeurs. L'homme n'est plus un
bipède sans plumes, ni le roi de la création, ni un homme : c'est de la
monnaie. La seule chose qu'on ne lui fasse pas, c'est de le cogner
contre un comptoir, pour voir s'il sonne de bien, et s'il est de bon
aloi ; mais, au fil des découvertes, on finira par inventer un
instrument quelconque, grâce auquel on pourra donner précisément le
nombre de livres qu'une personne a dans sa poche, et qu'il a laissées
chez lui. Cet instrument nous épargnera la bonne foi nécessaire pour
établir un contrat, la probité commerciale, et les enquêtes coûteuses
que l'on fait sur des individus dont la "fortune" est sujette à caution.
En ces jours heureux, qui ne manqueront pas d'arriver, et
que j'ai le glorieux honneur de prophétiser au genre humain, les pères
des jeunes filles en âge de se marier ne seront plus trompés par leurs
gendres, ni les gendres par leurs beaux-pères ; le capitaliste saura,
le moment venu, si celui qui accepte une lettre de change est
approvisionné la veille de l'échéance ; la prima donna verra d'emblée
si l'imprésario compte la carotter avec l'indiscutable bonne foi de
l'imprésario insolvable. L'on peut attendre un nombre incalculable
d'avantages sociaux de l'invention de cet instrument que l'on pourra
appeler numimètre de numus,
"l'argent" et de metron, "la
mesure".
Tout nous annonce la proche apparition du numimètre. Il
faut inventer quelque chose qui supplée à l'absence de loyauté des
contrats, laquelle se dégrade à mesure que la religion, cette forge où
se trempent et s'épurent les conscience, perd de son éclat.
En attendant, de là-bas, en France, continue de souffler
l'ouragan de l'impiété. Les imberbes commencent à entendre Renan ; et
s'ils ne le portent plus aux nues, c'est parce qu'il s'est montré
modéré dans ses insultes à Jésus Christ. D'ici peu, cette jeunesse
montrera moins d'égards envers le Rédempteur, et, au bout de vingt ans,
elle enverra ses enfants faire descendre de leur piédestal les croix
qui symbolisent la barbarie des civilisations de Léon X et de Louis XIV.
Le dogme une fois éteint, il devient nécessaire de
demander à la science la conscience et le cœur que la religion a
emportés avec elle. C'est alors que l'on assistera nécessairement à
l'invention de l'instrument grâce auquel il nous deviendra impossible
de nous tromper sournoisement les uns les autres.
Je ne fais plus miennes ces divagations qui n'ont rien à
voir avec l'histoire du Brésilien qu'António Joaquim m'a racontée à sa
façon :
– Le Cávado passe tout près de chez moi.
Des gamins sont allés s'y baigner, il y a un bon nombre
d'années. L'un d'eux avait dix ans, et apprenait à nager avec une bouée
de liège. La ficelle qui retenait les flotteurs s'est cassée, alors que
le garçon remuait ses bras à l'endroit le plus profond du cours d'eau.
Les petits nageurs se précipitèrent pour essayer de le retenir ; mais
ils ne pouvaient plus l'arracher au tourbillon. Là-dessus, un homme qui
passait au bord du fleuve se jeta tout habillé dans le gouffre,
plongea, et revint à la surface avec le garçon accroché à un bras. Il
le ramena sur la terre ferme, lui fit vomir l'eau qu'il avait bue, à
l'encontre de ce que prescrit la science ; et, quoi qu'en eût la
science, il le rendit à ses parents, de pauvres journaliers, qui le
préparaient pour l'envoyer au Brésil.
Constantino, c'est le nom du gamin, partit pour Rio de
Janeiro, et regagna sa patrie, marié, avec ses enfants, et très riche.
Il fit construire un palais à l'endroit où il trouva la
chaumière vide de ses parents, qui sont tous les deux morts dans
l'abondance, bien qu'ils n'aient jamais cédé à leur fils, qui avait
voulu leur donner une résidence plus confortable. Ils aimaient leur
foyer, leur banc de chêne, leur toit de chaume, et le figuier qui
donnait de l'ombre à leur fenêtre de plain-pied.
Le commandeur Constantino José Rodrigues se promenait, par
une après-midi du mois d'août, au bord du Cávado, avec son épouse et
ses enfants. Ils s'assirent sur une des berges surplombant le fleuve,
et le souvenir du danger qu'il avait couru à cet endroit lui revint
brusquement. Il raconta l'incident à sa femme qui était saisie
d'angoisse en l'écoutant, et à ses enfants qui s'éloignaient
craintivement du bord. Son épouse lui demanda :
– Serait-il mort, l'homme qui t'a sauvé ? Te rappelles-tu
son nom ?
– Laisse-moi réfléchir… dit le commandeur Rodrigues.
Au bout d'un moment, il ajouta qu'il n'arrivait pas à s'en
souvenir ; mais comme certains des enfants de son âge, qui
l'accompagnaient dans ses baignades, étaient encore vivants, il allait
se renseigner.
– S'il est vivant et se trouve dans le besoin, dit la
Brésilienne, il faut que tu t'occupes de lui. Si cette bonne pâte
d'homme ne s'était pas jeté dans le fleuve, tu ne serais pas le père de
ces anges, ni l'époux de ta Laurentina.
Ému par cette tendre remarque de sa femme, Constantino
partit aussitôt s'enquérir du nom de cet homme. Deux de ses amis
d'enfance se rappelaient cet événement ; mais ils avaient oublié le
sauveteur. Il en parla à l'abbé, lequel, à la fin de la messe de ce
jour, pressé par le commandeur, demanda aux vieillards de l'attendre
sur le parvis, et leur demanda si l'un d'eux avait été, ou savait qui
avait été cet homme si dévoué qui, vingt-six ans avant, s'était jeté
dans le fleuve pour arracher au gosier de la mort le commandeur
Rodrigues.
– L'homme qui a fait cette bonne action ne se trouve pas
ici, dit l'un des anciens, c'était le milicien Januário.
– Je sais bien qui c'est, dit l'abbé. C'est ce brave qui
s'est cassé un bras et une jambe en allant prêter main forte au cours
de l'incendie de la maison de l'artificier, il est resté estropié pour
gagner sa vie de tisserand.
– Cela fait plus de quinze ans, continua le vieillard,
qu'il est parti demander l'aumône çà et là ; alors que vos parents,
Monsieur le Commandeur, étaient encore vivants, il se montrait encore
dans le coin. Que Dieu les garde, ils lui donnaient toujours son tostão ; mais il n'est plus revenu
par ici après leur mort.
Ces informations redoublèrent chez le commandeur le désir
de retrouver le mendiant, de savoir sinon, si, comme c'était
malheureusement le plus probable, il avait succombé aux épreuves de sa
vie de mendiant.
L'abbé écrivit aux curés à bien des lieues à l'entour,
mais pour rien. Le commandeur voulut obliger les parents de Januário,
mais il n'y en avait aucun. Il était presque désespéré de ne pouvoir
noblement exprimer sa gratitude à son bienfaiteur.
Un an après, l'aîné du commandeur s'amusait à parcourir un
replat, sur un poulain encore mal dégrossi et inflexible devant les
quinze ans de ce jeune insolent. Le cheval fut effrayé par un troupeau
de brebis, poursuivies par le terre-neuve du cavalier, il fit de tels
bonds que le jeune homme perdit un de ses étriers, fut arraché de sa
selle, et resta suspendu par un pied à l'autre étrier. Le poulain,
enragé, fumant, se mit à galoper, la crinière hérissée, en le traînant
derrière lui au bord d'un précipice.
En ce moment critique, alors que la mort semblait
inévitable, le cheval reçut, sur la tête, un bon coup de bâton, qui
l'étourdit, et un bras de fer bloqua au mors sa gourmette. Le poulain
ruisselait de sueur, et tremblait convulsivement. Le sauveteur, qui ne
pouvait guère se servir de son autre bras, mit les rênes sous un de ses
pieds, et, avec un petit couteau, trancha les courroies de l'étrier
auquel était accroché le pied en sang du garçon évanoui. Puis il
attacha les rênes à un rejet du tronc d'un sorbier, avant d'aller, en
boitant, examiner le cavalier écorché.
Tu as compris que le sauveteur du fils de Constantino
était Januário, surnommé le milicien, parce qu'il avait servi dans des
milices dans les grandes batailles pour l'Indépendance.
Le vieillard s'aperçut que le garçon avait le crâne
fracturé et le visage raclé, tailladé par les cailloux. Comme un homme
qui a vu beaucoup de blessures, il jugea aussitôt qu'aucune d'entre
elles n'était mortelle. Il lui palpa le corps, et décida
malheureusement aussi vite que son pied gauche était déboîté.
Le gamin reprit connaissance, et se mit à pousser des cris
de douleur, en posant la main sur différents points contusionnés de son
corps. Le vieillard lui apporta de l'eau d'un ruisseau dans son chapeau
pour laver les plaies de son visage, et le calma en lui disant qu'un
homme ne pleurait pas quand il avait mal.
– Que feriez-vous, ajouta-t-il, si vous aviez perdu d'un
seul coup un bras et une jambe comme moi ! Regardez, personne ne m'a
seulement entendu piauler ! J'avais déjà pris alors quatre balles dans
le corps, eh bien, on me les a tirées sans que je lâche une larme !…
D'où venez-vous donc ? demanda le mendiant.
Le garçon désigna du doigt le domaine que l'on voyait au
pied de la falaise de la colline.
– De qui êtes-vous le fils ? reprit le vieillard.
– Du commandeur Constantino José Rodrigues.
– Constantino ! dit Januário, en se le rappelant. Cela
fait dix ans que je ne viens pas ici, c'est pour ça que je ne suis pas
au courant…
– Mon père est revenu du Brésil il y a deux ans.
– Et votre père est de ce hameau ?
– Oui.
– Constantino ! répéta le mendiant. Serait-il le fils de
Jacinto das Pegas ?
– Mon grand-père s'appelait Jacinto.
– Alors c'est lui !… fit le vieillard. Grâce à Dieu, je ne
mourrai pas sans voir le gamin que j'ai sauvé de la noyade !
– C'est donc vous, Januário ! s'exclama le garçon en
embrassant les haillons de son sauveteur.
– C'est moi, mon petit ! Il y a donc encore quelqu'un qui
se souvient de mon nom au pays !? s'écria le vieillard, son visage ridé
tout baigné de belles larmes. Ce sont ces choses-là qui me font pleurer
! balbutia-t-il, s'essuyant les yeux avec le poignet croûteux de son
veston.
L'ancien appela un berger, et le pria d'aller dire à
Monsieur le Commandeur que son fils se trouvait en mauvais état à la
suite d'une chute, et qu'il fallait une monture docile pour le ramener
chez lui. Et il ajouta :
– Et tu diras, là-bas, que c'est Januário, le milicien,
qui t'envoie.
En attendant, Januário coupa la botte pour déchausser le
pied enflé du blessé. Il le trempa dans l'eau, et le banda avec des
mouchoirs en guise de pansement.
Au bout d'une heure, apparurent sur la partie plate du
tertre le commandeur, son épouse et ses enfants, essoufflés et
inquiets. Ils aperçurent en haut d'une berge escarpée, le garçon
assis sur un lit de genêts, le mendiant à côté de lui, et le cheval,
près de là, en train de gratter le sol en hennissant.
Quand il vit ses parents, le jeune homme se mit à hurler :
– Le voilà, le père Januário ! Il est ici, ma mère ! Ne
vous mettez pas en peine, je me sens presque bien !
– Bravo ! murmura le vieillard. C'est comme ça que les
hommes doivent se conduire ! Dites toujours que ça ne vous fait pas
très mal.
Le commandeur s'approcha, les bras ouverts, de Januário,
qui se leva en tremblant de vieillesse et de joie. La Brésilienne vint
s'agenouiller près de son fils, en dépit de la grande affection qu'elle
ressentait pour l'homme qui avait sauvé la vie à son mari. Les autres
enfants étaient effarés de la barbe hirsute du mendiant.
– Ainsi donc, Januário, s'exclama le commandeur, l'ami qui
m'a sauvé la vie il y a vingt-six ans, c'est ce vieillard que je tiens
dans mes bras !
– Vos parents ont largement payé le service que je vous ai
rendu, Monsieur Constantino ! bafouilla Januário, fort ému.
Le fils du commandeur se hâta d'ajouter :
– Mais ils ne vous ont pas payé, pour m'avoir sauvé, moi.
Sans lui, mon père, à cette heure, je me trouverais là-bas au fond de
ce gouffre, en miettes, comme le cheval.
– On vous doit deux vies, Monsieur Januário ! s'exclama le
Brésilien. Je vous suis encore plus redevable pour la vie de mon fils,
qui m'est bien plus précieuse que la mienne !
Son épouse n'éprouva aucune répugnance à aller serrer la
main sale et racornie du vieillard, en s'exclamant :
– Le bon ange de notre famille va en faire dorénavant
partie.
Le blessé s'assit sur le bât d'une jument, et ils prirent
tous la direction du village, tout doucement, pour ne pas secouer
l'estropié.
Si tu écris un jour cette histoire, tu y mettras une dose
de sentiment que je ne saurais y mettre. Je t'ai raconté ce qui est
arrivé, comme je l'ai entendu, comme ses héros me l'ont rapporté.
J'aimais à m'asseoir, il y a six ans, à côté de Januário
qui prenait le soleil sur la terrasse du commandeur, pour l'écouter
parler des batailles du Roussillon, et celles pour repousser les
offensives des grands généraux de l'Empire. Les fils du commandeur
l'écoutaient, comme s'ils prenaient plaisir à entendre les exploits
d'un aïeul, couvert de médailles, faisant onduler son panache.
La chambre de Januário était l'une des plus belles du
palais du commandeur. Sa place à table se trouvait entre celles des
deux hommes qu'il avait sauvés. La première assiette que l'on servait,
c'était la sienne. Les prières précédant les repas étaient prononcées
par celui qui les entonnait avec un ton sénile d'une religiosité
communicative.
En fin de compte, il me reste à te dire que l'enterrement
le plus somptueux de ma paroisse, ce fut celui de Januário, et que
rares seront les larmes aussi sincères que celles qu'on a versées sur
sa sépulture.
X
LES TRÉSORS DU PRINCE TURC
– N'as-tu pas une histoire de sortilèges à me raconter ?
dis-je à mon ami.
– Sur des sortilèges, je ne me rappelle aucune histoire ;
mais, dans le genre de la magie, je puis te raconter ce qui est arrivé
à mon oncle João Manuel avec le livre de Saint Cyprien. Tu sais qu'il
n'y a jamais eu de Cyprien qui ait écrit un tel livre.
– Je connais deux Cyprien : l'un d'eux a souffert le
martyre à l'époque de l'empereur Valérien, il a écrit, entre autres, le
livre Des Tombés. L'autre a été évêque de Toulon, et je ne suis pas sûr
qu'il ait écrit sur la magie.
– Eh bien, la croyance populaire et les spéculations de
quelque coquin de conteur moyenâgeux ont imaginé la fable selon
laquelle Saint Cyprien, qui s'adonnait à la magie comme Saint
Gilles, avait laissé un petit livre, qui fait découvrir des trésors. Je
n'ai jamais lu ce petit livre ; mais mon oncle João Manuel a juré
l'avoir vu entre les mains d'un abbé de Barroso ; unissant leurs
efforts, l'abbé et lui ont décidé d'arracher aux entrailles de la terre
des coffres d'or enterrés par les Maures, au temps où les Goths sont
descendus de leurs montagnes, et les avaient refoulés d'un seul coup, à
la force des armes, dans leurs régions africaines.
Comme tu vois, mon oncle João était un esprit subtil, mais
un peu obscurci par le désir d'être riche, et de fonder un couvent de
moines franciscains. Les revenus de son patrimoine auraient à peine
suffi à assurer la subsistance de deux moines mendiants ; ce qu'il
voulait, c'était pouvoir entretenir une centaine de ces saints hommes,
un souhait inoffensif, qui l'absout de sa soif de richesses, et j'ai la
charité de croire que ce sera aussi utile à son âme qu'il a voulu être
utile aux corporations monacales.
Unissant donc leurs efforts, l'abbé de Barroso et lui,
approfondirent la question et après s'être concertés à maintes
reprises, décidèrent que les énormes trésors mauresques, mentionnés par
Saint Cyprien, se trouvaient dans les décombres du château en ruines de
Vermoim.
Vermoim est un grand amas de rochers qui domine la
paroisse de ce nom, à une lieue de Famalicão, à gauche de la route de
Guimarães. De la crête de cette montagne, l'on découvre de véritables
trésors, des campagnes fertiles, des bourgs dont la blancheur se
distingue entre les forêts, des bosquets couronnés par les aiguilles
des tours, des rivières qui serpentent entre les pâturages et les prés,
le Minho, enfin, un spectacle prodigieux, qui fait aimer le Portugal,
et demander à Dieu de ne pas nous laisser avancer dans le chemin du
progrès matériel au point que nous nous retrouvions en fin de compte — en fin de compte est l'expression
propre — sans patrie, pour contribuer
au perfectionnement de la matière.
Mon oncle, l'abbé, et un sapeur auquel mon oncle faisait
confiance emportèrent des vivres pour un jour, des outils pour les
premières fouilles, et gravirent, il y a trente ans, la chaîne de
Vermoim. Le prêtre avait plus de clartés en Histoire que mon oncle. Il
s'assit sur un rocher, après leur déjeuner, et raconta qu'un prince
turc du pays des Maures avait vécu à cet endroit avec beaucoup de
richesses volées aux chrétiens. Or ce prince turc du pays des Maures,
assailli par les Lusitaniens commandés par le roi Vamba, s'était enfui
au grand galop, après avoir enterré ses trésors. Le roi vainqueur
confia la défense du château en le lui cédant à Dom Vermuí Frojaz, un
noble de race wisigothe, qui le transmit à ses descendants ; mais, sous
le règne de Dom Sancho Ier, ceux du prince turc arrivèrent au Portugal,
déguisés en pèlerins, et vinrent se loger dans les demeures des
Pereira, de la famille de Dom Vermuí, qui les accueillirent avec les
marques d'une grande vénération, et fort dévotement. De ces demeures au
château, il y avait une demi-heure de marche, par un sentier accidenté.
À une heure creuse, ils sortirent de chez leurs hôtes, et prirent le
chemin du château, qui n'était pas protégé par des sentinelles en temps
de paix. Les instructions qu'ils avaient sur l'endroit où se trouvaient
ces richesses étaient claires et sans équivoque. C'est à un angle de la
cour de la citerne, sous une meurtrière, que le prince turc avait
enterré les coffres du dernier roi goth, trahi par le comte Julião et
l'évêque Opas. Dès que les descendants du Maure — disons du Maure, pour
ne pas le qualifier toujours de prince
turc en hommage au curé de
Barroso — eurent planté le fer, dans les règles de l'art, dans le
ciment entre les dalles qui protégeaient le trésor, ils sentirent que
la terre tremblait ! Les pans de murs, les barbacanes, les jambages des
arbalétrières, les créneaux et les tours, tout s'est écroulé à grand
fracas. Les descendants d'Agar eurent à peine le temps de recommander
leur âme au démon, et restèrent écrasés dessous, en attendant la
trompette du dernier jour. Le château écroulé dégageait le lendemain de
ses entrailles des vapeurs noires. Les bourgs, remplis d'effroi,
pensèrent qu'un incendie avait dévoré les bâtiments de Dom Vermuí
Frojaz.
Les faits se présentant ainsi, avec une telle clarté
historique — quoique cette évidence eût échappé aux chroniques des
moines qui ont écrit la mythologie du Portugal — l'abbé de Barroso dit
que les trésors devaient se trouver à une courte distance de la
citerne, dont les bords étaient encore visibles sur la surface
accidentée du sol où le château s'était enseveli. Mon oncle se conforma
à cet avis judicieux ; ils commencèrent les travaux d'excavation après
avoir bu un bon trait à leur outre, un trésor qu'ils avaient pris avec
eux, sans que Saint Cyprien l'eût mentionné.
Le sapeur ouvrit une fosse de huit paumes de long sur six
de large. Le déblayage donnait des bouts de brique, et de
l'argile noire, aussi consistante que du fer fondu pour en faire des
casseroles. Quand le sapeur était fatigué, mon oncle et l'abbé se
relayaient. À la tombée du soir, le trou avait quatre paumes de
profondeur, et continuait d'offrir des morceaux des brique et du
mortier. Tandis que mon oncle et son associé dans la recherche de
trésors ruisselaient de sueur, le sapeur se cachait derrière le rocher
pour siroter à l'outre, et philosopher en la calant sur ses genoux, la
dorlotant affectueusement, comme si c'était l'outre qui éclairait sa
raison, et non pas le rayon de lumière d'une philosophie infuse ; une
philosophie qui, pour être infuse
chez bien des gens, ressemble à celle
de l'outre du sapeur. Excuse-moi la fadeur de ce jeu de mots.
Le sapeur riait, et murmurait, les lèvres collées au
goulot de la gourde pour ne pas être entendu : "Ce sont de vrais
abrutis, ces gens-là !"
Entre-temps, l'abbé de Barroso descendit dans la fosse, et
commença à remonter des galets barbouillés de taches jaunes, en couches
superposées. Les géologues auraient parlé de silicates ; dans notre
aveugle ignorance, nous les appellerions des pierres ; mais l'abbé et
mon oncle dirent que c'était de l'or et de l'argent fondus. En
entendant leurs cris de joie, le sapeur courut les rejoindre et les
trouva avec deux pierres à la main. Mon oncle demanda à l'employé s'il
avait jamais vu de telles choses dans sa vie." Ce sont des cailloux"
répondit-il. Les deux érudits échangèrent un sourire de pitié, comme le
feraient messieurs Bocage et Andrade Corvo, s'ils me disaient que les
zoologistes appellent un certain insecte coléoptère, et que je leur
répondais que cette bête était un scarabée.
L'abbé dit sur un ton formel à mon oncle :
– Voilà de quoi il s'agit, João. Il y a là de l'or et de
l'argent fondu. Ces pierres, c'est de l'argent.
Il ajouta, en se tournant vers le sapeur :
– Ne ris pas, animal ! Si tu gardes le secret, tu auras de
quoi manger toute ta vie.
– J'échange ma part contre une bonne gorgée de vin, dit le
philosophe.
C'était la nuit. Ils descendirent de la montagne et
allèrent coucher à Famalicão pour revenir, le lendemain, avec des
vivres.
Comme la nuit porte conseil, mon oncle et le curé
décidèrent de partir pour Porto au petit matin, et de soumettre les
pierres à l'analyse de spécialistes qui en détermineraient la valeur.
L'air mystérieux qu'ils avaient en se présentant à un
orfèvre facétieux de la rue das Flores représentait une solennelle
recommandation pour leur sottise. La première envie de l'orfèvre, ce
fut de les frapper sur le crâne avec les deux cailloux ; cependant,
comme il aimait à rire, il affecta d'être effaré par la valeur de la
trouvaille, examina les pierres, et s'exclama, d'une voix caverneuse :
– Où avez-vous trouvé ces richesses ?
– Ne te l'ai-je pas dit ? s'exclama l'abbé, se tournant
vers mon oncle, qui leva subtilement l'index tendu vers son nez pour
mettre son compagnon en garde contre les questions de l'orfèvre.
– C'est apparu sous nos yeux, répondit le prêtre.
– Mais où ? demanda l'orfèvre. Ce minerai, c'est…
– De l'or et de l'argent fondu, dit mon oncle.
– C'est ça, acquiesça l'orfèvre. De l'or et de l'argent
fondu. Mettez-vous en vente ces deux morceaux ?
Mon oncle fit un autre signe de dénégation, que la
pénétration du prêtre traduisit en ces termes :
– Non : nous voulions juste connaître la valeur de ces
objets.
– Ces objets, répondit posément le farceur, ne pourront
être évalués qu'après avoir été refondus et nettoyés. Mais là, je vous
le dis sincèrement, il y a du grain à moudre.
– Vous doit-on quelque chose ? demanda mon oncle.
– Ce n'est rien. Si vous décidez un jour de les vendre, à
leur prix, souvenez-vous de mon établissement ; mais prenez garde
pendant vos fouilles, si c'est un terrain en friche, parce que l'État
va vous saisir la mine, et s'en déclarer propriétaire. Travaillez la
nuit, en vous cachant bien. Si vous voulez m'associer dans vos
recherches, à mesure que vous extrairez le métal brut, je me chargerai
de le nettoyer.
– Nous allons y réfléchir, répondit mon oncle.
En sortant de la boutique, le prêtre dit à son ami radieux :
– Regardez-moi ce filou, qui tâte le terrain, pour nous
rouler !…
– Il ferait beau voir !… fit l'autre. Nous n'avons pas
besoin d'associés. Des que nous aurons d'autres morceaux, nous irons
les vendre à l'étranger, parce qu'au Portugal, si on nous découvre, on
va nous obliger à rendre des comptes sur la mine.
Ils s'entendirent aussitôt pour dire au sapeur que les
pierres ne valaient pas deux vinténs, et firent mine de renoncer à
creuser, pour rester seuls sur le chantier.
Effrayés par la mise en garde de cet escroc d'orfèvre, ils
passaient la nuit dans les ruines du château de Vermoim et, au point du
jour, dès que les bergers montaient avec leurs troupeaux sur les
hauteurs voisines, ils prenaient leurs fusils et partaient à la chasse,
sans lâcher des yeux leurs excavations, et la caverne qu'ils s'étaient
ménagée avec deux rochers, où ils cachaient les pierres qu'ils avaient
déblayées.
Mon oncle écrivit alors une lettre à un moine franciscain
de Guimarães, pour le prévenir que, dans deux ans, son projet de fonder
un couvent avec cent moines allait se réaliser. Il lui demandait, en
attendant, de ne pas cesser de prier pour une entreprise contre
laquelle le pouvoir de Satan ne manquerait pas de conspirer.
Le moine éclata de rire, et demanda au Seigneur de donner
du bon sens à mon pauvre oncle.
Les desseins du curé de Barroso étaient moins modestes,
mais également profitables à la chrétienté. Son intention, c'était
d'aller à Rome, et d'en revenir avec une mitre, ou deux, vu qu'il avait
un neveu dans les ordres.
Au bout de trois semaines de travail, les pierres qu'ils
avaient choisies pesaient dix arrobes[16]. Ils les transportèrent petit
à petit, avec un grand luxe de précautions, dans un village au pied de
la chaîne, et là, ils en chargèrent des bêtes de somme, pour les
emporter, par des chemins de traverse, dans la chaumière d'un moulin
abandonné au fond d'une gorge de la montagne. Pardonne-moi ces détails.
Je songe souvent au malheur de mon oncle, qui a été emporté par son
amour des moines. Il ne voulait rien pour lui, il en avait bien assez
avec le peu dont il vivait. C'est l'idée du couvent qui l'a tué !
– Pourrais-tu me dire si Octave Feuillet connaissait
l'histoire de ton oncle João, lui demandai-je.
– On dirait une question du curé de Barroso ! répondit
António Joaquim.
– C'est que le romancier français parle d'une illustre
vieille qui est morte dévorée par le désir, qu'elle ne pouvait
satisfaire, de fonder une cathédrale. Serais-tu en train de lire le
Roman d'un jeune homme pauvre, improvises-tu une histoire qui
m'obligera à mentir à mon public pour la première fois ?
– Non, je te raconte un malheur. Mon oncle João et le curé
de Barroso sont partis pour l'Espagne dans l'intention de vendre dans
les principales villes d'Europe leur or fondu. Le premier bijoutier
auxquels ils s'adressèrent à Madrid les détrompa en leur disant que
ces pierres étaient bonnes à jeter aux meutes de chiens errants, qui
infestaient les rues, la nuit.
Les malheureux, stupéfaits, réagirent contre la
plaisanterie de l'orfèvre, et s'en furent consulter d'autres. Quelques
heures après, mon oncle et l'abbé étaient pris à partie par des
galopins qui sortaient de tous les coins de rue pour leur demander une
peseta d'or fondu.
Ils fuirent Madrid, épouvantés, quand, les harcelant
jusqu'à leur auberge, les gamins, désirant venger l'offense de
1640[17], ne respectaient
plus leurs victimes portugaises, et
laissèrent dans leur chambre les dix arrobes de cailloux.
Voici le plus triste : quand mon oncle arriva chez lui, il
avait perdu la raison. Il avait, durant son absence de vingt jours,
vieilli de vingt ans. Il s'enfuyait chaque fois qu'on le perdait de vue
dans sa maison, vers un couvent de franciscains de Braga, ou chez
d'autres, où il allait recruter les cent moines qui devaient fonder sa
communauté. Il a fini par mourir. Le curé de Barroso avait l'âme et le
corps plus solide. Ses croyances religieuses furent un tant soit peu
ébranlées à cause de Saint Cyprien, dont l'imposture lui parut non
seulement méprisable, mais attentatoire à la foi et à la piété d'un
chrétien sincère. À la suite de quoi, il se fit libéral, et participa
aux batailles de la liberté en tant que chapelain d'un régiment ; il
parvint à la dignité de chanoine de la cathédrale patriarcale, et l'on
songeait à le nommer évêque, lorsque la miséricorde divine, prenant en
pitié son épiscopat incertain, lui enleva la vie.
L'homme qui a le plus sur la conscience la démence de mon
oncle João et le canonicat du curé de Barroso, c'est l'orfèvre de Porto.
XI
L'ENFANT TROUVÉ
Tu vas entendre maintenant l'histoire d'un enfant trouvé
de ma paroisse,
dit mon ami.
– Tu pinces toutes les cordes sur la lyre des romanciers
et des dramaturges modernes, lui fis-je observer. L'enfant trouvé est
un riche argument qui fait, depuis vingt ans, gémir les presses et
pleurer les gens. Du Martin
d'Eugène Sue à ton enfant trouvé, dont
j'ignore le nom, la sympathie qu'ils forcent, il n'y a aucun fils
légitime qui la mérite. Cette circonstance met en lumière la
démoralisation de notre époque, si elle ne démontre pas surtout la
stérilité de notre imagination. Les écrivains rivalisent avec les
nourrices pour aller chercher des enfants au tour. Puis, ils prennent
les marmots, et les jettent, exténuées de faim et de fièvre, au visage
de la société.
António Joaquim m'interrompit :
– Il n'en est pas question dans mon histoire. Luís
surnommé "l'enfant trouvé" a été gardien de chèvres dans mon domaine,
il est aujourd'hui… j'allais te dire tout de suite qu'il contredit
toutes les règles de la narration. Je ne sais de qui il était le fils,
et l'intrigue n'exige pas qu'on lui invente des parents. Ce petit a été
nourri au sein par une pauvre journalière qui, à sept ans, en a fait un
domestique.
À vingt, il a pris congé de mon père pour s'engager chez
une veuve qui avait de fort minces ressources qui suffisaient à peine à
la sustenter. Mes gens lui ont reproché de renoncer à un bon salaire
pour partager la misère du hameau où il se rendait, où jamais il n'y
avait eu de domestique. Il répondit que, si la veuve n'avait pas un
homme pour cultiver ses terres, elle mourrait dans le dénuement.
La veuve avait chez elle deux filles, et un fils au
Brésil. Une des filles, qui était jolie, se maria avec un riche
cultivateur, un homme sans entrailles, qui ne refusa pas seulement
d'aider sa belle-mère, mais lui extorqua quelque cent mille réis, la
somme à laquelle devait monter la dot de son épouse. Son autre fille
était on ne peut plus laide, mais avait bon cœur, alors que sa sœur
était une sans cœur, une égoïste.
Luís avait l'ensemble de ses gages entre les mains de mon
père ; il les toucha, et s'acheta des vaches pour effectuer les labours
chez sa nouvelle patronne. Il défricha quelques terres laissées à
l'abandon, loua des chênaies, et travailla inlassablement. À le fin de
la première année, la veuve n'osait pas lui proposer des gages : elle
l'appela son fils, et lui offrit la main de sa Teresa. Pauvre femme !
Elle était la seule à ne pas croire que sa fille était laide ! L'enfant
trouvé vit Teresa avec les yeux de sa mère. Ils avaient tous les deux
discerné en l'autre un cœur semblable au leur. Ils avaient passé,
seuls, une année à travailler ensemble, sous la chaleur et le froid.
Ils avaient joyeusement entamé et mené à bien la tâche de trois cent
cinquante jours. Le visage de Teresa, perlé de sueur, et peut-être de
larmes de gratitude, avait paru joli à cet ouvrier désintéressé. Ils
s'aimaient. Pour Teresa et sa mère, Luís n'était pas l'enfant trouvé,
c'était l'ami, qui compensait la détresse dans laquelle l'avaient
laissée son fils et sa fille, le premier les avait oubliées au Brésil,
l'autre avait fait un riche mariage dans la paroisse voisine.
Luís accepta la proposition de sa patronne. On lut les
bans. Dès que la nouvelle de ce scandale est connue de la fille riche,
elle s'en va en compagnie de son mari insulter sa mère, sa sœur et
l'enfant trouvé. Elles écoutèrent les insultes, et Luís les menaces en
silence ; mon saint abbé, dont je te parle dès qu'il se trouve des
vertus à mentionner dans ma terre, prit, lui, à cœur la défense des
faibles, et les maria
L'on est naturellement enclin à augurer une existence
joyeuse sous les douces brises de la prospérité à ces nouveau-mariés,
qui s'aimaient tant, et ne cessaient de peiner. Il n'en a rien été.
Le veuve sentit bientôt les effets de l'âge ; les vaches
moururent d'une épizootie, ; l'on essuya cette année là une sécheresse
extrême et la faim ; les taupins mangèrent les champs de patates ; les
chenilles dévorèrent les potagers ; les taupes retournèrent les terres
à lin ; deux pipes de vin tournèrent ; cette chaîne d'infortunes fut
couronnée par les fièvres de Teresa qui ne pouvait plus seconder les
efforts de son mari pour écarter la perspective de la faim au cours de
l'année suivante.
La fille riche apprit l'état de sa mère et, pour la
soigner et la réconforter, elle lui fit dire de mettre dehors l'enfant
trouvé, qu'elle lui enverrait alors quelque chose.
La veuve avait caché à ses bons fils ce message ; mais
Luís, qui l'avait appris indirectement, dit à sa femme :
– Nous allons gagner notre vie ailleurs puisque nous ne
pouvons plus rien faire pour notre mère. Je retourne servir mes anciens
maîtres, et tu viendras avec moi. Si Dieu ne nous donne pas le même
temps l'année prochaine, nous reviendrons cultiver nos terres.
Quand on la mit au courant, l'infirme anxieuse, qui se
rongeait les sangs, voulut sauter de son lit pour retenir son gendre,
qui pleurait sur le plancher, au dehors. La vieille dit qu'elle
vendrait une parcelle à mon père, ou l'engagerait pour s'en tirer. Luís
s'en alla, baigné de larmes, trouver son ancien patron, et lui demanda
assez de pain pour attendre les semailles de l'année suivante, et
sustenter sa femme et sa belle-mère. On lui accorda tout, parce que
l'enfant trouvé employait des expressions graves et laconiques qui
avaient la même valeur que les meilleures plaidoiries.
Quand elle vit assurée la subsistance de sa famille, la
vieille, qui avait des accès de fierté, acheta trois rouleaux de pão-de-ló[18], qu'elle envoya aux trois petits-fils
qu'elle avait de sa
fille riche, pour répondre à la proposition de ne pas la laisser mourir
de faim, à condition d'expulser la mari de sa fille pauvre. Cela me
rappelle le cas de Martin Freitas, encerclé au château de Coimbra, qui
a envoyé à son ennemi une appétissante truite grillée, quand les
soldats de Dom Afonso III pensaient que la faim réduirait les assiégés
à lui livrer la place forte. La mauvaise fille renvoya les rouleaux de
pão-de-ló, en disant que ses enfants n'acceptaient pas de cadeaux
d'enfants trouvés.
– Mangez-la, vous, dit la vieille aux siens, et donnez
m'en un morceau que je puisse boire à votre santé, mes enfants ! Que
Dieu veuille que les petits-enfants ne paient pas la bouche de leur
mère.
– Tu vois là que l'infirme, en plus de sa fierté, avait un
assez bon estomac pour le pão-de-ló et les outrages de sa fille.
L'année suivante prodigua généreusement les trésors de la
Providence. les récoltes furent on ne peut plus abondantes. Luís paya
les graines qu'il avait semées, et s'acheta une paire de vaches. Il
remit sur pied l'organisation de sa vie, qui portait ses fruits, jeta
un petit manteau en peau de castor sur les épaules de sa femme, et
fabriqua de ses mains une confortable voiturette, sur laquelle il
amenait sa belle-mère aux champs, où il lui tressait, avec des
branches, un abri ombragé pour les heures chaudes.
C'est cette année-là que Teresa eut son premier fils. Mon
abbé, qui voulait que personne n'entrât en conflit avec son prochain,
et absolument pas avec ses parents, eut l'idée de faire la paix entre
la mauvaise fille et la bonne mère, en émettant la suggestion de
proposer aux riches d'être les parrains de l'enfant. Luís y consentit
gaiement, l'infirme joignit les mains, en s'exclamant :
– Pourvu que je voie encore ma fille Josefa et mes trois
petits-enfants avant de mourir !
L'abbé partit avec l'invitation, et revint hors de lui. Il
prophétisait que Dieu allait abattre les superbes, et relever les
humbles. Josefa et son mari avaient repoussé, furieux, la proposition,
en criant qu'ils avaient honte d'être les parents de Luís, l'enfant
abandonné.
– Nous verrons qui Dieu abandonne… avait répondu l'abbé,
en essuyant la poussière de ses souliers sur le seuil de la porte.
À la tombée du jour, Dieu envoya chez les pauvres, tout
heureux, un parrain pour leur enfant.
C'était un homme bien mis, d'âge moyen, qui descendit
d'une litière, et demanda madame Custódia Ferreira.
– Ma mère est alitée, elle est infirme, dit Teresa.
L'homme entra dans la cuisine, et demanda s'il pouvait se
rendre au chevet de l'infirme. Teresa prit une chandelle, et alla dire
à sa mère qu'il y avait là un fidalgo.
– Ce n'est pas un fidalgo, précisa l'inconnu, c'est son
fils.
L'infirme oublia sa paralysie, et voulut sauter de son lit, en
s'exclamant :
– Béni soit le Seigneur !
Le Brésilien entra dans la chambre, et s'agenouilla en
baisant la main convulsée de la vieille.
L'abbé, alerté par les clochettes de la litière, se
précipita chez la veuve et assista à cette scène émouvante et
touchante. Manuel Ferreira — c'était le nom du négociant — demanda des
nouvelles du reste de sa famille. L'abbé lui exposa son histoire durant
les trente dernières années. Il parla du mariage de Josefa, et de sa
méchanceté invétérée. Il exalta les vertus de Luís, et la douceur
filiale de Teresa. Il n'oublia pas — aigri qu'il était par son
ressentiment — le méchant incident trahissant l'orgueil de Josefa, qui
refusait de faire de l'enfant un chrétien que Teresa allaitait.
Manuel Pereira posa la main sur le visage de l'enfant, et
dit :
– Nous serons après-demain les parrains de cet ange, ma
mère.
On célébra le baptême, avec toute la pompe possible dans
le village. J'étais tout petit, et je me rappelle être allé, avec mon
père, au dîner que l'on servit, dans le salon de la demeure, aux
personnes les plus haut placées de la paroisse, tandis que, dans la
cour, les pauvres se régalaient de la nourriture et des cadeaux que le
Brésilien leur fit distribuer. Je me souviens avoir entendu Manuel
Ferreira raconter qu'il avait passé vingt-neuf années terribles à
lutter contre les revers ; que, durant ce long espace de temps, il
n'avait écrit que deux fois à son père, en lui disant qu'il était
malheureux ; puis, ne pouvant subvenir aux besoins de sa famille, il
s'était abstenu d'écrire. Il ajouta qu'il s'était, contre tout espoir,
enrichi, grâce à l'héritage d'un ami ; il avait, sans attendre, liquidé
ses avoirs, il était revenu dans sa patrie, le cœur plein d'inquiétude
sur la vie de ses parents.
La petite vieille assista au dîner; et, voulant, à la fin,
imiter les toasts que mon père, l'apothicaire, et l'abbé avaient portés
au Brésilien, elle proposa celui-ci :
– À la santé de tous mes enfants, pour qu'ils vivent
longtemps, et que soient bons ceux qui ne l'ont pas été.
L'abbé salua avec enthousiasme le vœu honorable et pieux
de la vieille, mais le Brésilien, levant son verre à ses lèvres, dit :
– Je ne bois qu'à la santé des bons enfants.
– Et de ta sœur Josefa, ajouta sa mère.
Le Brésilien ne répondit pas…
Quelques jours après, le Brésilien alla voir dans les
faubourgs de Braga un magnifique domaine. Le propriétaire le lui céda à
un prix exorbitant, un caprice hors de prix, qui dénonçait les
importants capitaux de l'acheteur. Manuel Ferreira remit, par une
donation, ce domaine à sa sœur Teresa, et voulut qu'elle allât s'y
installer avec son mari et sa mère. L'enfant trouvé voulut s'atteler à
nouveau à son travail de laboureur ; mais son beau-frère se convainquit
qu'il accepterait la prospérité ainsi que le repos, et le confort que
ses biens lui permettaient. La veuve fut presque obligée par son fils à
l'accompagner en France, et revint, au bout d'un an, en bien meilleur
état, elle s'appuyait sur des béquilles, mais avait assez de forces
pour visiter tous les jours le Lausperenne,
et remercier le Bien
Suprême pour les joies de sa vieillesse. L'amour, les caresses, les
manifestations d'une tendresse extrême n'arrivèrent cependant pas à
prolonger la vie de cette heureuse mère au-delà de ses
soixante-quatorze ans.
Après sa mort, son fils fit évaluer la part qui revenait à
Josefa, et lui envoya la somme correspondante ; il fit ensuite raser la
maison, disant qu'il ne devait rester aucun vestige de la maison où
était née une fille qui avait injurié sa vieille mère pauvre. Du
terrain et des sillons, il fit faire des lots qu'il partagea en
joyeuses petites chaumières destinées aux pauvres de la paroisse.
La vie malsaine qu'il avait vécu vingt-neuf terribles
années au Brésil, dans la brousse, ses dangereux assauts contre la
fortune contraire, lui avaient miné la santé, et créèrent un terrain
favorable aux graves maladies que le repos ne guérit pas.
À près de cinquante ans, il perdit tout espoir de se
remettre, et fit un testament par lequel il léguait sa fortune
considérable à sa sœur et à son filleul. Il mourut dans les bras de
tous, bénissant le plaisir de poser son visage mort sur le cœur de sa
famille.
Tu seras maintenant effaré du changement que la fortune
produisit sur l'esprit de Luís, l'enfant trouvé.
– Il est devenu méchant ? demandai-je.
– Pas du tout ; il est redevenu cultivateur. Dès que son
beau-frère se trouva assez loin pour ne plus pouvoir le critiquer, ; il
enleva la veste qui l'oppressait en le serrant aux épaules, s'installa
à sa charrue, comme ferait Tantale, si on le laissait enfin boire et
manger les fruits de son supplice. Il avançait efflanqué, courbé, et
s'engraissa dès qu'il put débroussailler deux charrettes de buissons,
et passer les chaleurs de l'été à sarcler le maïs avec ses gens.
Se voyant plein d'argent, et sollicité par beaucoup de
firmes illustres pour faire la charité à des œuvres pies, Luis
Ferreira, qui avait emprunté ce nom à son épouse, donnait aux
nécessiteux plus qu'ils ne demandaient. Moyennant quoi, en dehors du
cent pour un promis par notre Divin Maître, on le nomma commandeur.
Luís accepta et paya le diplôme comme il eût accepté et payé la bulle
de la sainte croisade, ou le diplôme de frère du Troisième Ordre. Le
moment où il comprit qu'il n'était pas un vulgaire mortel, ce fut quand
on lui lut — il ne savait pas lire — les adresses des lettres où on lui
donnait le titre de très digne
commandeur de l'Ordre du Christ ; mais,
comme il était chrétien, il se dit qu'appartenir à l'ordre du Christ
était une bonne chose à un prix si modeste. Cependant, lorsque
certaines personnes distinguées lui donnèrent de l'excellence, il
regarda sa femme et pouffa, il rit tellement, et si longtemps, que la
bonne Teresa crut qu'il n'allait plus pouvoir se retenir, sans tenir
compte de l'endroit où il se trouvait.
Laissons le commandeur rire de l'excellence, avec plus
d'entrain qu'Aristophane, Érasme et Boileau riaient de la folie du
genre humain, et allons voir si elle s'est réalisée, la prophétie de
mon abbé, qui avait dit : "Que Dieu abatte les superbes, et relève les
humbles."
XII
– João da Quintã, le mari de Josefa, descendait d'un
certain Jerónimo Carvalho, qui fut pendu à Lisbonne il y a deux cents
ans.
– Pendu il y a deux cents ans ! m'écriai-je, m'apprêtant à
entendre la tragédie d'un homme digne d'une plus illustre postérité. Tu
vas donc me raconter une histoire où il est question de gibet !… Il
manquait ce ton d'élégie romantique. Pendu il y a deux cents ans ! Il a
dû conspirer contre le trône restauré par Sa Majesté Dom João IV !…
– Pas vraiment : Jerónimo de Carvalho était gardien à la
douane. Il a volé dans ses entrepôts des étoffes qui allaient être
expédiées. Les négociants volés intentèrent une action en justice, et
on dressa la potence à son intention conformément au 5e livre des
ordonnances. C'était aussi facile, en ce temps-là, de pendre un voleur
qu'aujourd'hui d'épingler une décoration au revers d'une veste. Temps
obscurs où les potences étaient comme des piliers pour les lampions,
avec lesquels la justice éclairait le chemin du devoir. Aujourd'hui la
potence n'est rien d'autre qu'un prétexte à de bruyants discours, à des
pleurnicheries dans les romans, où le bon sens gigote, à force d'être
étranglé. Moi je suis de ceux qui se prononcent pour la nécessité de la
potence. Si tu veux, nous allons discuter là-dessus.
– J'aurais préféré une histoire, cher ami.
– À ta guise : il est certain que Jerónimo Carvalho a été
pendu[19]. Il avait une
femme et des enfants, qui partirent de Lisbonne
pour cacher dans les brousses du Minho leur ignominie et une grosse
somme d'argent qu'ils purent soustraire à la saisie des négociants
détroussés par le gardien des entrepôts. Invitée par la douceur et les
charmes du lieu, la famille du pendu s'arrêta sur les berges du Cávado,
et fit édifier une chaumière que mon grand-père vit encore, au pied
d'une colline ; on l'appelait la Quintã.
La veuve de Carvalho vécut
encore de nombreuses années, avec toutes les apparences d'une pauvreté
pénitente ; en mourant, elle laissa un fils, qui loua les chênaies des
environs, et se construisit un meilleur logement tout en haut de ses
landes. Le fils du pendu se maria avec une gitane, qui fuyait les
peines horribles prévue par les lois du royaume, et poursuivie par les
agents du corrégidor de Braga. La gitane qui s'était réfugiée dans la
chaumière du fils du supplicié, pour trouver un mari, avoua, dans une
confession publique, ses pactes avec Satan, et rentra au sein de
l'église, en faisant des figues au démon. De cette union naquirent des
fils et des filles. Cent ans après, la maison de la Qintã était une des
premières du district. Le pécule de Jerónimo Carvalho s'était converti
en campagnes d'une extrême fertilité, en prairies, en forêts.
Les arrière-petits-enfants furent cependant de grands
dissipateurs, qui dilapidèrent le plus clair de ce grand domaine. Ils
moururent, et un prêtre hérita des restes du trésor gaspillé du gardien
des entrepôts. Ce religieux était la terreur de l'enfer. Il suffisait à
une possédée de lui passer son étole autour du cou, ou de sentir le
contact de ses mains démonifuges, pour se retrouver guérie. Parmi ses
énergumènes, il eut la chance de laver l'une des souillures de la
vermine infernale. C'était une riche veuve, sans enfants, qui lui en
fut si reconnaissante qu'elle fit de lui son héritier. Le Père António
da Qintã, que mon père a connu, rétablit la maison dilapidée par ses
grand-parents, et fit venir chez lui un neveu pour la lui laisser. Les
héritiers présomptifs de la veuve intentèrent une action contre le
successeur du religieux, alléguant la faiblesse d'esprit de la
testatrice et les pieuses manipulations auxquelles le prêtre avait eu
recours pour lui faire perdre la tête. Le litige se prolongeait depuis
quatre-vingts ans, englué dans les chausse-trapes de la jurisprudence,
quand Josefa Ferreira, la belle sœur de Luís, l'enfant trouvé, se
maria. João da Qintã, le descendant du pendu au sixième degré, par la
branche aînée, ne s'était pas inquiété du procès, qui avait été
enseveli, depuis 1830, dans les armoires des palais de justice ; et,
cependant, un Brésilien, apparenté aux héritiers naturels de la veuve,
dépensait son argent sans compter pour que la plainte ne soit pas
classée, car il ne savait pas à quoi consacrer ses loisirs. Que ce soit
parce que la justice était du côté du Brésilien, ou que son argent et
son industrie créent de toutes pièces une justice à sa main, ou —
c'était le plus probable — que la cause finit par être entendue au
tribunal de la Providence, ce qui est sûr, c'est que Jão da Qintã
perdit son procès après avoir fait appel à toutes les instances, et se
retrouva dépouillé de tous ses biens, sans pouvoir sauver les
améliorations, remboursées par les revenus accumulés durant
quatre-vingt-cinq ans.
Cette chute des superbes, annoncée par mon abbé,
coïncida avec l'élévation de Luís, l'enfant trouvé à un rang proche des
sommets des dignités humaines — la commanderie de l'Ordre du Christ !
Le cultivateur subitement dépossédé de ses biens avait
cinq enfants. Il appela l'aîné, lui donna une carabine, et lui donna
l'ordre de traverser, d'une balle, la poitrine du Brésilien qui avait
gagné le procès
Le fils se dit qu'il lui serait moins pénible de vivre
simplement pauvre, que pauvre et criminel à la fois : il refusa de
suivre les ordres de son père, et s'enfuit.
Il alla voir sa tante Teresa, et lui raconta, les larmes
aux yeux, les malheurs de sa famille. Le commandeur Luis Ferreira
assista aux explications de son neveu.
– Reste chez nous, mon garçon, dit Luís, va parler à tes
parents et à tes frères, et dis-leur de venir ici, nous avons du pain
en abondance, et Dieu est avec nous.
– J'accompagnerai ce jeune homme, si tu y consens, dit
Teresa.
– Eh bien, si tu y vas, nous irons tous, répondit le
commandeur.
Ils allèrent tous trouver la famille pauvre, qui habitait
à trois lieues de là.
Quand ils furent en vue du village de João da Quintã, on
sonnait le glas dans la paroisse. Un cultivateur, qui hersait une
parcelle en pente, se dirigea vers eux, et leur raconta que João da
Quintã avait tué d'une balle le Brésilien de Vilar, quant celui-ci
venait, avec les officiers de justice, l'expulser de chez lui. Il
ajouta que l'homicide s'était immédiatement rendu, et qu'il avait
demandé qu'on le laissât faire ses adieux à ses enfants. C'était un
crève-cœur, ajouta leur informateur, de le voir embrasser sa femme et
son fils de deux ans, qu'elle serrait contre son cœur.
Luís Ferreira poursuivit son chemin jusqu'à la demeure de
la Quintã. Il trouva sa belle sœur dans le potager, entourée de la
population, son enfant dans les bras, et trois filles, entre dix et
quinze ans, assises à côté d'elle. Josefa lavait de ses larmes le
visage de son fils. Les gamines, les mains sur la tête et le visage sur
les genoux, semblaient pétrifiées et foudroyées par le malheur.
Luís releva sa belle sœur en lui tirant le bras, et lui
dit :
– Venez-vous-en avec vos filles.
La malheureuse se leva, et dit aux petites de la suivre.
Le commandeur donna à son neveu l'argent qu'il avait sur
lui, et lui demanda d'accompagner son père qui prenait le chemin de la
prison de Braga.
Au moment où Luís Ferreira sortait du village avec la
famille de son beau-frère, il rencontra un chirurgien qui lui dit :
– Notre homme ne va pas mourir.
– Quel homme ? demanda le commandeur.
– Le Brésilien, répondit le chirurgien.
– Grâces au Très Haut ! s'exclama Teresa.
– Tu devrais aussi t'exclamer à cette occasion, me dit
António Joaquim. On voit que tu as un cœur calleux ! Il n'y a pas de
surprise qui puisse émouvoir un romancier, qui a l'habitude d'imaginer
des surprises, qui passent les bornes de l'absurde.
– Je suis effaré ; mais je ne m'exclame pas, dis-je.
– Quand il s'est vu blessé à une épaule, continua mon ami,
le Brésilien déclara qu'il était mort, avant de perdre connaissance.
Les officiers de justice le ramenèrent chez lui en le tenant pour
défunt, et…
– Et les cloches, ajoutai-je, qui n'avaient aucune raison
d'être plus instruits en matière de blessures, que les officiers de
justice se mirent à sonner spontanément le glas.
– Ce n'est pas exactement ce qui s'est passé. L'on sonnait
le glas pour une vieille qui était morte dans la paroisse voisine ; et
comme elle était sœur d'une confrérie de l'autre, elle avait droit à
une messe, et au glas. Que de questions ! Est-ce ton habitude de donner
autant d'explications à tes lecteurs ?!
– Juste quand on sonne le glas pour des personnes qui ne
sont pas mortes. Et après ?
– Après, le commandeur laissa chez lui sa famille et se
rendit à Braga avec sa belle-sœur. João da Qintã était en proie aux
remords et aux regrets. Il songeait à se suicider, quand le commandeur
lui dit que le Brésilien était vivant, et l'invita à nourrir quelque
espoir de s'en sortir.
Le blessé resta trois jours au lit, un bras collé contre
sa poitrine, et partit aussitôt pour Braga afin d'intenter une action
contre le criminel. Des proches du commandeur lui disaient de ne pas
craindre les suites du procès, puisqu'on travaillerait les consciences
des membres du jury de telle sorte que les circonstances atténuantes
réduisissent à une peine de prison temporaire la peine de son
beau-frère.
Mais le commandeur refusa de coopérer à la subornation des
consciences des jurés ; il jugeait impossible et impraticable d'obtenir
le salut de son beau-frère, accusé de tentative d'homicide prémédité et
de résistance aux forces de l'ordre.
Peu de temps avant le jugement, il fit porter le deuil à
ses trois nièces, à sa belle-sœur, à l'aîné de ses neveux, et à
l'enfant de deux ans et demi.
Le plaignant se trouvait à Braga, à l' "Auberge des deux
amis" quand le commandeur entra dans sa chambre, devant la famille en
deuil, prit par la main les petites filles pour qu'elles
s'agenouillassent devant le Brésilien stupéfait. Voici au peu près ce
qu'il dit :
– Ces personnes appartiennent à la famille du malheureux
João da Quintã. La pauvre homme a élevé ces enfants dans l'abondance,
et n'a jamais imaginé aller par les routes demander l'aumône avec eux.
Quand il s'est vu tout à fait désespéré, il a perdu la raison et sa foi
en Dieu. Le châtiment de son crime, c'est que sa famille soit
contrainte à manger de mon pain, alors que j'ai été Luís, l'enfant
trouvé, qu'il a méprisé au point ne pas vouloir baptiser un de mes
fils. Eh bien, c'est moi, Luís, l'enfant trouvé, qui viens vous
demander la charité, et d'éprouver de la compassion pour le père de ces
petites et de cet enfant, qui va vous demander de pardonner à son père.
Sur quoi, il prit l'enfant des bras de sa mère et le posa
dans ceux du Brésilien.
Tu as là encore un Brésilien bon et sensible dans la série
de mes histoires. Le bonhomme avait déjà les yeux baignés de larmes,
ses lèvres étaient prêtes à balbutier une parole miséricordieuse.
L'enfant, croyant que c'était son père, lui caressa les joues de ses
petites mains, et proféra, comme un vagissement suppliant, le mot papa.
Cet enfant semblait suivre instinctivement une inspiration du ciel ! Le
Brésilien , secoué de sanglots, s'exclama :
– Ton père est pardonné ! Va lui apporter cette bonne
nouvelle dans sa cellule.
– Allons-y tous ! dit joyeusement le commandeur en
embrassant les genoux du Brésilien ému.
Au bout de quelques jours, João da Qintã quitta sa
cellule, après que le ministère public eut renoncé à son accusation
motivée par la morale publique, et les officiers d'une justice
outragée. On dirait qu'à cette occasion le commandeur a dépensé plus
d'argent que d'éloquence. Au lieu de faire porter le deuil à ses
neveux, il aurait rempli les poches d'objets d'une couleur riante et
pleine d'éclat.
La vengeance de Luís, l'enfant trouvé, ne s'arrêta pas là.
Il s'entendit avec le Brésilien, devenu son ami depuis
l'heure où ils avaient pleuré ensemble. Il lui remit une somme
correspondant à la valeur des propriétés saisies. Il rendit la maison
de la Quintã à son beau-frère ; et au moment de lui remettre les
titres, les billets et les quittances du Brésilien, il lui dit :
– Je vous remets la moitié de ce que j'ai hérité de notre
beau-frère. Priez beaucoup pour son âme, il nous a laissé de quoi
assurer notre bonheur à tous. Apprenez à vos enfants à rester humbles,
à ne pas mépriser les enfants trouvés, qui sont les fils adoptifs de
Notre Seigneur
C'est ici que se termine l'histoire de Luís, l'enfant
trouvé, conclut António Joaquim.
XIII
L'ERMITE
– Tu vas entendre à présent la merveilleuse histoire d'un
ermite.
Je déposai un baiser sur le front dégarni d'António
Joaquim, et m'écriai :
– Tu es un ange, et une gloire nationale ! J'envisage,
depuis des années, de proposer à mes lecteurs l'histoire d'un ermite.
Je n'y suis pas encore parvenu. Je désespérais de trouver des ermites
présentant des vertus capables de fournir une trame à un volume…
António Joaquim m'interrompit :
Écoute, les vertus de mon ermite ne donnent pas assez de
matière pour deux chapitres. C'est une histoire moins édifiante que le
titre ne le promet ; c'est ma mère qui me l'a racontée : signe qu'on
peut la raconter à tout le monde.
J'ignore si tu sais que la Relação de Porto, qui se trouve
à l'endroit même qu'elle occupe aujourd'hui, s'est écroulée il y a cent
et quelques années.
Nous ouvrons ici une parenthèse dans le récit de mon ami,
pour expliquer au lecteur non informé l'origine de ce quadrilatère de
granit noirci, qui se tient là, à la Porta do Olival. Et si les
vieilleries vous ennuient, cher lecteur, si l'histoire de la Relação do
Porto vous donne la nausée, parcourez à peine les trois pages
suivantes, et accordez toute votre attention au point où j'ai
interrompu António Joaquim.
Deux cents-vinst-six ans ans avant la naissance du Christ —
regardez où je vais ! Peu de gens remontent aussi loin en ce temps où
le progrès nous pousse tous en avant ! — en 226, donc, avant
Jésus-christ, il y a eu une chancellerie ou un bâtiment juridique à
Santarém. Personne n'ignore que les Celtes et les Grecs ont fondé, et
que les Romains ont agrandi, Santarém qui a pris le nom de "Praesidium
Julium" par la grâce de Jules César. Dans les Espagnes, la Description
de l'Univers, commandée par Auguste, et qu'évoque Saint Luc, a
d'abord été publiée à Santarém.
Les gouverneurs des provinces, en ce temps-là, partaient à
la guerre, durant la belle saison ; et dès que l'hiver jetait un froid
dans leur sang belliqueux, ils se retiraient dans les administrations
judiciaires pour y juger des causes. Puis, les Maures ont envahi la
Lusitanie en 714, et les formes juridiques en furent altérées. Le
gouverneur maure nommait, pour chaque district, un comte chrétien, qui
jugeait selon la législation gothe, mis à part les crimes passibles de
la peine de mort, qui étaient réservés aux alcades.
Je vois avec quelle adorable moue quelques centaines de
lectrices laissent tomber ce livre et murmurent sur le même ton que des
anges contrariés.
– Quelle impertinence ! Quel narcotique !
Je voudrais avoir l'audace des apôtres de grandes idées
pour oser vous dire, mesdames, que l'heure est arrivée où le sexe des
grâces doit endosser l'armure de la science pour entrer en lutte contre
la tyrannie de l'homme. Si les dons touchants, les charmes, et la magie
des sentiments suffisaient à émanciper les dames, elles le seraient
toutes, depuis que Dalila a tondu Samson, et qu'Omphale a contraint
Hercule à filer sa quenouille. Mais l'inégalité des droits fonde son
jugement odieux sur l'inégalité des capacités intellectuelles. Beaucoup
de Samson continuent d'être tondus ; beaucoup d'Omphale obligent,
moyennant la violence d'un coup d'œil mutin, d'énormes individus à
filer la quenouille ; cependant, leurs fragiles dompteuses, leurs
reines éphémères, continuent à leur être soumises, le même ostracisme
leur interdit les grandes charges publiques, de se présenter aux
parlements. Elles ne peuvent même pas siéger dans une académie ! Même
pas dans les académies, ces institutions futiles et dérisoires, qui
semblent avoir été inventées spécialement pour les dames désœuvrées.
L'argumentation inepte des goujats qui s'opposent à
l'émancipation des femmes, s'appuient, comme je l'ai dit, sur la
science défaillante de ces doux séraphins qui savent tout du ciel et
dédaignent le savoir des hommes. Il est donc indispensable de déloger
les sauvages postés derrière leurs remparts avec les armes de la
science. Il faut que les femmes, entre autres choses aussi indigestes,
apprennent comment a été institué l'administration judiciaire à Porto.
Vous saurez, maintenant, mesdames, que Sa Majesté le roi
Dom Afonso Henriques a conquis Santarém le 15 mars 1147, et décidé que
les anciens, parmi les nobles, auraient à connaître les causes, jusqu'à
ce que Dom Sancho, le chapelain, y instituât la Relação et la Chambre
Civile. En 1211, Dom Afonso II a créé les juges ordinaires, et les lois
générales ; l'on cessa de se reporter aux lois municipales, inscrites
dans les chartes de chaque terre.
Les monarques, en ces jours ténébreux, partaient chaque
année rendre la justice aux peuples ; ils se logeaient aux frais de
leurs administrés, et recevaient une redevance qu'on appelait "le dîner
du roi". Comme les avocats étaient rétribués par la nation, ils ne
pouvaient recevoir de l'argent des parties.
Les peuples sollicitèrent de Dom João Ier, dans les cortes
de Coimbra, le 10 Avril 1383, le transfert la chambre civile de
Santarém à Lisbonne.
Dom Sebastião nomma deux Relações[20] ambulantes, qui se
déplaçaient pour rendre la justice dans le royaume. Dom Philippe II a
finalement déplacé la Chambre Civile à Porto.
Le même Philippe, donna l'ordre, en 1584, aux conseillers
des cours suprêmes de justice de porter des toges, ou robes de
magistrats, et une large barbe pour représenter l'autorité des
sénateurs romains.
Dans une pétition adressée au roi, les habitants de Porto
parvinrent, semble-t-il, à l'émouvoir sur un sujet de la plus grande
importance pour le salut des âmes. Les lois de ces royaumes précisaient
que les condamnés ne disposaient, avant leur exécution, que du temps
nécessaire pour se confesser, sans autre sacrement. Prenant en pitié
les âmes des condamnés, Sa Majesté consentit à ce qu'on leur
administrât le Saint Viatique.
La Relação quitta la Chambre pour s'installer au palais du
comte de Miranda, dans le Corps de Garde ; la prison resta rue Chã,
qu'on appelait déjà prison vieille,
parce qu'elle avait été réformée en
1490.
En 1606, commencèrent les travaux de la prison et de la
Relação à la Porte do Olival. Ils ont duré deux ans. Durant cet espace
de temps, il fut interdit de bâtir des maisons à Porto, et condamné
tout ouvrier qui se serait dérobé à la construction de ce magnifique
édifice. Pour faire face aux frais démesurés, il fut accordé aux
condamnés à l'exil d'échapper à leur peine en payant le prix.
Cent quarante-quatre ans après, cette œuvre qui avait pris
deux ans, et semblait éternelle, s'écroula. C'était le samedi de
l'Alleluia, le 1er Avril 1752.
La Relação s'installa place das Hortas, où elle resta
vingt ans, en attendant sa reconstruction, entamée en 1767.
C'est là que commence le roman de mon ami :
– Quand la prison commença à se lézarder, parmi les
prisonniers qui s'en échappèrent indemnes, il y avait un criminel qui
mérite qu'on en parle. Ce n'était rien de moins que le meurtrier d'un
évêque, dont j'ignore le nom et l'évêché, parce que l'Histoire, par
respect pour la chrétienté, n'a pas transmis à la prospérité le nom de
ce prince de l'Église. Ce que dit la tradition, c'est que cet évêque
dont l'existence reste incertaine, avait perpétré un crime ignoble dans
le foyer domestique d'un noble de Trás-os-Montes, en le déshonorant ;
et que le noble, avec la meilleure épée de ses aïeux, soldats du Christ
l'avait égorgé sur l'estrade du lit conjugal, tandis que son épouse se
jetait par la fenêtre dans la rue, en tentant désespérément de
s'échapper.
Le défunt évêque était un grand ami de Sebastião José de
Carvalho, roi du Portugal et de l'Algarve ; alors que Nuno de Mendonça,
l'évêquicide, était un noble ennemi du dit roi, comme tous les nobles
écrasés sous le tout-puissant talon de son soulier.
Nuno de Mendonça fut condamné au gibet. Le jour du
supplice était fixé, dans le bourg de Vilariça, au 3 mai ; mais la
prison s'écroula le 1er avril.
Ignorant ce qu'était devenue son épouse, entre les forêts
et les rochers, il partit à sa recherche, sa main serrant
convulsivement le manche d'un poignard. Les nobles entrailles de cet
homme abjectement trompé étaient encore assoiffées de sang ! Il
interrogea les mendiants, qui sortaient au point du jour de l'hospice
de sa maison, et apprit qu'elle se trouvait depuis longtemps recluse
dans un rigoureux monastère.
Il s'enfuit de la terre où il était né avant qu'on le
reconnût, malgré sa barbe jamais rasée, et blanche comme neige. Il
avait quarante ans à peine ! Deux ans de cachot, deux ans d'angoisse où
il attendait sa dernière heure dans l'ignominie du gibet, deux ans où
il a brûlé de se venger, sans aucun soulagement, sans aucun espoir,
firent de ce gaillard de Nuno ce vieillard qui s'éloigne de Vilariça
par les gorges des montagnes.
Mon bisaïeul avait une grande dévotion pour Saint Gens,
que l'on vénère dans une chapelle qui se trouve à trois quarts de lieue
de chez moi.
On raconte qu'un jour, cet honnête cultivateur s'était
rendu au point du jour tout en haut de la colline où se trouve la
chapelle, et avait rencontré, assis sur la racine d'un gigantesque
olivier sauvage, à la porte de la chapelle, un inconnu mal vêtu, qui
semblait macéré par la faim.
Il lui posa des questions, en manifestant quelque
compassion, et le désir de lui être utile. Exténué, Nuno de Mendonça,
lui répondit brièvement. Mon bisaïeul l'emmena avec lui, l'hébergea, le
nourrit, et respecta le silence de son malheureux hôte.
Les mandats lancés par les districts, après l'évasion des
prisonniers, se succédaient, ils étaient impératifs. Le signalement de
Nuno de Mendonça, comme celui des principaux criminels, n'étaient pas
équivoques. Le mystérieux silence de son hôte éveilla la méfiance du
cultivateur, qui ne le soupçonna cependant pas d'être le meurtrier du
libertin en mitre.
Après avoir récupéré ses forces, Nuno dit à son hôte qu'il
se rendait à Castela. Mon bisaïeul, pris de pitié, lui recommanda de ne
pas courir le risque d'être appréhendé, parce que l'ordre de capturer
tous les voyageurs inconnus dans les districts était formel.
Le fidalgo s'arrêta : il comprit la délicatesse magnanime
du vieillard ; il le jugea digne de confiance, et lui raconta les
malheurs de sa vie. Pour le payer de ses confidences, le cultivateur
lui donnait de l'argent pour faciliter son départ pour d'autres
royaumes ; Nuno se sentit pourtant complètement désemparé ; la crainte
de retomber dans les griffes du favori de Dom José Ier, la vision du
gibet qui l'attendait pour le 3 mai, le retinrent au lit que lui
offrait son hôte, et qui le garantissait de rester en vie.
Nuno resta un an de plus chez mon bisaïeul. Il sortait,
par les nuits glaciales, boire l'air des montagnes. Il avait l'habitude
de s'installer près de la chapelle de São Gens, sur la racine de
l'olivier.
Ayant, durant un large espace de temps, vécu d'une façon
aussi misérable, le fidalgo demanda à son ami de lui construire une
cabane entre les falaises à côté de la chapelle, pour que sa vie ne
stagnât pas, d'une façon débilitante, dans la petite chambre où il
passait ses journées. Le vieillard ne contraria pas ce projet. Il lui
bâtit de sa main, avec ses domestiques, une petite maison de pierre,
couverte de chaume, crépie à l'intérieur. Il lui donna une couche et un
banc, une marmite, et une serpe pour couper du bois. Il lui fournissait
une arme de chasse, et une chienne pour traquer les lapins ; Nuno
déclina ces derniers cadeaux, et demanda une tunique de bure et un
rosaire.
Nous devons supposer que la solitude, peuplée d'horribles
fantômes, parmi lesquels vécut le fidalgo, épura sa piété, et enflamma
sa croyance en la justice divine. Il se peut que le spectre de l'évêque
sanglant troublât ses brèves heures de sommeil ; et que le malheureux,
dont la raison était entamée par les assauts continuels de l'infortune,
se retrouvât confit en dévotion.
Ce qui est certain, c'est que Nuno de Mendonça enfila sa
robe de bure, et s'assit sur le chemin de sa cabane pour attendre que
la colombe des anciens anachorètes laissât tomber des sphères aériennes
les bouchées qui le nourriraient.
Cependant, mon bisaïeul devançait les attentions de la
colombe en lui envoyant de quoi déjeuner, et en allant personnellement
lui apporter chaque soir son dîner, et passer quelques heures avec lui.
Les habitants du voisinage découvrirent l'existence de l'homme à la
barbe blanche, et l'appelèrent aussitôt l'ermite de São Gens. Des
malades du cœur et de l'âme commencèrent à venir le voir. Il racontait
aux infortunés l'histoire des malheureux qu'il avait connus, et les
renvoyait réconfortés ; en guise de remède, il conseillait aux malades
de demander à Dieu de les guérir, si la volonté de Dieu ne leur donnait
pas assez de vie pour de grandes tribulations. Ces procédés qui, dans
l'esprit du peuple, devaient accentuer le discrédit de quelque ermite,
assurèrent la renommée de Nuno de Mendonça. Des personnes distinguées
des environs voulurent connaître cet homme qui tenait des discours que
le peuple ne comprend pas toujours, mais ne manque pas d'admirer. Mon
bisaïeul fut épouvanté par cette popularité, quoi qu'il se fût passé
trois ans, depuis son évasion de la prison en ruines. Il lui demanda
donc d'éviter de s'entretenir avec les gens du peuple, ou de changer de
région.
Heureusement que les autorités judiciaires des provinces
avaient relâché leurs efforts pour retrouver les prisonniers, après le
séisme de 1755. Toutes les mesures que prenait le marquis de Pombal
concernaient la reconstruction de Lisbonne. Convaincu que les agents ne
seraient plus sur leurs gardes, il abandonna sa cabane, et reprit le
chemin de sa terre, dans l'intention de trouver de l'argent pour passer
en France, et d'achever sa vie dans un monastère.
XIV
Mon ami poursuivit son récit :
– Nuno de Mendonça trouva les armes de sa maison couvertes
de crêpe. Son épouse était décédée, quelques mois avant, dans un
monastère de Galice, tellement affectée par ses fautes, qu'elle édifia
plus de personnes en mourant que n'auraient pu le faire trois dames
menant une vie de sainte. La contrition après un crime est l'hommage le
plus expressif, le plus touchant aux consciences pures. Les remords
d'une vie dans le péché sont un exemple plus édifiant que la pratique
sereine des vertus. L'on remarque plus les larmes de la pénitence que
les joies d'une âme innocente… On dirait que ces maximes t'ennuient !…
– Non ; j'aime beaucoup les maximes, répondis-je, mais
quand les récits piquent ma curiosité, je préfère entendre les maximes
à la fin de l'histoire. En attendant, si…
– À ta guise ; je vais droit au fait, vu qu'il n'est pas
permis de prendre à mon compte l'astuce avec laquelle, dans tes romans,
tu enchâsses des axiomes, quand ton imagination se rouille.
– Merci… L'on ne peut être La Rochefoucauld sans avoir
l'imagination rouillée !… C'est toi et les lecteurs de ton espèce qui
noyez les embryons des auteurs d'aphorismes au Portugal. Eh bien sache
que l'éternelle renommée de beaucoup de livres, c'est le style
sentencieux qui la leur donne. Les romans coulent par le fond après
vingt quatre heures de navigation, parce qu'ils ne sont pas lestés de
maximes. Parmi nous, il existe un exemple de renommée durable due au
poids des aphorismes ; ce sont les romans du conseiller Rodrigues
Bastos. Il est cependant nécessaire que l'écrivain ait plus de
quatre-vingts ans pour que ses lecteurs relèvent le ton pédagogique de
ses axiomes…
– Maintenant, celui qui met notre patience à bout, c'est
toi, fit António Joaquim. Je noierai, avec le respect qui t'est dû, tes
embryons sentencieux en te disant que Nuno de Mendonça trouva les
portes de sa maison fermées. Faute de descendance, après la mort de la
pénitente recluse, les domestiques de cette famille infortunée s'en
furent remettre les clés aux frères de leur maître, qui résidaient à
Bragança.
Inconnu dans sa propre terre, il se renseigna, et prit le
chemin de Bragança. Dans le silence complet de la nuit, il frappa à la
porte des siens, se fit connaître, et se retrouva dans les bras de son
frère, Cristovão de Mendonça, religieux de la Compagnie, lequel était
parti de Lisbonne, du siège de l'ordre à São Roque, ourdir je ne sais
quelles conspirations contre le comte de Oeiras ; à l'abri des
domestiques, ses frères célébrèrent avec des cris de joie et des larmes
l'apparition de Nuno qu'ils jugeaient mort, ou errant au hasard dans
des pays lointains. Le jésuite, qui avait amené avec lui le père
Timóteo de Oliveira, exilé plus tard par le marquis de Pombal — en tant
qu'ami du père Malagrida, qui est mort brûlé sur l'ordre de ce sublime
despote — le jésuite, donc, s'entendit avec son compagnon ; le
lendemain, ils donnèrent une soutane à Nuno de Mendonça, lui
composèrent un visage monastique, et prirent, la nuit, monté sur de
puissantes mules, le chemin de Lisbonne.
Le condamné au gibet entra avec son frère dans la maison
de São Roque, où il demeura jusqu'en 1759, sous un pseudonyme à
l'intention des personnes dont se méfiait la Compagnie. Nuno de
Mendonça participa à la conjuration contre le roi Dom José. Le duc
d'Aveiro, qui dirigeait la conspiration, avait pour lui une grande
estime, il avait fait de lui son intime confident, bien qu'il ne se
prêtât pas aux vues du conjuré, qui s'offrit pour purger la nation
portugaise du dragon en pourpre. Je n'ai pas besoin de te dire que ce
dragon se trouvait être, en langage héraldique, le marquis de Pombal.
Quand les romanciers d'ici et d'ailleurs donnent libre
cours à leur imagination en rapportant la tentative de régicide en
1759, ils avancent que la jalousie du comte de Atouguia s'exhala par
les tromblons qui ont tiré au passage de la voiture du roi. Je m'en
rapporte à mon bisaïeul, que je n'ai entendu que dans les propos
évangéliques de mon aïeul et de mon père, pour te déclarer, à toi comme
à l'Histoire, que l'honneur marital du comte de Atouguia n'a pas été,
fût-ce légèrement, souillé par Dom José Ier. La raison, ou l'absence de
raison de cette tentative de régicide s'explique d'une façon on ne peut
plus évidente, par la rancœur d'une noblesse foulée aux pieds contre le
favori du roi. La Compagnie de Jésus se rangea du côté de la noblesse,
parce que le marquis l'avait maltraitée, avec plus de discernement que
de justice, en menaçant l'influence qu'elle exerçait dans les colonies.
Le clerc, porté au sommet des honneurs par l'incapacité et la dévotion
tardive du roi Dom João V, fut surpris des obstacles et des critiques
du règne qui a suivi. Le marquis avait pour lui le bras du peuple, et
son propre bras qui était, disons-le sans en être étonnés, à même de
soutenir un fardeau plus formidable qu'Atlas, accablé qu'il était sous
la pesante fureur de la noblesse et du clergé.
Tu connais, tout le monde connaît l'échec de cette
tentative, le châtiment barbare qu'ont subi les fidalgos sur la place
de Belém, et le sort des jésuites impliqués dans ce complot : les uns
furent exilés, l'es autres ont fini dans un cachot, et le pauvre
Malagrida au bûcher.
Un des conjurés qui a déchargé son arme contre la voiture
du roi fut Nuno de Mendonça. Les autres, il ne les a jamais dénoncés ;
mais nous supposerons qu'un familier du duc d'Aveiro, du nom de
Policarpo Neves — je présume que tel était son nom et son prénom — fut
le second qui manqua sa cible.
Ce que je sais, c'est qu'ils se sont enfuis ensemble ; et
ils furent assez heureux pour parvenir à la demeure de mon aïeul, au
Minho.
Nuno de Mendonça s'installa dans la cabane abandonnée aux
environs de la chapelle de São Gens. Policarpo endossa la tenue d'un
journalier, et s'en alla bêcher avec d'autres ouvriers les terres de ma
maison. Il leur était impossible de passer à l'étranger. L'on arrêtait
chaque jour des voyageurs moins suspects. La tête de Policarpo était
mise à prix pour quatre mille cruzados ; personne ne donnait rien pour
celle de Nuno de Mendonça. Ce nom était mort dans la mémoire des
hommes. Après avoir mené son enquête dans l'établissement des jésuites
de São Roque, le marquis de Pombal avait juste appris la disparition
d'un de leurs familiers du nom de Nolasco. Ce Nolasco procura des nuits
d'une fébrile insomnie à la toute-puissante tête du favori.
Entre-temps, le fidalgo de Vilariça, qui se consumait de
haine et d'angoisse dans son antre ascétique de São Gens, attira de
nouveau les gens des paroisses situées au pied de la montagne. On
disait qu'il était arrivé de Terre Sainte, et de Rome, où il avait
baisé la main de Clément XIV, et que peut-être il avait goûté sa
canonisation avant l'heure que lui annonçait la bouche même du
dispensateur des couronnes immarcescibles de la gloire éternelle.
Policarpo montait la nuit, avec mon bisaïeul, en haut de
la montagne, ils racontaient à l'ermite les nouvelles qui leur
arrivaient de la capitale.
Une nuit, ils lui annoncèrent le supplice du duc d'Aveiro.
– Et la duchesse ? demanda Nuno.
– Elle a été décapitée, elle aussi.
– Pauvre sainte ! s'exclama le fidalgo. Elle est morte
parfaitement innocente. Je n'ai jamais osé dire du mal du roi en sa
présence !
Il se mit à pousser de grands cris, en demandant à la
miséricorde divine de soulager l'agonie prolongée de sa vie.
Je ne sais si le front du Seigneur, dans sa clémence,
s'est penché pour écouter la prière de l'homicide qui avait envoyé un
évêque dans une région peuplée de terribles grincements de dents, et
qui avait voulu y envoyer probablement un roi. Ce qui est sûr, c'est
que Nuno de Mendonça mourut peu de jours après le supplice de ses
conjurés dans les bras d'un prêtre de mon village, je n'ose t'affirmer
que ce fut en odeur de sainteté ; ce que l'on m'a dit, c'est qu'il a
fini en dégageant la méchante odeur de tous les défunts, dont le cœur
et encore plus les entrailles ont lâché, rongés par des infections,
après dix années d'infortunes ininterrompues.
Voilà l'histoire de l'ermite. Veux-tu savoir maintenant
comment a fini Policarpo das Neves, l'économe de la maison des
Mascarenhas ? On le prit pour le fils naturel d'un fidalgo de la maison
de Aveiro, où il s'était formé et ménagé une confiance illimitée. Il
commençait à s'enrichir, quand s'est produite la catastrophe : il
attendait, une fois abattu le marquis de Pombal, d'accumuler des biens
qui l'élevassent aux grandeurs que lui promettait sa naissance, quand
on l'aurait reconnu comme le frère du duc.
Tous ses avoirs furent confisqués : il ne possédait pas
assez de terre pour y tomber mort ; mais ce qui le dérangeait le plus,
c'était de ne pas posséder d'endroit où tomber vivant sans craindre
qu'un curieux, manquant de tout, ne lui enlevât sa tête pour toucher,
en la vendant, les quatre mille cruzados qu'on lui offrait.
Mon bisaïeul connaissait à Padrões de Teixeira, près de
Mesão Frio, un ancien domestique à lui, qui y avait ouvert une taverne.
Il alla trouver le bonhomme, lui acheta cet établissement en
s'engageant à lui trouver un endroit plus rentable au Minho. Policarpo
prit en mains la taverne de Padrões de Teixeira, et l'agrandit, en
construisant un appentis où les muletiers pouvaient attacher les licous
de leurs bêtes. Au bout de quelques années, il se maria, à l'âge de
quarante ans, avec une fille d'un village du Marão. Il en eut un fils,
qui assista à la mort de son père et n'apprit, qu'à la dernière heure,
de la bouche du moribond, quel était son vrai nom, et comment il avait
échoué dans ces montagnes. La nouvelle se répandit quand son fils et sa
veuve n'avaient plus à craindre une action de la justice. Le marquis de
Pombal et Dom José Ier s'étaient déjà entendus, sous les yeux de Dieu,
pour pardonner à Policarpo das Neves.
Je connais deux petits-enfants de cet homme de fer qui a
travaillé quarante ans pour laisser à son fils de quoi vivre à l'aise.
J'ai embrassé l'un d'eux hier à Vila Real, où il est délégué du
procureur du roi, un garçon valeureux, aimable et fier, dont tu as dû
faire la connaissance, il y a douze ans, avec ses jolis yeux bleus et
sa moustache blonde : il s'appelle Valentim de Mascarenhas.
– Je le connais : je l'ai embrassé hier, moi aussi, lui
dis-je, je lui suis fort reconnaissant, parce qu'il m'a rendu un grand
service en ne m'arrêtant pas…
António Joaquim m'interrompit, effaré :
– Tu risques donc d'être arrêté ?
– Parfaitement !… Parole d'honneur !
– Pourquoi ? De quoi es-tu coupable ?
– De régicide ! Si la cabane de Nuno de Mendonça est
toujours là, permets-moi de me faire ermite à São Gens, en tirant parti
du fait que tu seras la colombe qui nourriras cet anachorète, qui te
baise dès à présent tes candides ailes.
Sur quoi, j'ai déposé un baiser sur le second collet de la
capote d'António Joaquim, et nous mîmes pied à terre devant l'auberge
de Penafiel.
XV
AMOUR PATERNEL
Nous dînions, en admirant la dureté et l'élasticité
fibreuse des poules
de Penafiel, quand pénétra dans la salle un individu qui s'empressa
d'embrasser António Joaquim. Mon ami me présenta le sieur Miguel de
Barros, une personne d'un peu plus de trente ans, qui présentait le
côté enjoué d'un fidalgo de province. Nous avons parlé d'enfants, parce
que Miguel de Barros ne parlait que de gamins, avec les effusions d'un
philanthrope qui inaugure des crèches, ou la tendresse d'un père qui va
sur ses cinquante ans. En fait, notre commensal était père, et donnait
l'impression de nourrir les inquiétudes qu'éprouvent les mères
pour leurs enfants. À la fin du dîner, nous nous séparâmes. Miguel
revenait chez lui, à Resende, et nous nous embarquâmes dans la litière,
dont le confort me paraissait une affaire problématique, après un
trajet de quinze heures sur la surface accidentée du globe.
– S'il n'avait pas d'enfants, ce Miguel de Barros,
dis-je à António Joaquim, il parlerait galamment de la culture de la
citrouille et du petit moine…
Mon ami me coupa la parole :
– Tais-toi, espèce de sauvage. Si tu savais que les petits
enfants ont été les archanges rédempteurs de l'âme et du cœur dépravés
de cet homme !
– C'est donc toute une histoire, l'amour de ton ami pour
les enfants ?
– Oui, et tu verras. Miguel de Barros a été l'homme le
plus précoce que j'aie connu en matière de libertinage. À vingt ans, il
disposait de toute sa liberté, de ses mauvais instincts, et de beaucoup
d'argent qu'il avait soustrait à la vigilance de son tuteur, quand sa
mère était morte. Il alla dilapider à Lisbonne l'éclat grossier de sa
grossière éducation, et revint à vingt-quatre ans, dès qu'il se
retrouva à court d'argent ; le conseil de famille diminua sa pension.
Sans Dieu, sans loi, sans la moindre idée de ses devoirs,
je laisse à ton imagination le soin de réfléchir à ce que ferait un
garçon à la mine insinuante, poli par le vernis des salons de la
capitale, beau parleur, aussi efféminé qu'il convient pour les
frivolités appréciées par les dames du monde entier, et
particulièrement celles de son pays. Avec un vaste répertoire d'amours
aventureuses, il prit comme modèles de sa joyeuse jeunesse les
personnages les plus sympathiques, et voulut, à grand renfort de
poésie, mêlée de prose, exalter ses compatriotes en faisant d'elles,
également, des personnages, en appelant les unes Elvire, d'autres
Ophélie, d'autres Desdémone, Virginie quelques-unes, et trouva,
semble-t-il de tout, ou se ménagea tout avec sa prose et sa poésie.
Ce travail malaisé de composition dans les conditions où
se trouve le progrès morose de nos provinces, lui attira certains
désagréments dans son pays. Là-bas, dans ces brousses, il y a des pères
de famille qui n'ont accordé aucune foi aux lumières dont le monde est
le théâtre, et ne s'empressent pas d'obtempérer aux injonctions des
évangélistes des idées nouvelles. Il s'y trouve des rétrogrades qui te
fracasseront la tête, si tu fais savoir à leur famille que le monde
avance à présent plus vite qu'au siècle dernier. Je ne sais sur combien
de rétrogrades de cette farine est tombé Miguel de Barros. Ce qui ne
fait aucun doute, c'est que ce garçon, qui possédait tous les arts, et
toutes ruses de la bonne société, souffrit le sort commun à tous les
précurseurs de la civilisation : il fut martyr ; on lui cassa la tête
plus d'une fois, on l'obligea à changer de région.
Miguel de Barros a une ferme à Santo Tirso. C'est là que
nous nous sommes connus, il y a dix ans.
En dépit de ses cicatrices sur le crâne, le jeune homme ne
put arracher de son sein la vipère de la poésie qui lui aiguillonnait
son organe le plus noble, sans vouloir offenser l'autre auquel le cœur
porte hommage, dès que pointe l'aurore du discernement. Il ne changea
pas de vie ; il se retrouva sur un autre terrain, et voulut s'essayer à
l'exploitation des fleurs de son âme. Il ouvrit les digues à
l'extravagante crue de sa poésie, entraîna quelques cœurs dans ce
torrent, et se noyait proprement dedans. Je ne sais si Miguel prit peur
devant une statue de quelque commandeur, semblable au père de l'Inès de
Dom João[21]. J'ai
l'impression que ce n'était pas vraiment une statue
: j'ai quelques raisons de penser qu'un cultivateur l'a menacé de lui
ouvrir une sépulture dans son potager, où il l'avait surpris, une
après-midi, alors qu'il recevait un bouquet de deux sortes de basilics
des mains plutôt jolies d'une fillette bien plus qu'innocente, captivée
par les douceurs du fidalgo. Si cela s'est passé de la sorte, le départ
pour Braga de Miguel de Barros s'explique parfaitement.
J'ai oublié de pousser jusqu'à Braga mes investigations :
toutes mes hypothèses me conduisent à croire que Miguel de Barros n'y a
rien fait qui démentît ses antécédents. Braga possède un climat doux,
une nature opulente, c'est un fragment du paradis, un nid de verdure
favorisant les amours des oiseaux, qui jouissent là d'un éternel
printemps.
Comme il y a cependant partout des milans qui ne laissent
pas les bergeronnettes et les alouettes s'aimer tranquillement, Miguel
de Barros déploya ses ailes vers d'autres régions.
Il se retrouva à Porto, le cœur percé par les injustices
de l'humanité, et spécialement celles des pères de famille. Il ne se
plut pas à Porto. Il jugea que le pays, outre le fait qu'il manquait de
poésie, était affligé de brumes nocives à la santé de son appareil
respiratoire. Que ce fût pour cette raison, ou parce qu'il n'était pas
compris des étoiles qu'il apostrophait dans un langage symbolique, ce
qui est sûr, c'est qu'après avoir traîné deux ans entre Marco de
Canaveses, Santo Tirso, et Braga, il décida de revenir à son point de
départ, de s'occuper de sa maison, et de s'efforcer d'avoir assez de
discernement pour vivre avec un crâne en bon état.
Le discernement, un caractère que tout le monde présente
comme une chose facile à acquérir, ne vient pas si vite, et ne répond
pas à point à nos résolutions. Je plains tous les fous, même les fous
que le corps médical ne s'accorde pas à juger tels. Je n'ai pas encore
connu d'extravagant qui le soit volontairement, et je connais des
dizaines de fous qui regrettent sincèrement de ne pouvoir prendre la
route unie, où ils m'ont rencontré.
Miguel de Barros avait tiré le mauvais lot dans le
réservoir universel du jugement, si tant est qu'il y ait un endroit où
l'humanité recueille l'étincelle intellectuelle, triviale et indûment
appelée sens commun, la chose
la moins commune qui soit en ce monde. Il
restait chez lui à faire et à refaire des papiers de location pour ses
fermes, à dessiner des plans pour des travaux, à projeter des
reconstructions, à réfléchir même aux avantages du mariage en tant que
base indiscutable d'un solide bon sens. Alors qu'il était absorbé dans
ces fort honorables pensées, il fut surpris par l'apparition d'une
jeune paysanne, aussi gracieuse que les hirondelles, aussi innocente
que les fleurs, dont elle se coiffait, en cachette des gens, quand elle
s'enfonçait dans les bois.
J'aborde à présent la seconde partie de l'histoire de
Miguel de Barros.
La jeune fille qui l'avait surpris avait de si jolis yeux,
que même les gouffres n'osaient se montrer à elle dans toute leur
laideur.
Elle l'aima, comme la fleur aime le rayon de soleil qui va
l'embraser et la faner.
On lui dit de fuir le pouvoir fatidique de cet homme, qui
allait se présenter au Seigneur sur le torrent de larmes qu'il avait
fait verser. La jeune fille écoutait tristement ce qu'on lui disait, et
semblait répondre en silence : "Je ne veux pas que mes larmes
rejoignent le torrent qui va l'entraîner devant le Seigneur."
Angélica — c'est ainsi qu'on l'appelait — se trouvait un
jour avec un petit enfant dans les bras. Cet enfant était né deux
heures avant. Il était d'elle. Les larmes de sa mère lui inondaient le
visage.
– Je ne peux pas le laisser s'en aller, mon Dieu,
criait-elle. Plutôt la honte ! N'importe quoi plutôt que de le laisser
partir ! S'il voyait cet enfant si joli !… Si quelqu'un le lui
montrait, il ne le laisserait pas aller au tour !
À côté d'Angélica se tenaient deux femmes ; l'une, le
visage caché sur ses genoux, sanglotait ; c'était la grand-mère de
l'enfant, qui l'avait tenu dans ses bras, et ne voulait plus rien voir.
L'autre était une voisine compatissante, qui devait emporter le
nouveau-né au tour.
C'est elle qui répondit aux cris d'Angélica :
– Si tu veux, ma fille, je l'apporte au fidalgo.
– Vas-y, s'exclama la mère, en le lui remettant, après lui
avoir essuyé le visage.
Au lever du soleil, Miguel de Barros ouvrait la grille de
la meute de chiens pour aller à la chasse avec d'autres jeunes gens du
voisinage.
Les chiens aboyaient furieusement dans la châtaigneraie
jouxtant la demeure, et se jetaient sur une femme, qui criait.
Miguel siffla la meute, et demanda à la femme ce qu'elle
faisait là.
– Je vous attendais, Monsieur, dit-elle.
– Que voulez-vous ? demanda Miguel.
– Vous dire un mot en particulier.
– Qu'est-ce que vous tenez là ?
Cette question, c'était déjà une amorce du petit ange, qui
lui parlait entre les linges d'un lin très blanc dont la mère l'avait
enveloppé.
– C'est votre enfant.
– Quoi ?!
– Cette petite fleur du ciel ! Regardez donc, fidalgo,
regardez comme il est beau !
Miguel fixa les yeux sur le bébé endormi, et lui toucha,
de son index, la joue gauche.
Là-dessus, ses compagnons arrivèrent avec leurs meutes, en
criant :
– Allons-y, les chiens se bouffent les uns les autres.
Miguel ne quittait pas le petit des yeux.
– Où allez-vous aller, en partant d'ici ? demanda-t-il à
la mère.
– Je vais l'emporter au tour ! Cette petite créature qui
est si jolie… Regardez, Monsieur, qui aura le cœur de ne pas vouloir de
lui ? Si je n'étais pas si pauvre, je le garderais avec moi… Et même,
toute pauvre que je suis, si Dieu me venait en aide, même s'il me
fallait demander l'aumône, j'aimerais bien l'avoir pour moi… Il y a
donc des gens qui peuvent abandonner un enfant comme ça !… La mère est
restée là à pleurer, que c'en était un crève-cœur de l'entendre !…
– Apportez cet enfant à sa mère, dit Miguel de Barros, en
ajoutant : je vais tout de suite vous rejoindre.
Se tournant vers ses amis qui l'attendaient, il dit :
– Allez-y, ne m'attendez pas.
Puis… Quels beaux tableaux se détachent parfois du sein
même de l'infortune !
Combien je donnerais pour voir Miguel de Barros,
vingt-quatre heures après, à côté d'une chaise rembourrée, où l'on
transportait Angélica de sa pauvre maison à la plus belle alcôve de la
demeure du fidalgo ! Le voir, lui, pleurer parce que le nourrisson, au
quatrième jour de sa vie, s'est réveillé mortellement pâle, car sa mère
n'avait pas pu l'allaiter la nuit !… la tendresse anxieuse qu'il a
manifestée en partant lui-même à la recherche d'une nourrice pour
allaiter son fils !… Le voir traverser la nuit ses salons pour
l'endormir dans ses bras ! La tendre inquiétude avec laquelle ce père
le serrait dans ses bras, de peur que l'enfant ne lui échappât des
mains !…
Veux-tu savoir à présent le dernier trait de ce magnifique
spectacle ?
Le voici : Miguel de Barros a épousé, six mois après, la
ravissante mère de son fils, il l'a chérie par la suite, avec un cœur
si grand que, selon moi, ce sont les mains du petit ange qui le
remplissent toujours de tendresse.
Cela s'est passé il y a huit ans.
Miguel de Barros a aujourd'hui six enfants. C'est un père
qui me fait envie, à moi qui éprouve tant d'amour pour mes petits.
Comment veux-tu qu'il parle d'autre chose ? Ses enfants sont les
archanges de sa rédemption, ils ne lui laissent pas le temps de sentir
l'âcre ennui de la vie.
XVI
HISTOIRE D'UN BRILLANT [22]
– Raconte-moi, toi, maintenant, une histoire, dit António
Joaquim.
– Je les vends, moi, d'habitude, répondis-je avec le
détachement grave et sérieux qui caractérise mon art. Je te raconterais
un joli conte si tu me donnais ce brillant qui m'aveugle comme la
splendeur de Jéhovah le peuple élu.
– Cette pierre, fit observer mon ami, en me montrant son
anneau, a son histoire. Il faisait partie des brillants de ma cousine
Adriana.
– Écoutons alors l'histoire des brillants de ta cousine
Adriana.
– Elle est sentimentale !… Réjouis-toi ! Ma cousine est
née à Porto. Elle s'est retrouvée orpheline à dix ans, et presque
pauvre. Les brillants de sa mère, et quelques bricoles, qu'elle a pu
sauver de l'honorable banqueroute de son père, c'est tout ce qu'on lui
a donné quand elle a quitté, à seize ans, le Refuge de São Lazaro, pour
se marier avec un vieux, un ancien associé de sa maison. On lui dit que
l'on ne saurait mieux faire preuve de discernement, qu'en épousant un
associé de son père, parce qu'il était vieux, et parce qu'il était
riche ; vieux, il l'aimerait comme les jeunes ne savent plus aimer ;
riche, il la laisserait riche et jeune pour pouvoir ensuite se choisir
un mari. Après avoir entendu ces arguments de personnes avancées en âge
et pleines d'expérience, elle étouffa ceux de son cœur, et s'abandonna
à l'amour ainsi qu'à la richesse du vieux, étant bien entendu qu'elle
pourrait incessamment souhaiter qu'il mourût pour se marier avec un
jeune. La société excuse une telle immoralité.
Le mari outrepassa ses promesses d'un amour infini. Il le
poussait jusqu'à la férocité du molosse qui guette la caverne où une
biche s'est réfugiée pour lui échapper. Personne ne la voyait :
l'unique expédient qu'il eût trouvé pour qu'elle ne vît personne. Il ne
l'amenait pas au Théâtre National parce que les comédies portent
atteinte aux mœurs. Il ne l'amenait pas au bal, parce que, de la part
d'une dame mariée, c'est faire preuve d'un méchant laisser aller, que
de s'adonner aux rages acrobatiques d'un galop. S'il n'y avait pas eu
de messe à l'aube, son mari eût été capable de renier la religion de
ses pères pour ne pas y amener son épouse. À l'aube des jours
sanctifiés, elle s'encapuchonnait dans sa mantille, et suivait son mari
qui l'espionnait, quand même, du haut du col de la capote où il se
barricadait le visage. S'il voyait, à l'église du Carmo, deux fois le
même homme, il passait, le dimanche suivant, à celle de la Trinité, et
de là, pour un motif identique, à celle de São Nicolau, quoique les
individus éveillant ses soupçons fussent plongés dans une dévote extase
devant les autels, et que la lumière du temple ne permît pas de
semblables éveils de l'amour dans des cœurs mondains.
Adriana était une ingénue, une jeune fille remarquable. La
patience dont elle a fait preuve en subissant une séquestration qui la
privait des moindres plaisirs de la vie en ferait une sainte, si une
amie du Refuge, mariée sous de bons auspices à un mari discret, ne
l'incitait pas à se rebeller contre cette tyrannie conjugale. Elles se
parlaient rarement ; mais elles entretenaient une correspondance
hebdomadaire. Il faut noter que ma cousine faisait passer en
contrebande cette correspondance à l'intérieur des barrières
conjugales, depuis que son prévoyant époux lui avait fait observer
qu'il n'appréciait pas ces petits mots, bien que les premiers fussent
bien innocents. Après cette interdiction, Adriana se répandit en
lamentations auprès de son amie ; elle rapporta par le menu la
tristesse de ses languissantes heures ; le supplice de sa solitude, la
détresse de son cœur orphelin ; l'envie que lui inspiraient vraiment
ses domestiques ; le désir qu'elle avait de mourir… Ma cousine
n'écrivit pas un seul mot trahissant la perte de sa dignité, bien que
son amie ne se privât pas de jeter une lumière infernale au fond d'un
cœur plongé dans les ténèbres.
Francisco Elisiário — c'était le nom du mari d'Ariana —
n'avait pas étudié le sexe féminin, comme le font d'ordinaire certains
savants, que l'on trompe tous les jours, et ne gagnent de leurs études
que l'avantage de savoir qu'ils sont trompés, comme d'autres qui ne se
sont jamais penchés sur une matière aussi incompréhensible. Le meilleur
maître, dans une science aussi abstraite, c'est l'amour. Un amour aussi
grand, aussi fin que celui que Francisco Elisiário renfermait au sein
de son âme, tu pourras l'attribuer aux héros et aux poètes ; mais moi,
dans le mince domaine de mes relations avec l'humanité, je n'ai connu
des amours énormes et durables que chez les Elisiário. Les passions des
héros, célébrées à travers les siècles, qu'ils s'appelassent Pétrarque
ou Camões, restent gravées dans des médaillons, suspendus aux frontons
de l'Histoire ; mais si, un beau matin, la critique se réveille sincère
et juste, elle réduira à des proportions humaines le cœur des
demi-dieux, et nous démontrera, en face des confessions des héros
eux-mêmes, que, tout en pleurant dans ses sonnets une Laure, cette dame
d'un tel discernement, et nonobstant ses ordres sacrés, Pétrarque a
laissé de nombreux enfants, et terminé joyeusement sa vie parmi eux.
Luis de Camões, que les bons auteurs font mourir de chagrin à cause
d'une Catarina, et de la compassion que lui inspirait sa patrie, n'en
est pas mort, non plus que de misère, comme d'autres l'affirment ; il
est mort de maladie, peut-être une cachexie, que laissaient prévoir ses
dérèglements en Orient. Quant à la renommée de ses malheureuses amours
avec une belle dame de compagnie de la reine, il te faut savoir
qu'elles sont nombreuses, les dames encensées dans ses sonnets, et que
certaines de ces amours sont de si basses extrace, que lui-même avoue
se sentir honteux d'avoir aimé une négresse. Tu peux te faire une idée
des passions des grands poètes qui vont se ménager l'admiration des
générations tout au long de l'éternité… Je suis en général convaincu
par les amours des Elisiários, en particulier par l'amour du mari de ma
cousine. Je ne crois à la solidité d'aucun autre amour, ni à la
perspicacité de ceux qui étudient les femmes, et pensent qu'il existe
une orthopédie capable de redresser les fractures de l'âme.
Francisco Elisiário devina qu'Adriana prêtait l'oreille
aux suggestions de quelque méchant démon. Il fit le guet, et surprit
une domestique avec une lettre. Il voulut la lui arracher du sein avec
une arme blanche, vu que l'honnêteté de ses mœurs ne lui permettait pas
de s'en saisir à mains nues, dans un endroit aussi délicat, que sa
pudeur lui interdisait de toucher. Frissonnant de terreur, la
domestique lui remit la lettre rédigée à peu près en ces termes :
"Je suis allée hier au théâtre Lyrique. Quelle délicieuse
musique que celle du Trouvère ma
chère Adriana !… Je n'ai fait que
songer à toi : tu as été mon idée triste durant ces heures joyeuses !
Toi, si jeune et si belle, enfermée de la sorte, en train d'écouter
ronfler ce monstre !… Quelle vie que la tienne !… Quelle jeunesse
sacrifiée à cet or maudit et pesant comme la dalle d'une sépulture !…
Et ce qui est par-dessus tout atroce, c'est que ton mari jouit d'une
santé qui nous afflige ! Ça fait trois ans que tu en es lasse, et tu ne
m'as pas dit une seule fois que le teint de ton mari s'altérait !… Les
anges meurent, ils tombent malades, les hommes qui ont un cœur, comme
mon mari, tombent malades, et ce rustre est bien vivant, il jouit d'une
stupide santé !…" etc.
Elisiário alla trouver sa femme avec cette lettre, il
hulula un bon moment. Adriana finit par lui répondre, quand sa patience
fut à bout, et lui, affolé par la perspective d'une séparation, en vint
à brandir une chaise pour rabattre l'orgueil de sa femme.
Le lendemain, ma cousine s'enfuit chez son amie, où elle
écrivit à ma mère pour lui demander de l'amener chez elle, jusqu'à ce
qu'elle trouvât un couvent pour l'accueillir.
Ma mère se rendit à Porto, et amena Adriana chez elle, en
précisant bien qu'elle ne devait pas rester beaucoup de jours hors du
couvent, pour que les mauvaises langues ne versent pas leur poison sur
l'initiative qu'elle avait prise de s'enfuir.
Entre-temps, Francisco Elisário mit en œuvre certains
recours judiciaires pour ramener sa femme chez lui ; mais, protégée par
l'époux de son amie, Adriana trouva des astuces pour fausser la loi qui
protège les maris.
Ma cousine est restée quelques jours chez nous. Ma mère se
conduisit d'une façon austère, en se refusant à offrir un asile
permanent à une dame mariée, qui allait intenter une action discutable
pour divorcer de son mari, contre la volonté de celui-ci.
Elisiário avait doté sa femme de trente contos réis. Outre
les moyens de subvenir convenablement à ses besoins dans un couvent,
Adriana demandait ses bijoux, évalués à quatre mille cruzados, et rien
de plus.
Adriana était recluse à Vairão. Elle s'y accommodait mieux
de son existence. Elle avait pour elle la pureté de sa conscience.
Personne ne la surveillait, qui lui inspirât de la méfiance. Tous les
quinze jours, nous allions la voir, ma mère, ma femme et moi. Son mari,
cependant, rendu fou par la rage, à laquelle l'avait réduit son amour,
alléguait que sa femme s'était enfuie de chez lui pour rompre les liens
sacrés qu'elle avait acceptés devant l'autel. Cette phrase, qui
s'appuie sur les chaleureux applaudissements de la morale publique,
sentait son jurisconsulte ; Elisiário n'était pas un homme à phrases,
il n'eût même pas défendu la thèse du caractère sacré des liens
conjugaux. Il est pourtant certain que la jalousie lui brûlait les
entrailles, surtout le foie, un viscère qu'il avait ramené malade des
contrées africaines. Le bonhomme conçut le dégradant soupçon que je lui
faisais concurrence dans le cœur d'Adriana, la pauvre fille, qui
sentait à peine son cœur dans la crue de larmes qui s'épandait sur ses
joues pâles.
Un homme apparaît un jour chez moi, rond et cramoisi, les
yeux flamboyants, avec une cape en caoutchouc. C'était Francisco
Elisiário, qui venait demander à ma mère des comptes sur son épouse.
Quand elle vit, effarée, pour la première fois, le mari de sa nièce,
elle comprit les tourments de la malheureuse Adriana, durant trois
années où elle était restée irréprochable, et son épouvante face à une
créature aussi démodée. Comme il disait, dans un langage humain, qu'il
voulait sa femme, ma mère me pria d'accompagner à Vairão monsieur
Elisiário, et de m'arranger pour que ma cousine l'écoutât.
J'y suis parvenu. J'ai appris que dès qu'Elisiário est
entré dans le parloir, il a voulu s'agenouiller devant sa belle et pâle
épouse, qu'il est resté accroupi, accablé sous le poids de son foie, de
sa rate et des entrailles circonvoisines. Cette attitude, on ne peut
plus naturelle, qu'il ne tirait pas des jeunes premiers de comédie,
émut Adriana, qui lui dit de se relever, sur un ton qui trahissait une
touchante compassion. Elisiário exposa ses angoisses à son épouse, et
lui demanda, pour conclure, de revenir s'occuper de la maison qui
partait à vau l'eau.
L'expression 'à vau l'eau' sonna comme une fausse note aux
oreilles d'Adriana. Elle fut blessée de se voir juste indispensable
pour tenir la maison.
– Vous avez besoin d'une bonne, n'est-ce pas ? lui demanda
son épouse. Vous n'aurez pas de mal à trouver quelqu'un pour tenir
votre maison avec plus de zèle. Ce que je vous demande Monsieur
Elisiário, ce sont les bijoux qui appartenaient à ma sainte mère. Si
vous estimez que subvenir à mes besoins, c'est une aumône, je vous en
dispense ; mes parents me donneront les reliefs de leurs repas.
Le mari passa du ton suppliant à l'arrogance. Il déclara
qu'il ne donnerait rien à une épouse infidèle qui ne l'aimait pas.
L'épithète infidèle raviva la
plaie et la rancœur. Sommé de s'expliquer
sur la signification de ce mot, il répondit qu'une épouse qui acceptait
que l'on traitât son mari de monstre, était plus que perfide. Cet
argument, qui ne me paraît pas tout à fait idiot, fut le dernier que ma
cousine entendit. Elle se leva alors, fumante de fierté, et quitta le
parloir.
Francisco Elisiário gagna la cour du couvent, et me dit :
– Fort bien !
– Vous vous êtes réconciliés ? demandai-je avec un sincère
intérêt.
– Non, Monsieur… Le diable s'est chargé d'elle, mais si
vous croyez, Monsieur, que ma fortune va tomber entre ses mains, vous
vous trompez… pas même entre les vôtres… ajouta-t-il en comprimant,
avec ses poings, les proéminences adipeuses de son abdomen.
Je le regardai fixement, effaré, car il ne me paraissait
pas une chose aisée d'étrangler cet homme sans le gibet ad hoc, un
gibet spécial pour la strangulation de ce sphéroïde.
XVII
Antonio Joaquim reprit le fil de son récit :
– Francisco Elisario partit au galop, en agitant ses
jambes contre les flancs expiatoires de son mulet, et s'en fut droit à
Porto. Je revins au parloir pour manifester mon étonnement, et trouvai
ma cousine moyennement consternée, et plus disposée à plaisanter sur
mon ressentiment qu'à se lamenter sur la jalousie féroce de son mari.
Elle me rapporta l'essentiel de son entretien avec lui, et conclut en
me chargeant de recommander à ma mère de ne point craindre de l'avoir à
sa charge : elle était habituée au travail et à se montrer patiente,
elle trouverait elle-même assez de ressources pour se nourrir, sans
avoir à solliciter des faveurs contraintes. Adriana, comme tu vois,
avait mal pris l'idée que ma mère avait eue d'expédier son époux à
Vairão, et une lettre de pieuses admonestations en vue de les
réconcilier.
Je m'en allai, de là, chez moi, fort ému de l'infortune de
ma cousine, bien qu'elle l'atténuât par le faux sourire d'un honnête
dénuement. Pauvre fille ! Elle n'avait même pas droit au bonheur du
cœur, qui est la bonne monnaie fabriquée par les anges ; ni au bonheur
de l'esprit, qui est la fausse monnaie fabriquée par les hommes !
Se voir ainsi, si jeune, si bien pourvue de grâces, séquestrée loin du
monde, dont elle avait gardé de charmantes réminiscences, avec l'espoir
de trouver ce que le monde ne lui avait pas offert : une âme, une chose
qui paraît si facile à trouver, dans la mesure où il est établi et sûr
qu'il y a des personnes qui ont deux âmes, trois, ou plus à leur
disposition ! Adriana recluse dans un couvent, dans un sépulcre peuplé
de momies qui bougent, de nonnes qui avaient déjà envoyé leur esprit au
ciel, tandis que leur corps était resté là à se purger, dans la
pauvreté, de quelques vétilles qui n'avaient rien avoir avec leur âme.
Comment allait-elle gâter sa vie, sans arrêter de se ronger, cette
femme de vingt ans, incapable de demander à la société une place au
banquet de ses allégresses faciles, peut-être criminelles, mais rendues
exemplaires par bien des femmes sans excuse.
Voilà les réflexions que je fis, entre autres, à ma mère,
qui pleura copieusement, et promit d'aller chercher Adriana au couvent,
et de mépriser les médisances du monde, en faisant appel du jugement
perverti des hommes devant le tribunal divin. Elle se rendit pourtant
elle-même à Vairão, avant de recourir à ce louable expédient, pour
essayer de convaincre sa nièce de sacrifier quelques années de sa
jeunesse, à une vieillesse tranquille. Elle lui demanda d'écrire à son
mari en des termes plus souples, l'invitant à une réconciliation, tout
en tirant parti qu'il ne la tiendrait pas enfermée comme une épouse
indigne de sa confiance.
Adriana obtempéra. Elle avait déjà obtempéré à sa raison
qui lui parlait par la serrure du coffre de Francisco Elisiário.
Excusons-la, que les femmes l'excusent, qui ont plus de poésie en leur
sein que tous les sonnets de Pétrarque ; qu'elles l'excusent, les
vierges aux yeux humides, qui marchent au bord des fanges de ce monde,
et, par miracle, n'y tombent pas, quand elles lèvent les yeux sur
l'azur du firmament ! Que l'excusent, enfin, les âmes pleines
d'expérience, qui savent ce qu'est la raison quand elle parle par la
serrure d'un coffre dont les entrailles recèlent cent contos, bien que
sur ce coffre soit assis, comme sur un tonneau, un Silène qui,
lorsqu'il rit de ce monde, fend, d'une oreille à l'autre, une bouche
semblable à celle de l'enfer, qui absorbe toutes les intentions
généreuses, toute la poésie dorée, toutes les visions angéliques et
blondes du meilleur des cœurs.
Je le coupai :
– On lui pardonne ! Je te déclare, au nom du globe qui a
l'honneur de nous avoir, que ta cousine est pardonnée. Elle a donc
écrit à son mari…
– Oui… J'ai accompagné à Porto ma mère qui portait cette
lettre, qui malheureusement, était une lettre avec du style, une lettre
où elle avait mis toute sa tête, dont les expressions dénotaient les
répugnances de son cœur, une lettre qui pouvait être aussi bien sainte
qu'immorale, sainte parce qu'elle tendait son cou au joug, immorale
parce que c'était l'amour de l'argent qui la faisait mentir.
Francisco Elisiário ne la comprit pas, non plus que ma
mère ne comprenait ce qu'il y avait de mieux chez elle, quand le mari
d'Adriana lui demandait ce que signifiait ce verbiage.
– Ce n'est pas compréhensible ! hurla-t-il. Ma femme dit
ici…
Et il lut :
– "Je te donne mon âme ; je te donne ma vie ; mais je veux
de l'air, je veux être libre de respirer." Lui ai-je une seule fois
interdit de respirer ?! demanda-t-il, courroucé. Votre nièce vous
a-t-elle dit que je ne la laissais pas prendre sa respiration ?!
– Non, Monsieur Francisco, répondit ma mère. Adriana veut
dire, je pense, qu'elle a besoin de plus de liberté, de plus de
confiance de votre part.
– Elle en tient une couche ! s'exclama cet époux dans son
langage pittoresque. Regardez-moi, s'il vous plaît ce front ! Y
voyez-vous un T[23]?
– Non, Monsieur.
– Je ne sais pas alors que faire avec elle, mon amie ? La
liberté, cela consiste à tenir la maison de son mari. Les comédies et
les ballets, c'est ça qu'elle veut ? Les comédies entraînent la
perdition du genre humain ; les bals sont des lacs que tend le démon
aux créatures appartenant au sexe faible. J'en connais, moi, des
histoires, à ce sujet, Madame, il y a là de quoi se prendre la tête à
deux mains !… Voulez-vous savoir ? C'était une belle fredaine, de ma
part, d'épouser votre nièce. C'est ce que me dit tout le monde.
– Une fredaine ! lança ma mère, avec une rude franchise.
Ce que vous avez fait, Monsieur Francisco, à soixante ans, c'est une
fredaine bien tardive… Vous étiez assez âgé pour réfléchir…
– Vous me trouvez très vieux ?! fit-il rageusement.
Écoutez : je pouvais choisir, je me suis marié par charité… Un homme
qui dispose de cent contos...
– ...se marie par charité...
– Parfaitement, il n'y a rien à ajouter. En tout état de
cause, je répondrai à la lettre de ma femme après avoir réfléchi à
cette affaire. Je vais consulter mon associé.
– Pas besoin de le faire, Monsieur Francisco, dit ma mère,
en se levant pour partir. Votre femme a du pain chez moi, et assez de
vertu en elle-même pour mériter que Dieu vous fasse éprouver des
remords pour l'avoir calomniée.
Je présume que Francisco Elisiário en a été quelque peu
ébranlé, mais il a voulu aller consulter son associé. Connais-tu
Eusébio Luís Trofa ?
– Je connais ce particulier, et je le respecte. C'est un
homme honnête, d'après ce que disent tous les gens qui s'y connaissent
en hommes honnêtes.
– Sans vouloir te démentir ainsi que tout ce monde-là
permets-moi de t'expliquer sur quel ciment repose l'honnêteté du sieur
Eusébio Luís Trofa, le Castor, de ce Pollux-Elisiário. Sa tête, on
dirait celle du castor amphibien appartenant à l'ordre des mammifères
rongeurs (Castor-Euzebius de
Linné).
Francisco Elisiário a réuni un important capital parce
qu'il était malin…
Je le coupai :
– Il a fort bien fait. L'intelligence universelle, à mon
avis, est parfaitement illustrée par ceux qui l'emploient à s'enrichir.
Dans l'abattement de ma stupide pauvreté, je garde encore l'œil
pénétrant de ma conscience pour voir et admirer la perspicacité des
hommes qui s'enrichissent et plus encore celle des richards qui
conservent, avec les applaudissements du public, l'étiquette de
l'honnêteté. C'est là que réside la connaissance, c'est ce qui prouve
la grande portée de l'intelligence humaine !… Tu vas me raconter, en
faisant de grandes phrases, l'histoire d'Eusébio Luís, croyant que tu
me feras grimacer, sous l'effet d'un étrange effarement. Le bonhomme
a-t-il décapité quelque ami millionnaire ? A-t-il empoisonné trois
familles qui ont fait de lui leur héritier ?
– Pas du tout : il s'est marié avec la mère d'un défunt
ami, qui lui avait laissé une bonne poignée de contos…
– Est-ce là un péché qui prouve l'astuce d'Eusébio Luís
Trofa !? Tu me sembles… La gratitude que je te dois en partageant ta
litière m'empêche de te dire que tu me sembles fou à lier !
– Attends, la morale de cette histoire se trouve dans son
prologue. Dans le bourg d'Arcos, il y avait une pauvre journalière qui,
cela doit faire quatorze ans, cassait des cailloux sur la route de
Porto à Braga. C'était une créature misérable et sale de cinquante et
quelques années, racornie par l'ardeur du soleil, les mains et les
pieds meurtris et désarticulés à force de marteler et de charger des
pierres.
Cette femme avait envoyé au Brésil un fils qui avait à
peine connu le nom de son père, et arriva facilement à oublier celui de
sa mère. Au moment où il réalisait cent contos réis avec lesquels il
projetait de rentrer en Europe, ce particulier est mort sans prendre de
dispositions. L'héritage fut déposé au consulat portugais, en attendant
qu'on trouve à qui il devait revenir.
Eusébio Luís, naturel d'Arcos, savait d'où venait le
défunt, comme il le déclara au consulat. Les papiers correspondants
parvinrent au Portugal, Eusébio prit le paquebot qui les amenait.
Il arriva à Arcos, et chercha habilement à savoir ce
qu'était devenue la mère du défunt. D'halte en halte, il finit par
tomber sur elle en train de casser des cailloux sur le viaduc d'Arnoso.
Il la prit à part, et lui dit qu'il avait fait la connaissance de son
fils au Brésil, et qu'il était mandaté pour rechercher et offrir son
aide à la mère de son ami, en la tirant sans attendre de la mauvaise
passe où il pourrait la trouver. Sur quoi, il l'emmena à Braga,
l'habilla modestement et correctement, s'assit avec elle à une table
bien garnie, et fit bien attention à ce qu'elle ne fût pas victime
d'une indigestion.
Au bout de trois jours, il partit avec elle pour Porto.
Plus de six personnes recherchaient cependant à Arcos la
mère Antónia Pires, mère du défunt João Pires de Almeida, et partaient
d'Arcos pour la chercher sur la route. L'ingénieur en chef n'en
finissait plus de répondre aux questions de tous les mandataires
intéressés par cet héritage, qui se cachaient les uns des autres.
Eusébio Luís Trofa lut des annonces où l'on invitait Antónia Pires à ne
pas se laisser circonvenir par un fripon qui était venu la trouver au
viaduc d'Arnoso. À la préfecture de Porto, on avait déjà donné des
instructions pour découvrir cette femme qui avait été enlevée ; et l'on
prenait des mesures pour annuler tout contrat entaché de fraude et de
dol que l'on serait amené à découvrir. Eusébio demanda conseil à son
ami Francisco Elisiário.
Réponse de cet homme honnête :
– Ce que vous devez faire tout de suite, c'est vous marier
avec elle : qu'on plante les dents sur votre ombre, après.
Antónia Pires fut littéralement foudroyée quand Eusébio
lui offrit sa grande main grasse, et pour son costume de mariage, un
coupon de soie jaune, et un chapeau vert avec des rubans rouges, orné
d'une treille avec deux grappes de raisin noir, et un petit oiseau dans
le feuillage, qui avait bien l'air d'une calandre.
Tout cela ravit Antónia Pires, qui avait tant de fois
pétri les croûtes de son pain avec ses larmes.
Le mariage fut célébré à Cedofeita, avec une dispense pour
les bans, et les époux revinrent dans une voiture, avec les témoins, et
s'en furent dîner à Reimão.
Quelques jours après, Eusébio annonça à son épouse que son
fils était mort. Antónia pleura, comme toutes les mères ; et quand elle
apprit l'excusable astuce de son mari, qui l'aimait de toute son âme,
elle pleura encore pour s'être enrichie contre volonté de son fils
ingrat.
Eusébio laissa sa femme à Porto, en la confiant aux bons
soins de son ami Elisiário, et partit par le paquebot suivant récupérer
l'héritage de son beau-fils. Tu as là un échantillon de la biographie
d'Eusébio Luís Trofa.
– Je ne vois là aucune immoralité, António Joaquim, lui
fis-je observer. Si Eusébio Luís n'avait pas épousé Dona Antónia Pires,
une personne pour qui j'éprouve le plus grand respect, je l'aurais
fait, et je ne sais si tu ne l'aurais pas fait, toi, dans un pays où la
bigamie eût été permise. J'ai l'honneur de connaître cette dame, je
l'ai vue pleurer au cours de maintes soirées au théâtre de São João,
quand un tyran, dans les drames, voulait découper en tranches ses
victimes ingénues. Ces larmes dénotent autant de sensibilité que
d'intelligence. Pour ce qui est de son visage, s'il ne nous transporte
pas, il n'est pas non plus repoussant. Les plumes de marabout, les
rubans, les fleurs, les broches, et l'auréole idéale qui dore toutes
les têtes cotées à cent contos réis, je ne te dirai pas qu'elles
l'embellissent mais, du point de vue esthétique et plastique, elles lui
impriment un je ne sais quoi qui force la sympathie. Je ne vois pas sur
quoi tu te fondes en réalité pour critiquer Eusébio Luís qui est
toléré, et s'attire les louanges des particuliers qui persiflent les
Eusébio. Le bonhomme a exploité le cœur de sa femme ? Il l'a épousé
pour la seule raison qu'elle était riche ? Il y a là de quoi en tomber
des nues ! Combien d'Argonautes connais-je qui ont conquis leur toison
d'or en traversant des mers plus fangeuses !… Combien de jeunes gens
ai-je vus, qui semblaient calcinés par la soif de l'idéal, courber la
tête pour se désaltérer aux immondes sources d'une sordide cupidité !
Et tu crois que les railleries du monde les mortifient ? Que Dieu
m'aide ! Les railleries du monde ont cessé de les mortifier dès qu'ils
ont pataugé dans le bourbier commun, et constaté que les lois de
l'esprit nous élèvent dans les sphères de l'idéal, tandis que les lois
inviolables de la matière nous poussent vers la stupide douceur de
posséder cent contos réis. La sentimentalité, la poésie, cet élément
subtil et pur de l'intelligence, qui nous rend éternels, et nous ouvre
le ciel, c'est ce qui nous est resté de l'Adam primitif, avant son
faux-pas ; c'est une réminiscence de la première cabane que le Créateur
a construite pour l'homme au centre de la création, son royaume ; mais,
après la chute dont l'humanité a subi les effets, il faut que tout le
monde tombe dans le bourbier, où fermente cet élément fétide qu'on
appelle l'argent. N'as-tu pas vu le poète Lamartine s'entretenir, parmi
les nuages, avec les anges ? Tu sauras donc qu'il en descendu hier pour
demander ici-bas de l'argent à la France ? N'entends-tu pas au
Portugal, comme en n'importe quel endroit, dans le monde, où il y a des
écrivains, des grands poètes, des êtres qui interprètent les petits
oiseaux, les pelouses, et les brises, hurler que l'on fasse une loi sur
la propriété littéraire, la propriété d'une ode à la lune, et d'une
autre au soleil, et de quatrains à une fille avec trois étoiles ?
N'entends-tu pas tout ce tapage pour demander de l'argent ? Comment
expliques-tu ton étonnement quand des hommes de l'espèce d'Eusébio
ramassent une centaine de contos par le moyen le plus honnête et le
plus licite qui soit ? Que dis-tu du Prince de Polignac marié avec la
fille du capitaliste Mirés ? Qui se moque d'unions de la sorte si
fréquentes au Portugal, et précédées d'épisodes bien plus ridicules du
mariage de son Excellence avec Dona Antónia Pires ?
– Je suis pantois ! s'exclama António Joaquim. Tu gardes à
ta disposition des torrents de mots qui agissent comme des cataplasmes
émollients sur mon esprit. La litière t'abrutit, mon vieux ! Si tu
veux, saute dehors, et prends l'air.
– Je vais bien, je suis une brute, suffisamment au moins
pour être heureux ; mais ces réformes s'effectuent lentement. Revenons
au conte.
XVIII
– On a commencé par me dire à Porto, poursuivit mon ami,
qu'Eusébio
Luís Trofa était affligé d'entrailles pestilentielles, et pesait son
poids sur l'esprit, ou les lombes de Francisco Elisiário, en l'absence
d'esprit. Nonobstant, dès que j'ai appris quelle était la seconde
conscience du mari de ma cousine, je suis allé voir le richard, afin de
le gagner à la cause de la recluse de Vairão. Je savais que j'aurais
affaire à un homme astucieux, d'une méchante astuce, avec la fourberie
que donne la méchanceté, qui est le degré suprême de l'astuce humaine.
En ce temps-là, mon énergie morale n'avait rien à envier à la sainte
bravoure des anciens apôtres, qui prêchaient aux princes barbares la
loi du Christ, le civilisateur des âmes…
Je le coupai :
– Tu m'as bien l'air d'un apôtre à cette heure ! À propos
du sieur Trofa, je trouve que tu jettes ton style par les fenêtres ! Où
allais-tu prêcher, António !.
– Tu n'en reviendras pas de l'omnipotence de ma parole, et
du lieu que j'ai choisi pour exercer mon éloquence. L'on m'a dit
qu'Eusébio Luís et son épouse se trouvaient au théâtre de São João en
train d'assister pour la douzième fois à une représentation du Massacre
des Innocents, une tragédie capable d'ébranler à ce point les
esprits,
que toutes les personnes qui la voyaient en devenaient meilleures. Je
suis entré dans leur loge, au moment où Hérode donne l'ordre d'égorger
tous les enfants de Judée, avant que le rideau tombe sur cet immonde
carnage, qui va se poursuivre entre chaque scène. Dona Antónia imbibait
à cette occasion son mouchoir de ses larmes, tandis qu'Eusébio Luís, du
pouce de sa main droite, et du pouce de sa main gauche, se frottait les
deux yeux, comme si les larmes les démangeaient. C'est ce que je voyais
par la fente de la porte. Je suis entré avant que les robinets de la
sensibilité ouverts par Hérode, ne se refermassent. Je leur présentai
les civilités d'usage, et invoquai mon inspiration. Eusébio crut, au
premier abord, que j'étais un acteur qui allait leur proposer un billet
pour son compte, et s'empressa de dire :
– Si c'est pour la Décollation
des Innocents, je garde ma
loge.
– Je ne suis pas acteur, dis-je, d'une voix caverneuse,
avec un geste soulignant mon accablement. Je suis le messager d'une âme
qui souffre, d'une créature en plein désarroi, aussi innocente que les
enfants que le sacrilège Hérode vient de faire égorger !
Dona Antónia ouvrit la bouche, son mari ferma la sienne.
J'observai cette composition, et me dis qu'un sentiment identique
produisait des effets opposés sur les articulations maxillaires des
deux époux ; à partir de cette opération mécanique, j'inférai que la
bouche des deux personnes était l'organe qui manifestait les sensations
de leurs âmes, un fait important, sinon unique, pour d'éventuelles
recherches, qui seraient de nature à confirmer l'hypothèse qu'il n'y a
aucune âme, ni aucune essence corporelle, et que le siège des
sensations se trouve dans les mentons.
Dès que Dona Antónia commença à fermer sa bouche, et
Eusébio à ouvrir la sienne, suivant la nature de chacun d'entre eux, je
profitai habilement de ces deux minutes où ils étaient pris au dépourvu
pour dire, d'une voix plaintive :
– La malheureuse qui souffre, c'est Adriana, l'épouse
infortunée de Francisco Belisário, un homme honorable, mais injuste ;
le cœur d'un ange, mais d'un ange déchu de sa grandeur. Oui !
poursuivis-je, les yeux et les oreilles de chacun étant suspendus à mes
lèvres. Oui ! Adriana, pourrait, à ce moment précis, comme vous, Dona
Antónia, savourer le doux plaisir de voir l'innocence égorgée, un
plaisir innocent que les Hérode de notre temps pourchassent
tyranniquement. Quel mal a-t-elle fait au monde, quel mal a-t-elle fait
à son mari, la noble Adriana, pour se retrouver, à la fleur de l'âge,
dans les fers, enfermée dans un couvent, qui regrette son mari, bien
que… oui, bien qu'il ait voulu, dis-je, l'ensevelir vivante !
– Je n'arrive pas à y croire ! fit Eusébio, prenant un air
sévère pour défendre son ami. Francisco Elisário, mon associé en est
incapable… L'ensevelir vivante !… Qui que vous soyez, Monsieur, vous
vous trompez. Mon ami a eu des mots avec sa femme, il a voulu la
frapper avec une chaise ; mais ne l'a pas touchée. Voilà ce qui s'est
passé. Mais là, qu'il veuille la faire mourir à petit feu, c'est des
craques.
– Permettez-moi de vous expliquer, Monsieur Eusébio Luís,
répondis-je. Enterrer une femme vivante, savez-vous ce que c'est ?
Savez-vous ce que c'est Dona Antónia ? Oh ! Vous ne le savez pas, parce
que Dieu vous a procuré un mari qui est la bonté faite homme, et le
cœur le plus généreux que l'on puisse trouver dans la poitrine d'un
mari ! Un mari qui vous accompagne au jardin de São Lazáro, aux
Fontainhas[24] ; un mari
qui vous a fait connaître les savoureux
goûters du Reimão ; un mari qui vous amène au théâtre ; un mari, en un
mot, qui devine vos désirs pour joncher de fleurs le chemin de votre
vie. Qui a un mari comme le vôtre, Dona Antónia ?
– Dieu merci ! lâcha-t-elle, ébranlée, attendrie jusqu'aux
larmes. J'ai un mari comme il y en a peu.
– Je n'en connais pas d'autre, rétorquai-je.
– Ce sont là des attentions ! murmura Eusébio ; et il
continua, faisant siffler une pincée de tabac en poudre, avant d'en
chasser les grains du plastron de sa chemise avec ses infaillibles
pichenettes : écoutez, mon ami, Francisco Belisário n'est pas non plus
un mauvais mari, ajouta-t-il.
– Je ne crois pas que ce soit le cas ; mais une injuste
jalousie affecte sa bonté, et le bonheur de son épouse. Et vous,
Monsieur Eusébio, qui êtes marié à Adriana, l'enfermeriez-vous chez
vous, la privant de tous les plaisirs honnêtes de cette vie ? La
laisseriez-vous pleurer dans une silencieuse solitude la perte de ses
parents qui l'aimaient tant ? La laisseriez-vous s'abandonner à sa
propre douleur, se rongeant faute de pouvoir s'entretenir avec ses
amies, aller aux fêtes de l'église, de visiter les autels durant la
semaine sainte, de se détendre un dimanche ou un autre à la campagne,
de voir le Massacre des Innocents,
ou Saint Antoine le Thaumaturge ?
Feriez-vous cela à votre femme ?
– Moi, non !
– Voilà ce que c'est, Monsieur Eusébio, que d'ensevelir sa
femme vivante ! Voilà ce qu'a fait votre associé à sa candide, à son
innocente épouse qui, pour leur malheur à tous les deux, lui a confié
sa jeunesse, sa beauté, sa vertu, ses espoirs, Tout, Monsieur Eusébio,
tout, Dona Antónia !
À ce moment, Dona Antónia fit tenir son mouchoir dans sa
main droite, et le colla à son œil droit, comme qui applique une
ventouse. Son mari remplissait ses doigts de tabac, et s'en
administrait des prises comme s'il voulait boucher les canaux par où
coulaient les larmes qui engorgeaient le fond de son cœur.
Le rideau se leva, laissant, sur la scène sanguinaire, la
place aux bourreaux d'Hérode. J'allais prendre congé, quand Eusébio me
barra le chemin, avec une mine engageante, en me disant :
– Je veux encore parler d'autre chose avec vous ; restez
jusqu'à la fin de la pièce, si cela ne vous dérange pas.
J'assistai au dernier acte du Massacre. À certains moments
où la sottise de la tragédie était capitale, j'ai eu l'impression
qu'une lame passait sur ma gorge pour trancher mes chairs. La langue
portugaise et le sens commun ne pleuraient pas moins que les mères des
enfants décapités ; mais celle qui pleurait plus que les mères juives
et la grammaire de nos fort chrétiens aïeux, c'était Dona Antónia.
Je te dis qu'il n'y a pas, en vérité, de vertus là où
manque un cœur susceptible de compatir à de fantastiques infortunes.
Dieu me garde des âmes calcinées qui observent les spectacles des
tragiques avec un regard trahissant leur dédain de l'art ! Cela me fait
plaisir, et cela m'a déjà fait plaisir de te dire que ma femme pleure
en lisant tes romans. Si elle éclatait de rire devant les jérémiades
qui sortent de ta plume, et mettait en doute la vraisemblance des
angoisses de tes personnages, je me tiendrais sur mes gardes. Dans la
loge voisine de celle de Dona Antónia, il y avait quatre jeunes filles
vêtues en blanc et en rose : on eût dit des séraphins qui auraient
obtenu du Seigneur la permission de descendre au théâtre São João, pour
voir comment leurs pauvres frères innocents avaient été décollés il y a
mille huit cent cinquante et quelques années. Eh bien, ces jeunes
filles, à chaque épisode écumant de sang à briser sur scène les cœurs,
reniflaient à force de rire au point d'attirer l'attention des loges
voisines. Quand elles regardaient Dona Antónia et la voyaient pleurer,
les yeux tout rouges, elles rapprochaient leurs visages, et elles
éternuaient pour ne pas briser leurs côtes sous la pression de leur
corset. Ces quatre demoiselles devaient avoir à l'orchestre quatre
fervents admirateurs de leur esprit, qui se glorifiaient d'être aimés
de femmes à l'esprit critique, des femmes bien supérieures aux
insanités de ce drame. Je regrette de ne pas connaître leur nom, je te
demanderais si ces quatre séraphins ont assuré le bonheur domestique de
leurs maris. Ô mon ami, la femme sincèrement femme, c'est celle qui a
un cœur à même de distinguer une pensée douloureuse derrière les formes
grotesques dont l'affublent des esprits grossiers. Quel rapport entre
les procédés de l'art et une âme simple à qui suffisent les mille
tristesses sans artifices que la nature lui révèle ?…
– Et que t'a dit Eusébio Luís, après ? lui demandai-je, en
le coupant, avant que vous ne me coupiez, cher lecteur.
– Eusébio m'a dit, répondit António Joaquim, de venir le
retrouver le lendemain, à son bureau, vers midi.
Ma mère se réjouit de partager mes espoirs et voulut à
tout prix faire la connaissance de Dona Antónia Pires, dès que je lui
ai dit que celle-ci pleurait à chaudes larmes. J'ai compris que réunir
ces deux larmoyantes personnes, c'était le plus sût moyen de garantir
le succès de mon entreprise, que j'avais entamée par une sottise, que
seule la chance des fous pouvait permettre de mener à bien.
Quand j'entrai dans son bureau, je demandai à Eusébio
l'autorisation de présenter ma mère à Dona Antónia.
Tu vas pouvoir à présent constater que je ne manque pas
tout à fait d'ingéniosité pour élaborer l'intrigue d'un roman.
Je te prépare une surprise ! Si j'étais un narrateur
ordinaire, tes lecteurs croiraient, si ça se trouve, que cette histoire
m'a été racontée par un des ces deux baudets, sans que cet âne faiseur
de romans fît ainsi honneur à son aïeule qui a aussi improvisé des
histoires sous les jambes de Balaam.
XIX
Eusébio avait envoyé avec nous un commis pour nous
introduire dans le
salon où Dona Antónia devait recevoir nos hommages.
Comme cette dame se fit attendre quelques minutes, ce qui
arrive toujours à celles qui ne s'apprêtent pas et ne se parent pas
pour gouverner leur maison, ma mère[25] trouva l'attente bien courte
pour admirer les pompes et les bibelots qui agrémentaient le salon de
Monsieur Ensébio Luís Trofa.
Moi aussi, j'étais occupé à observer un petit noir en
argile qui montrait une langue de carton rouge, en écarquillant des
yeux de verre. Ce petit noir, coté à douze vinténs, se trouvait entre
deux vases chinois, avec des fleurs de Constantin.
Sur le piédestal d'un chronomètre qui arborait à son
sommet une statue de Wellington, j'ai vu un chien en verre avec un
petit panier dans la bouche, et un étui à cigarettes en verroterie avec
les initiales d'Eusébio Luís.
Sur les étagères
laquées aux angles de la salle,
brillaient les jouets mécaniques pour enfants les mieux conçus, des
chats qui miaulaient, des poules qui gloussaient au milieu de leurs
poussins, des escadrons de cavalerie en plomb, disposés en ordre de
bataille, en face d'autres escadrons.
Ma mère trouvait cela ravissant, et moi j'étais disposé à
passer là quelques heures à savourer une exposition du bon goût d'un
homme riche.
Je n'oublierai pas que le tapis était d'un velours
duveteux, un revêtement apparemment idéal pour la sieste de princesses
maures, tandis que le seuil de la porte et les jambages des fenêtres
étaient recouverts d'essuie-pieds de paille, d'une valeur approximative
et 110 réis chacun.
À l'un des murs, il y avait les deux portraits en pied
d'Eusébio Luís et de madame, parfaitement rendus par le délicat pinceau
de Resende ; l'autre était rehaussé par les couleurs vives d'une nature
morte, où ressortait en pleine lumière l'appétissant écarlate d'une
pastèque ouverte, en tranches, ainsi qu'une corbeille de pêches sur la
surface desquels suintait un doux jus.
À un autre, pendaient des cordons de soie avec, à leur
bout, des houppes frangées d'or, dix panneaux racontant l'histoire du
fils prodigue, qui ne portait pas un habit noir, comme l'a imaginé un
barbouilleur français, mais un veston patriarcal, en accord avec
l'époque biblique de cette scène édifiante.
Sur l'autre mur de ce grand salon carré, il y avait les
fenêtres garnies de rideaux damassés de différentes couleurs,
resplendissants, très longs, lardés d'embrasses d'émail. Or, comme je
t'ai dit, les bordures de ces rideaux tombaient sur des essuie-pieds de
paille.
Je commençais à rire, quand Dona Antónia entra dans le
salon. Ma mère se leva à grand peine de la chaise rembourrée, où elle
s'était enfoncée, et tendit la main à la protectrice éventuelle de sa
nièce. Dona Antónia s'arrête, fixe intensément le visage de ma mère, et
murmure :
– Madame…
– Je suis la tante d'Adriana, je viens vous demander
d'intercéder auprès de monsieur Francisco Elisiário, non pour le prier
de pardonner quelque faute à son épouse, car elle est aussi innocente
que les anges du ciel ; mais de la traiter avec l'amour qu'elle mérite
et de ne pas lui imposer ce triste esclavage que ne sauraient endurer
des épouses de vingt ans.
– Mais vous-même, lui répondit Dona Antónia tout émue, les
yeux embués de larmes, comment vous appelez-vous ?
– Maria Carlota.
– De la maison de Reboldães ?
– Oui Madame, dit ma mère. Vous connaissez donc ma famille
?!
– Et c'est là Monsieur votre fils Antoninho ? reprit Dona
Antónia.
– Oui, Madame.
L'épouse d'Eusébio Luís se précipita sur moi, me serra
contre son sein, et s'écria :
– Ô mon petit Antoninho !
C'est dans cette attitude que nous surprit son mari.
– Il n'a pas dû être moins effaré que moi ! fis-je
remarquer à mon véritable ami, à António Joaquim. Dissipe mon anxiété !
Je croirai que tu me mènes en bateau avec la plus désastreuse
imagination qui soit, si tu ne te dégages pas naturellement des bras de
Dona Antónia ! Il me semble que la nature ne s'est pas livrée deux fois
à de telles insanités !
– Tu vas donc encore rester pantois de l'extrême
simplicité de cet incident. Dona Antónia s'assit, en larmes, et dit à
son mari, d'une voix entrecoupée de sanglots :
– Je t'ai raconté, Eusébio, toute ma triste vie. Te
rappelles-tu cette dame qui a payé une femme afin qu'elle allaite mon
fils, pour que j'allaite le sien, quand elle m'a vue sans ressources ?
Voilà l'enfant que j'ai nourri à mon sein.
Ma mère se précipita sur Dona Antónia pour l'embrasser,
comme si elle se réveillait en sursaut d'un rêve joyeux. Eusébio fit
voir, sur son visage, sa bonté naturelle. Moi, j'étais suffisamment ému
par le tableau de ces deux vieilles embrassées, que j'en avais des
frissons dans les veines et les cheveux. À mes yeux auxquels, par
moments, la poésie du ciel présente son prisme, toutes les deux
semblaient un seul être, je voyais là réunis les bienfaits maternels ;
l'une m'avait donné au monde ; l'autre m'avait donné son sang.
La suite de l'histoire se résume aussi en peu de mots.
Le mari d'Antónia est mort quand son fils avait six ans.
Avec les économies qu'elle avait réunies en travaillant, et les gains
d'un compère, la mère a envoyé son fils au Brésil. Le fils a fait
fortune, il est mort sans penser aux sacrifices de sa mère. Tu connais
les misérables conditions de vie de la pauvre femme, quand Ensébio Luís
Trofa est allé la trouver au viaduc d'Arnoso.
Dona Antónia fit fermer les portes de sa maison pour nous
empêcher d'en sortir. Au bout de trois jours, et de quelques entretiens
entre le négociant et son associé, nous sommes tous partis pour Vairão.
Francisco Elisiário était ému et joyeux, il me demandait pardon de
s'être comporté grossièrement avec moi, baisait les mains de ma mère,
en lui promettant d'être un digne mari pour sa nièce.
Adriana quitta le couvent, en se fiant à ces paroles de
Dona Antónia : "Vous allez avoir dorénavant une mère en moi qui vous
préservera des rigueurs de votre mari. Je suis depuis toujours amie des
divertissements ; ma fille ira partout où j'irai, et où elle voudra
prendre du bon temps."
Nous revînmes à Porto. Le surlendemain de notre arrivée,
l'on décapitait les innocents au Théâtre de São João. Nous assistâmes à
l'exécution. Ma mère pleura plus que Dona Antónia ; et Francisco
Elisiário interrompit par moments le spectacle en réprouvant la
canailleries d'Hérode, lançant des apostrophes bien plus éloquentes que
celles de l'auteur de la pièce.
Ma cousine n'a ni pleuré ni ri, parce qu'elle a passé tout
son temps à examiner les robes et les coiffures des dames qui
l'observaient avec un sourire moqueur. Adriana s'était présentée au
théâtre, mise et coiffée comme si elle s'y était préparée une année
entière, en attendant cette soirée.
Le lendemain, Eusébio Luís donna un dîner dansant. De cinq
heures de l'après-midi à deux heures du matin, les salons opulents,
ouverts pour la première fois, furent le théâtre d'une grande
animation. Le profusion du service fut telle que moi-même, en écrivant
le premier article de ma vie dans un journal local, je me suis dit que
je devais écrire profusion avec deux ff, pour établir une distinction
dont je n'ai trouvé aucune trace dans le dictionnaire des synonymes. Je
ne sais si c'est toi ou un autre journaliste qui m'a fait alors
observer qu'il n'était pas licite d'altérer l'orthographe pour obliger
un ami, et que l'abondance des liqueurs ne devait pas pousser nos
instincts révolutionnaires à ne plus tenir compte de l'étymologie des
mots. Je n'ai pas défié le benêt qui m'a provoqué, parce que je
ressentais un tel bonheur que j'étais prêt à pardonner aux enragés de
grammaire. C'est le bonheur de ma cousine qui transportait mon cœur.
Francisco Elisiário a donné, lui aussi, un dîner dansant.
Adriana arbora, à ce bal, les bijoux de sa mère, et d'autres que son
mari lui avait offerts comme gages d'une alliance éternelle. À la
minuit de ce jour de fête, ma cousine dégrafa du devant de sa robe un
beau brillant, et, en présence de son mari, elle me dit :
– Acceptez, mon cousin, cette pierre, comme souvenir de la
profonde reconnaissance d'une femme qui te remercie pour le bonheur de
son mari.
J'ai accepté la pierre que tu vois là.
C'est la fin de cette histoire.
Francisco Elisiário est un mari qui peut dire hardiment,
au milieu de la société la plus dégénérée que tu puisses concevoir, que
son honneur est préservé dans le cœur immaculé de son épouse, comme les
encens consacrés à Dieu dans l'urne d'or que tient un lévite dans ses
mains. Et pourtant, Adriana assiste à tous les bals, à tous les
spectacles, fréquente ses amies, exceptée l'une d'entre elles qui a
traité son mari de monstre, si tu te souviens encore du début de cette
histoire.
XX
MON HISTOIRE
– L'occasion s'offre à moi de te raconter, à toi, une
histoire, quoique, sincèrement, je regrette de ne pas t'entendre
entre-temps, dis-je, avec le ton courtois des esprits chagrins de La
Cour au Village de Rodrigues Lobo[26]. L'histoire des brillants de ta
cousine me rappelle un incident qui m'a fait beaucoup rire, et dont je
ne saurais vraiment rendre la drôlerie. Cela s'est passé à Lisbonne, il
y a quinze ans.
Un ami à moi, du nom de José Cabral, un garçon fort galant
et courtisé, éprouvait quelque tendresse pour une séculière recueillie
dans l'un des couvents les plus huppés de Lisbonne. C'était une
personne d'un âge moyen, ou moyenâgeuse pour tenir compte de la façon
qu'il avait de se corriger malicieusement, en croyant, par cette
plaisanterie, rabattre le caquet de ceux qui déploraient son amour pour
les quarante ans de Dona Paula Manuel Chichorro. Un sang fort noble
coulait dans les veines de cette dame, qui jouissait d'un patrimoine
régulier ; mais sa tête était un tant soit peu dérangée par la manie,
qu'elle entretenait depuis vingt-cinq ans, de se rendre éternelle grâce
aux vers d'un poète, comme la Marília de Gonzaga[27] et l'Elvire
du
poète des Méditations.
Pour y parvenir, elle se laissa courtiser par divers
poètes, dont certains, de 1834 à 1844, lui consacrèrent des vers qu'ils
publièrent, de quoi assurer l'éternité à cette illustre dame, s'ils
avaient été lus. Les années qui se sont alors succédé, furent secouées
de troubles politiques. Toute fleur de poésie était arrachée par les
bourrasques de la prose financière, et jetée aux quatre vents qui
secouent les éventails de l'humanité. Cela explique, sans ternir
l'éclat des bardes qui ont chanté Dona Paula Chichorro, que la décade
la plus fleurie de grâces se soit écoulée, sans que le monde sût qui
préludait en heptasyllabes à son éternité.
À l'approche de ses quarante ans, bien qu'ayant vieilli et
perdu une partie de ses attraits, elle s'obstina à vouloir se perpétuer
en ayant recours à l'honnête expédient des muses.
José Cabral, qui avait des liens de parenté avec une
religieuse du couvent de Dona Paula, était un poète envoyé par le
destin, à la dernière heure où un cœur anxieux l'appelait. Des dames
moqueuses parlèrent à ce particulier de la manie de la fidalga, et il
se chargea de lui construire une niche au temple de la mémoire. Il lui
dédia ses premières rimes, dont la forme était moins mauvaise que le
fond. Il avait consacré les mêmes rimes à bien d'autres dames, qui
avaient judicieusement renoncé à être immortalisées par José Cabral. Le
poète, qui l'avait d'abord fait par jeu, et pour complaire aux
malicieuses dames du couvent, se trouva pris dans les trames d'un amour
grave et réfléchi. Paula avait dix-huit contos, venait d'une illustre
famille, et présentait des grâces qui n'étaient pas méprisables. Le
ménestrel songea à en faire sa femme, mais cette noble dame ne voulait
pas de mari, elle voulait un chantre qui l'immortaliserait, un encens
dont la vapeur envelopperait son honneur pour l'éternité.
José Cabral écrivit une ode au jour anniversaire de Paula.
Celle-ci lui offrit, ce jour-là, une bague en or, sur laquelle
scintillait un beau brillant qui y était enchâssé ; et elle
l'accompagna d'une réponse en prose poétique à la poésie prosaïque
d'une strophe de cette ode :
Ô Paula ! amour
infini, amour qui relie
Mon âme à toi et au ciel,
Aspirons l'arôme qui s'exhale
Des autels de notre Hyménée.
Voici comment cette dame s'exprimait en prose :
"Un auteur éclairé dit que le mariage constitue la
sépulture de l'amour. Ne nous rabaissons en renonçant à l'idéal qui
représente la vie. Que nos âmes s'aiment avec cet amour sublime qui
résiste à l'ennui et au temps. Que nos noces soient comme l'union des
deux brises, et comme l'éclat fulgurant de deux étoiles qui se
rencontrent dans l'azur du firmament."
À partir de ce jour, sans renoncer à ses noces éthérées
avec cette dame pleine d'esprit, José Cabral renoua le fil rompu
d'autres honnêtes amours, avec Dona Ester Barjona, une juive, fille
d'un certain Salomon, le digne représentant de bien des juifs riches de
la rue des Algibebes.
Ester avait mis à profit l'interruption de cette amourette
pour s'éprendre d'un aspirant-sergent, élève de Polytechnique, fils
d'un officier-général ; les avances de José Cabral, son premier amour,
ne furent cependant pas mal reçues. Ce qu'elle fit, c'est s'amuser avec
ses deux galants, puisqu'elle n'accordait sa confiance à aucun des
deux. Le poète de Paula aimait à donner l'impression qu'il était bien
pourvu, alors que ses avoirs se situaient au-dessous du médiocre. Il ne
manquait pas de générosité ; mais son absence de fortune le bridait,
retenant ses élans, quand il voulait se montrer généreux et libéral.
Ester fêta son anniversaire, et José Cabral voulait lui faire un cadeau
à la hauteur de cet événement ; il lui offrit la bague de diamants
qu'il avait reçue de Paula
Quelques jours après, l'aspirant-sergent rencontra la
belle israélite chez des gens qui faisaient partie de leurs relations à
tous les deux ; il vit la bague, se douta de sa provenance,
s'assombrit, et secoua ses mèches avec une vertigineuse ardeur. Pour le
convaincre qu'il n'y avait rien de condamnable dans sa possession, la
juive l'enleva de son doigt, et lui dit :
– Prends-la ; cela me justifie.
L'étudiant daigna accepter cette justification et
l'anneau, qui avait servi de gage symbolique à cette nouvelle alliance.
Paula demanda au poète :
– Qu'est devenue la bague que je t'ai donnée ?
– Je la porte rarement, dit le poète, parce que je prends
des bains à la péniche, et qu'elle m'a glissé du doigt. Depuis que ça
m'est arrivé, je ne la porte jamais quand je vais me baigner.
José Cabral demanda à Ester Barjona pourquoi elle ne
portait pas la bague.
– C'est parce que je devrai dire à mère d'où me vient ce
précieux objet.
Un peu plus tard, Ester rencontra l'aspirant-sergent,
regarda ses mains, et dit :
– Qu'as-tu fait de la bague ?
– J'en ai fait faire une autre identique, pour te la
donner, à toi, et graver nos initiales au revers de l'anneau.
Dona Paula vit un jour au doigt d'une dame une bague en
or, délicatement travaillé pour obtenir trois spirales, représentant un
serpent.
Les yeux des serpents, c'étaient deux rubis, et les
écailles brillaient comme autant de petits diamants. Elle aima beaucoup
ce serpent, comme symbole de l'amitié, elle écrivit au bijoutier
Nascimento pour lui demander de lui livrer des anneaux modernes. Le
bijoutier lui expédia des anneaux de diverses factures, avec
différentes pierres. Paula lâcha une exclamation et pâlit en les
examinant. Elle avait reconnu la bague qu'elle avait donnée au poète.
Elle se contint, comme la dame et la fidalga qu'elle
était. Elle acheta la bague qui lui avait appartenu et congédia le
bijoutier. Puis elle écrivit au barde cette lettre :
"Quand un projet les préoccupe, les femmes ne peuvent le
reporter au lendemain. J'éprouve un désir irrésistible de posséder une
bague semblable à celle que je t'ai donnée, parce que j'ai un diamant
du même nombre de carats. Envoie-la par la porteuse de cette lettre, si
tu ne peux venir aujourd'hui, mon poète bien-aimé.
Paula"
Réponse :
" Je me présenterai chez toi demain, mon amour céleste ;
je ne confie cette bague à personne ; le contact de mains étrangères
serait une profanation. Je ne viens pas aujourd'hui, parce que je
prends de la digitaline pour calmer les palpitations de mon cœur. Cet
amour va me tuer !"
Dona Paula Manuel Chichorro éclata de rire, et murmura
avec le plus fin des sourires :
– Ah ! Ces poètes !…
Lettre de José Cabral à Dona Ester Barjona :
"Mon étoile ! N'as-tu jamais remarqué qu'il manque nos
initiales à la bague que je t'ai donnée ?! J'aurais voulu que tu me les
réclamasses, bien assemblées, bien enlacées, intimement, les unes aux
autres, comme des emblèmes de nos âmes !… Ton amour ne s'attarde pas à
ces spirituelles bagatelles, qui sont le témoin des passions
grandioses… Envoie-moi la bague, pour que je puisse te la rendre à
l'occasion du sacrement qui garantira notre union éternelle."
Réponse :
"Maman se trouve dans ma chambre : je ne puis aller là où
je garde ton cher cadeau. Je te l'envoie demain, avec les plus fervents
regrets de
ton
Ester."
Lettre d'Ester à l'aspirant-sergent :
"Mon Raul. Ma mère me réclame la bague que je t'ai donnée,
et qu'elle m'avait donnée. Envoie-la-moi, que je puisse la lui montrer,
je te la rendrai lundi chez les Mouzinhos. Ton aveugle adoratrice —
E."
Réponse :
" Je vais la chercher chez le bijoutier, et je te l'envoie
par le porteur d'eau. Au revoir, ma lumière, mon talisman !"
Voilà trois personnes dans tous leurs états.
José Cabral attend ; Ester attend ; Raul n'attend
personne. Il pense à aller racheter la bague qu'il à vendue à
Nascimento pour cent cinquante mille réis. Il réunit ses capitaux et
parvient à la somme de trois pintos et deux vinténs[28]. Il est
submergé de honte, parce que sa famille fréquente toutes les maisons
que connaît Ester. Il se tourne vers son père, lui raconte ce qui s'est
passé, maudit les amis qui l'ont emmené dans une maison de jeu, où il a
perdu son honneur et l'anneau. Le général est un vieillard austère. Il
condamne son fils à expier cette vilenie en essuyant l'opprobre de ne
pouvoir y remédier. Il l'oblige à se rendre à Estremoz pour s'enrôler
dans un régiment, et va lui-même racheter la bague chez le bijoutier.
Le bijoutier demande à Dona Paula de bien vouloir lui céder le
brillant. Cette dame croit préserver ainsi la dignité du poète, dont
elle présume que c'est lui qui l'a vendue, et lui remet la bague. Le
général va voir la famille de la juive, et par un habile tout de
passe-passe, il laisse tomber, à l'insu de la mère, la bague sur les
genoux de la jeune fille. Ester la remet aussitôt à José Cabral, qui se
précipite au couvent.
On lui dit que Dona Paula s'entretient à une grille avec
des visiteurs. C'est le bijoutier qui est allé la remercier pour lui
avoir cédé la bague, et lui raconte ce qui s'est passé entre lui et le
général Sarmento, qui est allé la rendre à la jeune fille que
courtisait son fils, elle l'avait prise à sa mère pour le lui offrir.
Dona Paula n'entend rien à cet imbroglio. Les régions où planait son
esprit étaient pures de telles manigances. Elle croit que le bijoutier
invente une histoire sans queue ni tête. Elle insiste pour en connaître
le détail, et comprend tout. On la prévient alors que le poète attend
ses ordres dans la cour du monastère. Le bijoutier prend congé, José
Cabral est reçu à la grille.
Dona Paula reconnaît sa bague, et lui demande, avec un
sourire plein d'affection :
– Sera-t-il nécessaire de la purifier, en l'aspergeant
d'eau bénite ?
– Pourquoi ?! s'enquiert le poète.
– Parce qu'elle a été passée au doigt d'une juive !
N'est-ce pas votre avis, mon délicat poète ?
José Cabral pâlit, porte la main à son flanc gauche, et
dit :
– Ciel ! Quelle calomnie !…
Dona Paula lui demande s'il a de la digitaline sur lui.
Le malheureux se rend compte de son ridicule, et s'écrie :
– Vous moqueriez-vous, Madame, de mes palpitations ?
Cette femme pleine d'un aristocratique esprit
s'immortalise à mon avis en donnant une ingénieuse pichenette à la
bague, qui franchit l'espace entre les grilles, et roule aux pieds de
son tout jaune poète.
Et elle lui dit avec une adorable dignité :
– Les châtelaines des beaux temps de la chevalerie
rémunéraient, avec leurs sourires ou leur argent, les rimes des
troubadours provençaux qui les chantaient. Moi qui appartiens au passé
par l'esprit, je paie avec cet objet de valeur vos complaintes, mon
cher ménestrel ; et si vous voulez un sourire de châtelaines moins
hautaines, au lieu d'un sourire, je vous offre un éclat de rire.
Elle le régala du plus mordant, du plus insultant des
éclats de rire, et quitta la grille ; mais, en fermant la porte
derrière elle, elle sentit le choc de la bague sur sa nuque. Quand elle
tourna son visage enflammé vers le poète, elle eut le temps de le voir
lui décocher, comme une sagaie empoisonnée, cette insulte :
– Vous êtes grotesque et vieille ! Je vous empalerai dans
mes vers, pour vous offrir aux fous-rires de la postérité !
Quand je suis revenu, dix ans après, à Lisbonne, José
Cabral était chef de service, il avait une carte d'entrée au conseil.
Je lui ai parlé de la bague de Paula. Il m'a raconté qu'après avoir été
grossièrement rabrouée, elle était rentrée en elle-même, et avait
renoncé à l'immortalité que donnent les vers, en se faisant aimer d'un
chanoine qui, en était resté, en matière de poésie, aux poésies
érotiques de Manuel Maria Barbosa de Bocage.
Dona Ester Barjona était mariée à un de ses cousins, un
rabbin de la synagogue d'Amsterdam. Quant à lui, mon narrateur, il
était marié à la fille fort sage d'un marchand de morue, dont
l'influence l'avait hissé au poste de chef de service, il espérait être
ministre.
Remarque, pour finir, ai-je dit, en guise de conclusion,
que cette bague de Dona Paula a été la cause dérisoire qui a poussé
quatre personnes à s'engager sur le chemin d'une vie sérieuse. Le poète
s'est senti ridicule, il a mis le cap, avec son esprit, sur le port aux
eaux calmes d'un mariage réparateur.
Ester a épousé le juif que ses parents lui destinaient, et
offert au monde une douzaine de plus de petits juifs.
Raul est aujourd'hui major de cavalerie, et n'a plus
jamais joué après avoir vendu la bague pour payer ses dettes.
Dona Paula a droit aux graillonnantes galanteries du
chanoine, ainsi qu'autant de décombres, qu'elle a calés contre la porte
du temple de la mémoire, pour ne plus éprouver la tentation d'y entrer.
Et s'il n'y avait pas eu la bague ? Imagine les sottes
complications, les désordres qui auraient pu submerger ces quatre
existences, détournées de leur riche destin !
XXI
LES PUNAISES DE BALTAR
António Joaquim m'a accordé la faveur de trouver mon
histoire amusante,
et m'a demandé combien il me devait, vu que mon métier consistait à
vendre des histoires. Des sentiments puissants de gratitude ont uni
leurs efforts pour me faire dire, avec le détachement du philosophe qui
a repoussé les trésors de Xerxès, que ce n'était rien. Malgré mon
refus, António Joaquim m'a donné une cigarette, et m'a demandé si les
éditeurs au Portugal étaient plus libéraux que lui. J'ai pu le
convaincre que les éditeurs portugais étaient des hosties spontanément
immolées sur les autels de nos lettres nationales, et qu'en ce qui me
concerne, j'en avais ruiné d'aucuns, et mes collègues tous les autres,
de telle sorte qu'au bout de quelques années, si les poètes et les
romanciers ne pouvaient vivre repus et engraissés par leurs fantaisies,
ils devraient, à l'instar d'Homère, aller déclamer sur les places
publiques leurs poèmes et leurs romans aux foules qui, pour les
rétribuer, orneraient leurs fronts de branches d'acacia et de seringa.
Comme cette interminable période m'avait coupé la
respiration, et que la litière s'était arrêtée à l'auberge de Baltar,
nous mîmes pied à terre.
Quand la vapeur amènera la civilisation à Baltar, des gens
de Lisbonne viendront, tout pâles, donner de la couleur à leurs joues
avec les veaux bien gras que l'on y mange. Si les Ganymède qui servent
à des tables sales, ne venaient pas de la cuisine comme d'une réserve
de guano, l'on croirait savourer les restes de quelque banquet de
l'Olympe. L'on dirait que les veaux de Baltar ont été engendrés par des
divinités païennes si, quand il s'est transformé en bœuf pour emporter
Europe, Jupiter avait fait d'elle une vache, et s'ils s'étaient
multipliés sous la forme de veaux, ce qu'il était juste que fissent des
dieux assez niais pour être de quelque utilité à des gens qui leur
donnent un exemple moral en ne se faisant pas bêtes pour enlever qui
que ce soit. Si Jupiter venait ici de nos jours transformé de la
sorte, je parie qu'il trouverait des rivaux au marché d'Aveiro,
où les taureaux sont d'une telle placidité, et d'une telle douceur, que
tous ont l'air de dieux amoureux d'aimables marchandes qui ont gardé
une trace de beauté phénicienne. Cela me paraît la référence érudite
qui rend le mieux justice au veau de Baltar.
Nous étions en train de dîner quand António Joaquim me dit
que, dix ans avant, dans la chambre en face de la mienne, il avait
passé une nuit épouvantable.
– On en a sorti deux cadavres, ajouta-t-il.
En l'entendant, je me suis mis à voir des cadavres pendus
à un mur comme de monstrueux maquereaux éventrés ; le veau donnait à ma
chair humaine un méchant fumet ; les chopes me semblaient des
crânes, et le vin exhalait une vilaine odeur de sang, il présentait
l'écume des liquides intestinaux.
– Deux cadavres !… Cette maison fournit des titres aux
romans de Frédéric Soulié… murmurai-je, tournant mes yeux craintifs
vers le serveur de la maison, qui me fit penser à un bandit habitué à
réduire les hôtes à l'état de rôti de veau. À la fin du dîner,
sous une lueur de caverne, qui vacillait, qui devait trembloter
… à la cruelle table de Thyeste
Quand il mangeait
ses enfants qu'Atrée lui apprêtait.
António Joaquim prit une expression horrifiée, écarquilla les
yeux pétrifiés d'épouvante, et dit sur le ton lugubre qu'adoptent les
scélérats pour effrayer les spectateurs au théâtre avec leurs affreuses
histoires, ces mots :
– C'était par une nuit d'août.
Le cavalier descendit de son cheval frison à la porte de
l'auberge, et tendit la main pour soutenir le pied d'une dame aérienne,
qui sauta d'une haquenée dans les bras de son élégant compagnon.
Tandis qu'ils passaient le seuil de la porte, la dame,
appuyant sa joue sur l'épaule du cavalier, murmura :
– Quelle belle nuit, l'air est si pur, la lune a des
reflets si argentés, et nous allons échanger tout cela contre l'air
fétide et l'obscurité de cette lugubre taverne !
– Il faut vraiment que tu te reposes, Maria, dit
tendrement le caressant époux de cette si poétique voyageuse. Nous nous
reposerons deux heures ; et, dès les premières lueurs de l'aube, nous
reprendrons nos chevaux, tandis que les petits oiseaux nous salueront,
qui interpréteront avec leurs trilles la magnifique partition de la
nature, composée par le sublime maestro qui a conçu les harmonies des
bois et les harmonies des sphères…
Je l'interrompis, tout étourdi par le roulement et les
carillons de ce verbiage :
– Quel style ! Quel style, par le nom sacré de Jésus ! Les
horreurs locales t'ont fait perdre la simplicité portugaise et sentant
bon le Minho de ton langage ! Ces gens-là parlaient-ils vraiment comme
ça ?!…
– Encore plus sottement, puisque c'étaient deux époux qui
s'adoraient. Tu fais semblant d'ignorer que deux personnes qui s'aiment
ne commencent à dire des choses sensées que lorsqu'ils ne peuvent plus
se sentir. Le langage de l'amour vient et s'en va avec lui ; il doit
exister un séraphin, qui conçoit le vocabulaire des amants, et referme
son livre lorsque son compagnon — l'ange du cœur — éteint la lampe en
or à la lumière de laquelle les heureux amants débitaient leurs
phrases. Si celles-ci, pourtant, sont restées gravées dans la mémoire
des hommes, elles prêtent à rire. Ah ! Le cavalier et la dame qui
mirent pied à terre dans le potager de cette auberge parlaient ainsi
parce qu'ils s'aimaient comme les terres embrasées du mois d'août
aiment le nuage, qui sort, pour eux, de ses entrailles une
rafraîchissante averse.
– On dirait que ce sont eux qui parlent, mon cher António
Joaquim ! Si tu me faisais la grâce de me dire comment ces éloquentes
personnes se sont transformées en cadavres…
– J'y viens !… Veux-tu que je commence par la fin, mon
vieux ? Ils sont montés jusqu'au plancher sur lequel nous nous nous
trouvons, et dès qu'ils furent entrés, ils ont demandé…
– Du rôti de veau.
– C'est clair.
– Et quand ils ont commencé à dîner, une hulotte lâcha son
cri dans ces pinèdes là-bas. Maria laissa tomber sa fourchette et cria :
– C'est un présage !
Le cavalier posa sa main sur son visage pâle, et lui dit :
– Mange, chérie, mange de ce veau, et laisse beugler les
chouettes.
Là-dessus, la pendule au mur sonna onze heures, lentement,
lourdement, en nasillant comme gémit la clochette qui, dans les
cimetières, appelle les squelettes à essuyer leurs suaires quand la
brise se lève au cœur de la nuit.
– Tu me glaces le sang, tu me fais peur, António,
m'exclamai-je. Tu veux que ce veau me reste sur l'estomac ! Les
descriptions cadavéreuses de cette histoire me lèvent le cœur !
Atténues-en les couleurs sombres, si c'est possible !
– Le cavalier sentit un frisson courir sur son échine, et
dit au domestique qui les servait à ce dîner : "Donnez-moi une chambre
propre, avec un lit convenable."
– Celle-là, répondit le domestique, en indiquant la
chambre que tu as juste en face de toi.
Les deux époux se retirèrent dans cette sinistre alcôve.
La hulotte hulula encore sur le surgeon desséché d'un chêne-liège. Le
ciel se voila tout à coup, il se couvrit de nuages poussés en
tourbillons par le vent du nord. L'éclat de la lune fut englouti dans
le ventre noir de la bourrasque. Les vents d'est sifflaient sur les
poutres de ce toit. Dehors, les branchages balayés par une pluie
torrentielle grinçaient et gémissaient, produisant un son rauque et
formidable, comme des milliers d'hommes brisés au niveau de l'épine
dorsale.
– Quelle image ! fis-je observer. Moi aussi, je me sens
brisé au niveau de l'épine dorsale par les serres de ta rhétorique. Tu
as des visions hugoliennes ! Cela me fait penser à la tour d'une église
qui avait l'air d'une vrille en train de percer le ciel. Il y a
beaucoup de gens qui écrivent comme tu parles. J'ai tendance à croire
que ce style, c'est le veau de Baltar qui le donne. Il y a beaucoup de
monde, apparemment, qui vient manger ainsi ! Moi-même, qui écris sans
façon, je sens naître en moi le besoin impérieux de parler comme toi.
Raconte-moi à présent, mon cher ami, mon âme sœur, quelles noirceurs
intimes ont filtré à l'intérieur de l'alcôve où les deux voyageurs ont
exhalé leur dernier souffle.
– Il était deux heures du matin, continua António Joaquim.
Qui eût collé, à cette heure, l'oreille aux fentes de cette porte,
aurait entendu le gémissement à l'unisson de deux voix, des vies
arrachées qui se débattent dans une stertoreuse angoisse. Alors… nous
allons nous coucher, dit abruptement mon ami.
– Nous coucher ?! Et ton histoire ?
– Demain.
– C'est impossible ! je n'irai pas me coucher sans savoir
de quoi ils sont morts.
– Demain. Tu m'as interrompu avec tes railleries ; je vais
te punir en te tenant en haleine.
– C'est atroce, António Joaquim, et ça n'a rien de drôle.
Dis-moi au moins si c'est la viande de veau qui les a tués ! Sont-ils
morts empoisonnés ? Se sont-ils mutuellement poignardés par jalousie ?
L'a-t-il tuée avant de se donner la mort ?
– Je ne te répondrai pas avant demain. Ne te fatigue pas…
Choisis une des deux alcôves, nous allons nous coucher. Veux-tu la
chambre aux deux cadavres ?
– Oui, beuglai-je avec une exemplaire intrépidité,
je veux me pénétrer des cadavériques miasmes de cet antre ! À demain.
Je suis entré avec une chandelle dans l'alcôve, et je m'y
suis jeté, fatigué jusqu'aux tréfonds de mon âme et de mon esprit, en
éteignant la lumière.
Vingt minutes après, je me suis, d'un bond, assis sur mon
lit en secouant de mes épaules les griffons cloués par une légion de
démons.
– Il y a des horreurs inconnues dans cette chambre,
criai-je en allumant la lumière.
Je regardai au-dessus et autour de moi : c'étaient d'épais
escadrons de punaises qui surgissaient en caravanes des cavernes de ma
couche, et des trous des cloisons. Je sautai sur le plancher, les
cheveux dressés, et les nerfs saisis de convulsions cataleptiques. Je
pris mes bottes à la Fredéric, et mis à mort des milliers de ces
animaux, qui renaissaient les uns au-dessus des autres comme autant
d'hydres de Lerne. Il a été perpétré un fétide massacre dans
l'alcôve. J'ouvris les fenêtres et bus l'air balsamique des pinèdes. Je
retournai au charnier, secouai les draps aux brises du petit matin, et
revins étendre mon corps exténué sur la couche sanglante, en gardant la
chandelle allumée.
Quelques instants après, les hordes, ressautant de leurs
terriers, se regroupaient en bancs sur les murs, et se concertaient
dans un calme craintif, puis elles formaient des rangs, et montaient au
plafond. Et moi, assis sur mon chevalet, j'examinai, à la lunette, ces
immondes mouvements, et je les voyais se laisser tomber sur moi du
plafond, à pic, de féroces centuries affamées et assoiffées de
vengeance. Et moi je retournai derechef au combat, avec mes bottes, et
elles m'échappaient à une vitesse insultante. Pour la première fois de
ma vie, j'ai vu des punaises avec des ailes, qui voletaient dans cette
atmosphère empestée de leur sang. Je rapportai ce fait à différents
naturalistes, et personne n'a cru aux punaises ailées de Baltar. J'ai
ouvert, hier, le livre d'un zoologue, le Dr. Charbonnier, et j'ai eu
l'occasion de vérifier que cet hémiptère possède des ailes
rudimentaires, et que ce savant ne doute pas que la punaise en ait de
complètes. Que Dieu amène ce naturaliste à Baltar pour l'honneur et la
gloire de la science !
Je sentis alors un fébrile incendie, des étourdissements,
des vertiges mortels à chaque nouvelle piqûre. Les forces me manquaient
déjà pour menacer de mes bottes le mur. Je m'assis sur le plancher et
pleurai comme fit Marius aux marais de Minturnes. J'ai ici un ouvrage
scientifique qui m'explique ces angoisses. C'est le docteur Charbonnier
qui atteste la sincérité de ce récit : "Il y a des individus très
sensibles à qui la morsure des punaises produit une si vive excitation
qu'elle favorise chez eux des accès de fièvre."
J'ai pensé que je pouvais mourir d'un si ignoble désastre.
La chandelle s'était éteinte, faute d'huile. Les animaux, protégés par
les ténèbres, m'attaquaient dans mon refuge. Je me levai brusquement,
et je ne sais quels rugissements plaintifs j'ai lancés, sous l'effet du
délire et du désespoir, à la face de la Providence, qui avait créé la
punaise. Je voulus ouvrir la porte, mais j'avais perdu la tête.
Je raclais les murs de mes ongles, et j'éventrais d'infâmes multitudes.
Je fuyais encore en claquant des dents ; je brisais ma rage en
gémissant.
Là-dessus, j'ai entendu des pas, dans la petite salle, qui
se rapprochaient de ma porte.
– Qu'est-ce qui t'arrive ? dit une voix.
C'était António Joaquim.
– C'est toi ? criai-je. Sauve-moi, en me donnant de la
lumière, je me sens mourir.
Et je gémis.
– Ce sont de tels gémissements qu'ont poussés les deux
malheureux dont je t'ai raconté l'histoire, dit-il, sur un ton
solennel. Comprends-tu à présent comment ils sont morts là ? De cette
mort qui t'attend, malheureux ! Connais-tu la fin de cette histoire ?
L'élégant cavalier et la gracieuse dame ont fini là, étripés, le corps
et presque l'âme dévorés pour les punaises.
– Ouvre-moi la porte, par pitié, bramais-je encore, il me
reste juste assez de vie pour me rendre compte que je suis mort.
António Joaquim entra avec sa chandelle et dit :
– Je viens te sauver, parce que tu es nécessaire à la
bonne ordonnance ainsi qu'à la perfection du cosmos. Quand nous avons
passé la nuit ici, ma femme et moi, il y a dix ans, nous avons été les
victimes et les personnages de cette histoire, qui se trouve confirmée
par ton sang.
– Ah ! C'était toi, l'élégant cavalier ? dis-je entre la
joie et les larmes. Le narrateur fait preuve d'une belle modestie !…
Mais tu m'as dit que, de cette chambre, étaient sortis deux cadavres…
– C'est le cas, répliqua António Joaquim.
– Comment ça ? Je ne comprends pas !…
– Ce qui est sorti de là, ce sont deux âmes réduites à
leur plus simple expression. Le sang, qui est la vie, était resté là,
dans les gosiers de cette meute de fauves. Qu'étions-nous sans notre
sang ? Deux cadavres avec juste assez d'esprit pour ne plus jamais nous
coucher dans les lits de cette taverne de Baltar.
XXII
LES AMOURS DE TERESA
Un jour où j'allumais une allumette fabriquée en Galice,
j'ai remarqué
les personnages figurant sur la boîte. C'était un paysan, imbibant un
mouchoir des larmes qui coulaient à son œil droit, le bras gauche
affectueusement tendu vers un bœuf, il disait en espagnol : Au lieu
d'enfants, j'ai un bœuf, qui me donne de grandes satisfactions[29].
J'ignore à quoi font malicieusement référence nos voisins dans ce
distique. Ce que l'on distingue, moins mal dessiné, c'est un individu,
ému aux larmes, caressant un bœuf, qui, faute d'enfants, lui procure
beaucoup de satisfactions. Ce détail qui n'est pas sérieux, ni ne
pouvait l'être sur une boîte d'allumettes galicienne m'a rappelé une
histoire qu'António Joaquim m'a racontée, après notre déjeuner à
Valongo.
La litière est passée à travers un gros troupeau de bœufs
qui se rendait à Porto, pour gagner l'Angleterre. Ces ruminants
corpulents et gras, avançaient tristement, en jetant sur la bruyante
locomotive leurs yeux magnifiques et languides. Si les deux personnes,
qui voyageaient en litière, avaient été des gens qui pensent, qui
calculent, qui s'y entendent en économie politique et autres sciences
touchant la prospérité des nations, ils se mettraient à discourir sur
l'intérêt d'envoyer aux Anglais de gros bœufs, et d'en manger de
maigres, hors de prix. Nous nous souviendrions et nous en étonnerions
de la stupidité de nos pères qui mangeaient de gros bœufs et s'y
retrouvaient, qui étaient eux-mêmes gras, et avaient beaucoup d'argent,
sans envoyer des bœufs en Angleterre. Après avoir dénoncé l'ignorance
de nos pères, nous passerions à l'éloge de nos savants d'aujourd'hui,
et des bouchers qui font plus de profit que les agriculteurs et les
savants ; et après avoir disserté en long et en large sur les bœufs
gras, nous nous endormirions tous les deux à la hauteur du rio Tinto,
et rêverions des vaches maigres du pharaon, un rêve d'affamé qui, selon
moi, n'a pas été correctement interprété par Joseph. Le roi d'Égypte
rêvait des boucheries portugaises au XIXe siècle.
– Quel magnifique troupeau ! dis-je. Le bœuf est le
quadrupède qui ressemble le plus à un philosophe. Regarde ce pas
mesuré, grave, et posé d'un bœuf ! Son regard méditatif ! Son calme
apparent ! Son air qui révèle un travail intellectuel complexe
s'élaborant dans cette énorme tête ! Il y a de grands philosophes
indiscutablement moins sérieux et méditatifs que le bœuf ! Tu connais
sûrement, mon cher António Joaquim l'importance sociale, légendaire,
symbolique et mythique du bœuf dans l'antiquité.
– Je ne la connais pas vraiment, dit modestement mon ami ;
ce que je sais sur cet obligeant animal, c'est que l'humanité le mange
depuis des siècles, et que, dans les dîners de Crassus et de Lucullus,
il y avait des bœufs rôtis entiers, et je crois que, dans le couvent de
Mafra, l'on rôtissait également les bœufs entiers.
– Pour commencer un peu après le déluge, repris-je, tu
sauras que les bœufs, chez les Égyptiens, les Phéniciens, les
Indoustans…
António Joaquim m'interrompit :
– C'étaient des bœufs. La considération que j'ai pour toi,
à juste titre, depuis des années, et la franchise dont tu fais preuve à
mon égard m'engagent à te demander de ne rien me dire sur l'importance
du bœuf en Phénicie, en Égypte, en Indoustan. Les litières sont des
moyens de locomotion appropriés et taillés pour ces discours et
d'autres de la même farine, mais, comme, en l'occurrence, nous pouvons
alléger nos heures sans nous encombrer l'esprit d'une érudition pour le
moins bovine, je te demanderai d'écouter une petite histoire de bœufs
où entrent une de ces passions qui font couler une vie par le fond, et
une jolie fille que la nature a créée en la touchant de sa baguette la
plus extraordinaire en matière de magie.
– Est-ce une histoire instructive et sérieuse comme celle
des punaises de Baltar ? demandai-je.
– Non, elle est triste et méritait d'être bien racontée.
La blonde Teresinha da Ginjeira[30] était une jeune fille
qui habitait près de chez moi, la fille d'un bon cultivateur. Ses vingt
ans étaient joyeux comme les aubades des oiseaux. Ses joues prenaient
une teinte rouge comme les griottes qui pendaient au-dessus de sa
fenêtre en festons le long de cet arbre imposant qui donnait son nom à
la maison du laboureur.
À douze ans, Teresa hérita de deux bouvillons que lui
laissait sa marraine. Son père lui permit de les élever comme s'ils lui
appartenaient, bien que sa mère voulût les vendre aussitôt, et employer
le produit pour acheter de l'or, qu'elle comptait mettre aux oreilles
de sa fille. Teresa parvint à obtenir que son père se montrât
bienveillant envers ses bouvillons, et fut ravie de leur prodiguer tous
ses soins. Quand, après avoir bien brouté, ils se couchaient, repus,
dans les prés pour ruminer, Teresa s'asseyait entre eux, les caressait,
les cajolait, et s'endormait, la tête appuyée aux flancs mous des bêtes
immobiles, qui jetaient sur elle de tendres regards. Quand ils
mugissaient, Teresa croyait que ses bouvillons appelaient leur mère ;
et, prise de pitié, redoublait d'attentions, et elle partait cueillir
une grande quantité d'herbe, qu'ils choisissaient et savouraient plus
tranquillement dans leurs pâturages. Quand, comme de jeunes taureaux,
ils mugissaient plus fort, Teresa pensait encore qu'ils regrettaient
leur mère, et les câlinait, en leur disant des tendresses, avec un tel
sentiment, que les bouvillons[31]
semblaient absorbés par ce qu'elle
disait. Ce n'étaient plus des regrets qu'exprimait le mugissement des
ces splendides taureaux qui ne tenaient pas en place ; c'était le
puissant beuglement que donnaient toutes les voix de tous les êtres qui
vivent sous le ciel. Buffon, l'interprète du taureau, dit que son
mugissement, c'est de l'amour : Le
taureau ne mugit que d'amour[32]. Il
ne dit pas la même chose de la vache : c'est la peur et l'effroi qui
lui arrache des beuglements prolongés...
Je l'interrompis :
– Si tu ne veux pas un discours sur le rôle qu'ont joué
les bœufs en Phénicie, en Égypte et en Inde, dispense-moi de chercher à
savoir pour quelle raison les vaches beuglent. Ces connaissances
linguistiques peuvent intéresser les vachers, et les professeurs de
philologie.
– Tu as raison : si tu ne me coupais pas, j'allais
t'apprendre un vocabulaire plus compréhensible que les racines des
langues afghanes, pehlvis, et indoustanes. Reste plongé dans ton
ignorance, et passons aux taurillons de Teresa.
La jeune fille versa des larmes amères quand on soumit, à
leur troisième année, les bouvillons au joug. Elle demanda qu'on lui
permît de les guider dans leur apprentissage. Les taureaux obéissaient
à sa voix, et pas à l'aiguillon de cultivateur qui mettait leurs flancs
en sang. Teresa pouvait laver ce sang de ses sanglots.
La première fois qu'on les attela au timon d'un chariot
chargé de bois sur une pente raide, les bœufs gémissaient en fixant
leur amie de leurs yeux ternes et mourants, comme si les larmes les
éteignaient. Le lendemain, la jeune fille n'avala pas un morceau, et
passa les heures de sa sieste dans la cour des bouvillons, à les
rafraîchir avec une pousse de maïs, cueillie aux heures fraîches du
matin. Le cultivateur se fit vinaigre et fiel, outré qu'il était de la
sottise de la jeune fille, et en vint à la menacer de vendre les
taureaux à la prochaine foire, pour en finir avec ces "inventionneries"
— c'est le nom qu'il donnait à la compassion de sa fille. Teresa promit
de ne plus se plaindre en échange de la promesse qu'on ne vendrait pas
ses bouvillons.
Ce qu'elle faisait, c'était cacher de bons morceaux, pour
les gâter durant leurs pauses. Elle leur donnait de la farine dans de
l'eau, des patates bouillies, de grandes quantités d'épis, tout ce qui
lui tombait sous la main et qu'elle pouvait transporter à un coin de
leur enclos.
À six ans, l'attelage de bœufs de mon voisin était le plus
coquet, et le plus galant des dix paroisses environnantes. Il ne leur
manquait pas un seul de ces signes qui révèlent la perfection d'un bœuf
: une tête courte, des cornes à pointes noires, un front vaste, de
grandes oreilles veloutées se rejoignant à leur racine, des yeux larges
et sombres, un gros museau, des narines bien ouvertes, des lèvres
couleur de jais, un cou charnu, des épaules amples, des bajoues tombant
jusqu'aux genoux, des reins épanouis, des flancs où ressortait la pulpe
des muscles, des membres solides, l'échine droite, la queue pendante et
bien velue, le cuir épais et souple, le poil soyeux, moelleux, avec des
boucles sur la tête.
– C'est la description la plus complète que j'aie entendu
d'un bœuf ! fis-je observer. Il semble incroyable qu'avec tes
connaissances et ton enthousiasme pour l'aspect artistique et
sculptural du bœuf, tu ne m'aies pas permis de te préciser l'importance
du bœuf en Égypte…
– ...En Phénicie, et en Indoustan, ajouta-t-il en
affichant une vaniteuse ignorance. Eh bien, je ne sais que te dire de
plus sur l'admirable attelage de bœufs qui continuaient à absorber les
attentions de Teresa. Quand la foire tombait un jour sanctifié, le
cultivateur leur mettait de riches têtières et des flocons écarlates,
et il allait, avec cet attelage, enfoncer les meilleurs concurrents. Si
on cherchait à savoir leur prix, il en demandait deux cent mille réis,
pour dire quelque chose ; et Teresa changeait de couleur, craignant que
l'acheteur, offrît juste quelques sous de moins, et que son père cédât
à la tentation. Les jours de foire représentaient pour la pauvre fille,
des jours d'indescriptibles flagellations.
Les bœufs avaient atteint leur plus grande corpulence. Ils
allaient sur leurs neuf ans, et devaient peser, chacun, trente bons
arrobes.[33]
On proposa au père de Teresa d'acheter un brousse
attenante à ses terres. La brousse était mise à prix pour quarante
pièces[34]. Le
cultivateur ne les avait pas. Les bœufs avaient beaucoup
grossi, ils ne travaillaient plus guère, de plus en plus lourds et
inertes, au fil des jours. Il songea à les vendre ; il réfléchit
quelques minutes au chagrin de sa fille ; sa femme lui dit de ne pas
être idiot, et de conclure l'affaire. Le cruel vendit en effet les
bœufs à l'insu de la jeune fille, reçut les arrhes, étant bien entendu
qu'il toucherait le reste à Porto, où il devait conduire les bœufs
qu'on devait embarquer.
La nouvelle de la vente se répandit dans la paroisse.
Jamais on n'avait vendu des bœufs à un tel prix. C'était la question du
jour à la veillée, sur le parvis des églises, et pendant les récoltes.
En sortant de la messe, Teresa entendit des mots qui frappèrent son
cœur comme des flèches perçantes. Elles venaient d'un vieux qui lui
disait :
– Quarante pièces d'or ! Regarde, ma fille, ce qu'a
donné l'héritage de ta marraine ! Ton père pourrait bien te donner une
chaînette de deux livres !
– C'est mal le connaître, dit un envieux. Il a vendu les
bœufs pour acheter une brousse, et sa fille, il n'est même pas fichu de
lui donner des socques.
Teresa ne put entendre les dernières syllabes. Elle éclata
en sanglots, on eût dit qu'elle allait succomber de chagrin. Les femmes
qui sortaient de la messe s'attroupèrent autour d'elle, il y avait là
sa mère. Les unes riaient, les autres pleuraient en apprenant la raison
de ces lamentations. Pour disperser tout ce monde, sa mère releva
brutalement sa fille, et lui donna un coup de poing sur le dos, pour
lui faire presser le pas devant elle.
Une fois chez elle, Teresa s'en fut à l'enclos des bœufs
qui avaient été vendus, étouffant ses cris sur leur cou qu'elle
embrassait, dans sa vertigineuse anxiété. On l'emmena de là en la
poussant, on l'obligea à prendre à table un bol de son bouillon. Les
sanglots résistèrent à la violence de la déglutition. La jeune fille,
qui n'en pouvait plus, demanda à genoux qu'on l'a laissât aller au lit,
elle mourait de froid.
Quand on me le raconta, j'ai demandé au cultivateur de
laisser examiner sa fille par mon médecin de famille. Ce goujat éclata
de rire, et dit : "Le remède, ce serait de casser la vente, et de
laisser mourir les bœufs chez moi."
– Préférerez-vous que ce soit votre fille qui meure ? lui
répondis-je. Le cultivateur me souffla son fou-rire imbécile au visage,
et s'écria :"On ne dirait pas, Monsieur, que vous ayez fait des études
! A-t-on jamais vu en ce monde quelqu'un mourir d'amour pour des bœufs
?"
Teresa avait des accès de fièvre tous les jours, les
larmes se séchèrent à ce feu. Le cultivateur consentit à ce qu'un
médecin examinât sa fille, et ne rit plus quand celui-ci lui dit :
– Je crois pouvoir vous assurer que votre fille est
en train de mourir.
– De quoi ?! demanda le père.
– Elle se languit de ses bœufs.
– Il n'y a donc aucun remède ? rétorqua-t-il.
– Si. Laissez-lui ses bœufs : attendez que votre
fille ait un mari, ou ou un béguin qui la distraie des bœufs qu'elle a
élevés, et vendez-les alors."
Le cultivateur n'avait pas d'autre fille. Il consulta sa
femme qui, ébranlée par les craintes de son mari, sentit vibrer en elle
un soupçon d'amour maternel. Ils s'en furent au chevet de la malade, et
lui dirent que le contrat était rompu. Ce fut comme une rosée du ciel
qui se dépose sur une fleur grillée. Ses joues rosirent ; son pouls
s'accéléra dans la douce fièvre de l'allégresse. Elle voulut aussitôt
se lever, soutenue par les mains de ses parents qu'elle baisait
goulûment. Elle manquait de forces ; mais la joie lui en donna,
miraculeusement. Elle descendit à l'enclos, et se répandit en tendres,
en fervents épanchements devant ses bœufs qui la flairaient, lui
enveloppaient de leur haleine vaporeuse le visage et les mains.
J'assistai à la scène, je ne pus retenir mes larmes.
En peu de jours les ravissants attraits de Teresa
retrouvèrent toute leur fraîcheur.
Cela s'est passé il y a quatre ans. Les bœufs en ont
aujourd'hui quatorze[35].
Le cultivateur attend que sa fille sente
naître en elle d'autres inclinations, plus rationnelles, pour vendre
aux Anglais la viande ferme de ces deux bienheureux quadrupèdes. Mais
je me doute qu'ils mourront vieux, en appuyant leur tête rugueuse aux
genoux de Teresa. Quand cela se produira, il se peut que le cœur de ma
jolie voisine se consacre à quelque animal moins domestique, et moins
reconnaissant.
– À mon avis, dis-je, ta voisine n'est pas aussi fabuleuse
que Pasiphaé, elle a des instincts et un cœur de vache ! Pardonne-moi
si ton histoire ne me fait pas pleurer d'attendrissement. Les légendes
anciennes racontent assurément des faits qui répondent à une référence,
plus ou moins mythologique, symbolique…
– Tu vas me parler de l'importance des bœufs en Égypte, en
Phénicie, dans l'Indoustan ? Je demande à tes lecteurs l'autorisation
de t'envoyer paître. Tu n'as pas compris le cœur de la pauvre Teresa !…
Tu n'entends que l'amour du bœuf dont on fait des steaks ou des
boulettes !
XXIII
AMOUR DE NONNE
Nous nous trouvions à São Roque da Lameira[36] dans la gracieuse allée
abandonnée, juste au-dessous des murs qui défendaient les
tranchées de 1832.
António Joaquim montra du doigt une maison sans tuiles,
trouée, criblée de balles, au pied de la colline.
– C'est là qu'est mort mon oncle Carlos Leite, il y a
vingt-huit ans, le trente septembre, quelques heures après l'assaut
contre les lignes de Porto, le jour de la Saint Michel, dit António
Joaquim, qui ajouta :
– Mon oncle était colonel dans l'armée des assiégeants. Je
ne sais si ses sentiments fort humains pour la liberté ont engagé
Carlos Leite à éprouver en son for intérieur de la sympathie pour la
belle cause des assiégés ; il se peut qu'il ait pensé comme l'aurait
fait un philosophe, un socialiste, un chrétien de l'école de Jésus
Christ ; c'est probable ; mais il y a une grande marge des idées aux
actes. La discipline du soldat l'a emporté sur l'aspiration du
philosophe,. Mon oncle servait à l'ombre des drapeaux sur lesquels il
avait juré.
De 1826 à 1830, Carlos Leite résida à Porto, où il
commandait un régiment. Il était lieutenant-colonel à quarante-cinq
ans. Il aimait, depuis ses vingt ans, une dame qu'il avait vue entrer,
à quinze ans, malgré elle, dans un des couvents de Porto, où elle
prononça ses vœux à seize
Ces deux âmes qui s'étaient rencontrées une seule fois,
l'avant-veille de l'entrée de Mariana au couvent, l'affreuse
célébration des épousailles divines ne put les désunir. Mon oncle était
engagé dans un mariage avec une parente belle et riche ; il ne
répondit plus aux lettres de sa fiancée, et ne sentit pas l'offense
qu'il lui faisait en rompant sa parole.
C'était un homme habitué aux plaisirs de la société,
galant et enjoué, qui inspirait l'estime et l'affection ; tout à coup,
il coupa tous ses liens avec le monde des gens heureux — ou qui
affectent de l'être — et se réfugia dans une solitude à peine troublée
par ses obligations militaires.
Certaines personnes le plaignaient, d'autres
compatissaient. La société se rit des amours frivoles, elle se rit
aussi des amours qui prennent l'air sérieux des immenses souffrances.
Un homme qui dispose d'un cœur pour chaque femme, et d'une passion pour
chaque semaine, que dit de lui la société ? "C'est un écervelé !" S'il
se tourmente pour la même femme la moitié de sa vie, que dit la société
? "C'est bien dommage!" N'est-ce pas ainsi que cela se passe, d'après
toi ?
– Si ; et nous avons bien raison, nous autres, qui
représentons la société, répondis-je avec l'emphase philosophique de
l'un des sept sages de la Grèce, l'abdomen bien gonflé par les
gueuletons que nous rapporte Plutarque dans ses Traités de Morale.
(Une remarque en passant : les sages de la Grèce
discutaient, l'estomac plein, sur les profonds mystères de la nature.
Les préoccupations médicales de nos abstinents qui ne se consacrent
aux travaux de l'esprit que trois heures après avoir déjeuné font que
l'on ne produit plus de sages aussi charnus et substantiels que les
Grecs. Le bon sens nous indique clairement que, tandis que les aliments
se digèrent, la partie matérielle de la fabrique humaine est engagée
dans cette décoction ; c'est alors que l'intellect se trouve tout à
fait libéré pour réfléchir. Les grands livres que les moines ont écrits
ne cesseront jamais de le proclamer. S'ils n'avaient écrit et pensé que
l'estomac vide, ces robustes penseurs n'auraient jamais pensé, ni
écrit.)
– Nous avons bien raison, répétai-je, parce que
l'intelligence bien comprise, mère ou fille du sens commun de certains
particuliers, dit que l'homme qui se consacre trop aux personnes du
sexe, qui fait métier d'aimer, est une bête féroce. Il est
indispensable que la société le domestique à force de l'exposer aux
rires, qu'on lui fasse endosser le costume d'histrion porté sur les
galanteries aux yeux des femmes qui ne se méfient pas. La raillerie
rogne les griffes des lions. Comme la police ne peut mettre la main sur
ces scélérats, il est nécessaire de les dégrader de la dignité d'hommes
du monde : de là vient qu'ils s'exposent au sort de passer pour des
niais, ceux qui trouvent une fontaine de Vaucluse à chaque rue, et se
transforment en Pétrarque de carrefour. La société réprouve également
le contraire. Nous rions aussi de ceux qui s'attendrissent, se
lamentent et s'arrachent les cheveux, parce que leur dame les traite
avec dédain, ou parce que les contingences de la vie les empêchent de
s'unir aux tourterelles que les anges leur ont envoyées,
qu'immobilisent les pièges des hommes quand elles se posent sur le sol
maudit où l'argent agit comme la glu sur les oiseaux des viviers
célestes. L'on admet pas les benêts en amour, parce que l'amour
qu'absout la société, c'est l'amour circonspect. L'on accepte moins
volontiers les pleurnichards qui soupirent, parce que l'amour honnête,
c'est l'amour joyeux, répondis-je.
– Le peu que j'ai compris de ta réponse, fit observer
António Joaquim, m'autorise à supposer que Salomon tenait déjà compte
de toi quand il dit que le nombre des fous était infini. C'est un sage
qui juge un autre sage. Reprenons notre histoire, tu seras bientôt
libéré de cette litière comme de moi.
– Tu te trompes ! rétorquai-je. Je te suivrai probablement
aussi longtemps que je flairerai un roman inédit dans les boyaux de ta
mémoire. Je suis ton vampire, António Joaquim ! Je sucerai six volumes
de ton âme. Six volumes qui seront les six colonnes de ton marchepied
au temple des immortels !… Qu'a fait ton oncle ensuite ? Tu disais que
certaines personnes avaient pitié de lui, et que d'autres riaient.
– Quand le corps expéditionnaire débarqua au Mindelo,
Carlos Leite se trouvait ici à Porto. Sa garnison se retira
inconsidérément sous l'effet d'une terreur panique. Mon oncle ne put
faire personnellement ses adieux à Mariana. Il lui laissa un billet
rédigé en ces termes :"Nous ne nous verrons plus jamais. Je veux
mourir. Je vois arriver des jours où la mort deviendra accessible à ses
amis, et touchera ceux qui n'ont aucun penchant pour elle, et la
fuient. À l'éternité, Mariana." Carlos Leite voulait mourir parce qu'il
n'avait pas pu déraciner son cœur du terrain où l'avait cultivé sa
mère, une dame aux mœurs anciennes.
Avec ses airs par trop mondains, notre homme avait
contredit la réputation que lui avaient valu ses juvéniles étourderies,
en aimant d'une âme chaste une belle femme menottée aux colonnes de
l'autel. Jamais l'idée ne retint son cœur embrasé de disputer à la
violence d'un père la victime docile de spéculations familiales, une
sacrilège offrande à Dieu, comme si le Créateur qui éprouve un amour
profond pour ses créatures pouvait être trompé et flatté par les cœurs
qu'on jette dépecés dans son sanctuaire.
Carlos Leite était plus que certain que ce ne serait pas
le Très Haut qui serait scandalisé si la religieuse fuyait de son
cachot, et déchirait ses habits monastiques, le vêtement blanc de la
condamnée à un long supplice[37].
Il le savait, et le voyait à la
lumière de ce siècle, qui éclairait déjà, furtivement les esprits, en
dépit de la vigilance des tonsurés, et des baïonnettes postées autour
des ténèbres de l'autel et du trône. Cependant, les scrupules religieux
allant de pair avec l'infortune de Mariana firent de cet homme un
sublime martyr, un soutien à cette âme défaillante, un malheureux qui
se tourmentait spontanément pour qu'elle se consolât en offrant à
quelqu'un d'autre la moitié de ses peines. Voilà pourquoi mon oncle
voulait mourir. Le découragement l'aveuglait déjà, pour ne lui laisser
que des visions d'outre-tombe. Les années lui pesaient. D'espoir de
bonheur ici-bas, où elle l'entendrait et le comprendrait, il ne lui en
restait aucun. En attendre du ciel !… Oh ! Quel nectar, quelle ivresse,
et quelle anxieuse attente cela devait-il susciter en son être ! Mais,
quoique pieux, mon oncle était moins ascétique, beaucoup moins que les
poètes, une excellente espèce, comme il se doit, qui se fait des
illusions pour ne ressembler à personne. À quoi ça rime de plaire à des
femmes qui nous fuient en ce monde, pour nous combler dans l'autre
?… Je suis convaincu que les aventures au ciel sont d'une plus
belle eau. Des femmes et des hommes au ciel, mon ami ! Du sexe en
présence de Dieu !… Il me semble que ce serait insoutenable, l'espace
d'un seul trimestre, pour le bon ordre de l'Éternel !…
– Attention, ton langage détonne : il s'écarte du ton
funèbre de ce récit, fis-je observer à mon ami. Ça fait un bon moment
que ton oncle est parti de Porto… Les facultés de mon esprit sont
mobilisées, je veux savoir ce qu'a fait la nonne après.
Quand les libéraux sont entrés à Porto, certaines
religieuses, épouvantées à la perspective de voir les couvents traités
sans façons, allèrent se réfugier chez leurs parents. Craignant que son
père ne trouvât à redire à sa décision, et ne la soupçonnât de quelque
crime, Mariana s'en fut chercher un abri chez des parents aux environs
de Paço de Sousa. Carlos Leite se trouvait à Ponte Ferreira quand elle
y passa en compagnie de ses domestiques. Il lui serra la main, la
soutint, inanimée, dans ses bras, lui dit quelques mots sur un ton
paternel, et la fit accompagner, par des soldats, chez ses parents. Il
se douta du projet de la religieuse d'assister à la première bataille,
et de chercher la mort là où son ami espérait la trouver.
Mon oncle eut quelquefois des nouvelles de Mariana, et lui
écrivit des lettres que je détiens. Je crois qu'aucun officier
supérieur de l'armée de Dom Miguel n'a pressenti comme lui l'issue de
ce combat. Dans l'une de ses lettres, il dit :" Nous défendons le roi ;
les assiégés défendent leur vie. Nous sommes quatre-vint mille hommes
convaincus de se battre pour une juste cause ; ils sont quinze mille
convaincus qu'ils sont les seuls à pouvoir assurer leur salut. Nos
prêtres nous parlent de la protection de Dieu et des saints. Les
assiégés s'encouragent les uns les autres, et ne comptent pas sur le
soutien de Saint Georges, ou de Saint Jacques. Ce sont nécessairement
eux qui vont l'emporter." Il ajoutait, après quelques lignes : "Je ne
verrai ni cette défaite, ni cette victoire."
Les travaux d'investissement terminés, le régiment de
Carlos Leite s'approcha des lignes. Les batailles des premières mois,
selon ce qu'on peut retenir de la balbutiante Histoire dont nous
disposons, ont offert peu d'occasions de se distinguer par son
héroïsme. Nous ne devons pas croire sans réserves ce que nous racontent
les vétérans qui, d'un côté comme de l'autre, gardent les cicatrices et
le souvenir de ces jours funestes. Mon oncle rêvait d'une grande
bataille, d'une bataille décisive. Il a été de ceux qui se réjouirent
du plan d'un assaut général aux lignes le jour de la Saint Michel.
Il finit par trouver la balle qu'il attendait. Il tomba de
son cheval sous la batterie de Bonfim. La blessure était mortelle. Les
soldats le transportèrent dans la loge de la maison que je t'ai
montrée. On réquisitionna dans l'ambulance les onguents pour soigner la
plaie, qui saignait sous la clavicule droite. Mon oncle fit un geste de
refus, et murmura :"Ne me tourmentez plus." Il prit ensuite à part un
sergent auquel il faisait confiance, et lui dit : "Occupe-toi des
papiers dans mon bagage, et envoie-les-lui. Si je pouvais, je lui
écrirais deux lignes avec mon sang… Pour quoi faire ?… Une douleur
inutile…"
À peine eut-il proféré ces paroles, une femme entra dans
la loge, vêtue comme une paysanne, en poussant de hauts cris. C'était
la religieuse. Elle s'agenouilla au chevet de Carlos Leite. Ne tenant
plus sur ses genoux, elle tomba, le visage contre les dalles. Mon
oncle la releva. Dans l'effort qu'il fit pour la serrer contre son
sein, il perdit connaissance, et mourut là.
Mariana ne retourna plus à son couvent, ni dans la famille
qui lui avait offert un refuge. Je sais qu'elle fut recueillie par des
fabricants de São Roque da Lameira, qui la prirent pour une fille de
cultivateurs. Le sergent chargé de lui remettre les papiers de mon
oncle mourut quelques heures après son commandant. Le bagage fut envoyé
chez ma mère par le camarade de mon oncle.
Au bout de deux mois, à la tombée d'une nuit tempétueuse,
Mariana se présenta chez nous, en compagnie du camarade de Carlos
Leite. Le soldat prit ma mère à part et lui dit :
– Cette dame est la religieuse que mon
commandant a aimée dix ans.
– Eh bien, alors, dit ma mère, je l'aimerai
toute ma vie.
Mariana entra dans notre famille. Je l'appelais ma tante ;
ma mère l'appelait sa sœur. Cette sainte parenté dura vingt mois. Je me
rappelle qu'elle avait une beauté cadavérique, avant que la
putréfaction ne couvrît son visage de taches bleues. Le sourire, avec
lequel elle nous remerciait de nos tendresses, serrait le cœur. Un jour
de l'automne 1835, alors que tombaient les premières feuilles, cette
sainte de l'amour et de la saudade inclina sur le sein de ma mère son
front blanc et froid comme le marbre, et rendit son dernier soupir en
balbutiant :"Je vais le voir."
XXIV
CONCLUSION
La litière s'arrêta rue da Boavista à la porte de
Francisco Elisário.
C'est chez lui qu'António Joaquim avait l'habitude de descendre. J'ai
pris congé de mon ami. Je pleurais tant j'avais mal aux os ; mais j'ai
profité de ces larmes, en les attribuant à un très fort sentiment de
gratitude. Nous nous sommes engagés à nous retrouver le lendemain pour
savourer, dans une douce quiétude, le plaisir de parler d'évènements
et de personnes de notre passé. Je me retirai, moulu, dans mon auberge,
pour me faire palper par un rebouteux. Grâce à des potions alcalines, à
des fumigations, les derniers vestiges de ces vingt heures de litière
avaient disparu le lendemain.
Mon premier soin, ce fut de nourrir mon livre sur Ce qu'il
va y avoir de notes sur les histoires que m'avait racontées mon
généreux ami. Le livre où je serre des squelettes de romans, je
l'appelle Ce qu'il va y avoir,
parce qu'il contient les sommes
embryonnaires que je recevrai du public, un nom trivial et un rien
plébéien, qui, dans un langage plus noble, désigne la part lumineuse du
pays pour laquelle, et en l'honneur de laquelle, les artisans de
l'esprit polissent et facettent leurs brimborions. L'inconvénient de
ces "créances", c'est qu'elles avortent parfois, pour la bonne raison
que ce sont des embryons. Sinon, qui possède un livre sur Ce qu'il va y
avoir au Portugal, dispose de plus qu'il n'est nécessaire pour
se faire
connaître de son porteur d'eau, et pour être un sociétaire de
l'Institut de Coimbra. Au-delà, c'est le début de l'immortalité.
Le lendemain, je reçus la visite de mon ami. Il me raconta
que, chez Francisco Elisário, même les meubles pleuraient de joie.
Adriana, l'heureuse épouse de cet époux régénéré, avait donné le jour à
un garçon aussi robuste qu'un éléphant. J'éprouvai la joie
communicative de ces bonnes gens, et je ris, moi aussi. Tout ce qu'on
appelle les biens suprêmes de cette vie sont des jouissances mesquines
et passagères au regard des ineffables transports de la paternité, que
l'on ne saurait mieux établir et définir qu'en rappelant qu'elle figure
dans la loi romaine et, apparemment, dans le droit écrit et coutumier
du Portugal.
António Joaquim fit venir son épouse, sa mère, ses enfants
les plus âgés pour assister au baptême de l'enfant. Il me félicita
d'avoir présenté mes vœux à ces deux dames qui se disputaient, en
faisant valoir autant de douces raisons, le cœur de mon ami. La main
d'une nature capricieuse, c'est le moins qu'on puisse en attendre quand
elle veut produire des femmes de cette sorte, se cache dans les forêts
du Minho, et d'autres forêts : on arrive au point où sa sainte
ignorance charme les créatures dans leur berceau, et les accompagne le
reste de leur vie, pour leur remettre, au bord de la sépulture, la clé
des énigmes d'une autre vie. Dans les villes, la nature ne peut venir à
bout de l'art. Les épouses et les mères ont un autre genre de mérites
qui les rehaussent considérablement, et les embellissent en leur
donnant les nuances de la société : il leur manque cependant ce don qui
les déifie, l'ignorance.
Quand ils furent passés, les jours de la fête d'Adriana,
mon ami, le visage brisé de chagrin, entra dans ma chambre et me dit :
– Que sont devenus les garçons de Porto qui ont
représenté, il y a douze ans, la jeunesse dorée de cette terre ? Où
sont les joyeux causeurs dans ma chambre à l'auberge française ? Je
suis entré dans les estaminets, je n'ai reconnu personne. Sont-ils
morts ?
– C'est possible. Une douzaine d'années, c'est un
cataclysme. En quatre mille trois cents années et plus, le torrent
d'une génération se vide dans les fosses des cimetières. Tu es surpris
d'un phénomène bien naturel, António.
Mon ami partit plus triste de chez moi, comme un qui
tourne le dos à un esprit futile, indigne d'entendre les regrets
qu'inspirent les morts oubliés.
Le lendemain, je le rencontrai à la "Promenade des
Vertus". Il y avait avec lui un ami de leur printemps à tous deux.
C'était… — C'est un hommage que l'on rend aux grands morts infortunés
de ne pas rappeler leur nom aux vivants, qui tendent juste l'oreille
pour connaître le nom de ceux qui ont réussi.
António Joaquim présentait, en l'écoutant, toutes les
apparences d'un douloureux étonnement. Je m'approchai, et je l'écoutai,
moi aussi. L'essentiel de son discours ininterrompu, sur un débit
précipité, soulignait son état d'esprit :
– Les astres s'acharnent sur moi. Il y a une conjuration
du ciel, de la terre, et de la mer contre moi. Mes ennemis dans les
airs ont des corps lumineux comme des flammèches hérissées des forges
de l'enfer. Ce sont des puissances qui obéissent à mon implacable
ennemi. Lorsque la guerre contre ma pauvre tête vient du levant, ou du
midi, j'ai un Etna dans le crâne. Il ne peut s'épanouir aucune fleur
d'espoir autour des flammes qui brûlent dans ma tête Les puissances
grondent à l'intérieur de mon tympan comme si l'humanité traînait ses
chaînes sur un plancher de bronze. C'est infernal, mon vieux ! Tu ne
sais pas comme je souffre !
António Joaquim tourna vers moi des yeux pleins de larmes,
puis il contempla la veste, le pantalon et le chapeau boueux, troués,
et indigents de son ami.
Le malheureux avait perdu l'esprit un an avant.
– La dernière fois que j'ai vu cet homme, m'a dit ensuite
António Joaquim, c'était il y a six ans, au bal du comte de ***. Quelle
grâce, quel entrain manifestait alors ce jeune homme ! Les femmes
auraient pu l'aimer ; mais nous, les garçons, nous adorions chez lui
ses satires éloquentes, ses phrases à deux tranchants, l'ironie
sentimentale de ses confidences amoureuses. L'on disait que la fille du
comte de *** était folle de lui. L'on attendait qu'il voulût donner un
lustre à sa fortune en se liant à cette famille qui avait une grande
influence en ce temps-là. Je l'ai interrogé là-dessus en déjeunant avec
lui après le bal : il me dit que ses amours sérieuses, c'était une
fille de douze ans, belle comme le sourire d'un enfant endormi d'un
mois, rieuse comme les anges qui amènent à Dieu l'âme pure d'une
vierge. Il ajouta qu'il aimait cette fille de douze ans depuis qu'il
l'avait vue, à neuf, dansant parmi d'autres gamines, coiffée de fleurs
blanches, souriant à tout le monde avec des lèvres et des yeux, des
yeux où Dieu ou Satan avaient introduit cet aimant qui peut élever
l'âme vers le ciel, comme le précipiter dans l'abîme. Serait-ce cette
femme qui a enfermé l'âme de ce pauvre garçon au creux des ténèbres
infinies ?
– Je n'en sais rien : mais je me doute qu'il a perdu la
raison en même temps que sa "fortune", un atroce gallicisme[38] qui
cherche ses élus dans la boue, et transforme cette boue en coussins de
plumes ; tandis qu'elle pousse du pied dans la fange les berceaux en or
où les prédestinés, comme ton ami, ont ouvert leurs yeux. J'ai connu,
moi aussi, l'opulence, en matière de raison, et l'opulence dorée. Je ne
connais aucun crime qui lui soit imputable, aucune faute. Tous les
infortunés, incapables de se gouverner se considèrent comme des égaux
devant sa bourse. Il prêtait de l'argent sans autre intérêt que la
gratitude ; mais il tenait quitte aussitôt ses débiteurs du capital et
des intérêts : ceux-ci en étaient cependant fâchés pour la bonne raison
qu'ils entendaient que cette façon de les libérer de leurs dette
revenait à ne pas vouloir prêter plus d'argent moyennant un taux aussi
usuraire. Quand il s'est retrouvé pauvre, ton ami m'a distingué parmi
ses connaissances ; et quand il a perdu l'esprit, il m'a fait la faveur
de venir me voir. Ces visions qui le tourmentent, et que tu n'as pu
formuler dans ton esprit, sont les affreuses chimères qui entourent la
monstrueuse chimère que l'on appelle la PAUVRETÉ. Quand il a perdu la
raison, tout homme pauvre doit lui ressembler, et entendre ces fracas.
Quand ils n'écoutent pas Dieu, les pauvres qui ne perdent pas la tête
doivent voir des choses encore pires. Les pauvres qui ont sept enfants
voient sept visages jaunes de faim. Leur mère qui ne peut injecter dans
leur sang le sang exténué de ses artères, voit sept spectres qui lui
disent : "Pourquoi nous as-tu donné la vie, femme vicieuse et mère
dénaturée ?" Voilà qui prouve que les visions des hommes qui ont toute
leur tête sont plus effroyables. On pleure à juste titre le destin de
ce jeune homme que nous avons tous les deux connu dans une situation
plus enviable et plus prospère ; mais je pleurerais sur lui avec plus
de conviction au fond de mon âme, s'il avait la raison assez claire
pour se voir pauvre, couvert de haillons, et sale. Demain ton ami va
mourir[39]. La congestion
va noyer l'aspic qui lui ronge le cerveau.
Tout est fini : c'est la démence qui le maintient debout, et si le
courage de se donner la mort lui manquait, tu le verrais vieillir
exténué par l'amertume et les opprobres.
– Ce sont là de bien vilaines théories, fit mon
raisonnable ami. La pauvreté serait donc une ignominie, une douloureuse
détresse ?
– Non ; la pauvreté est un enchantement pour les yeux et
la raison ; la pauvreté n'est pas une ignominie ; c'est une continuelle
glorification des honneurs. Une veste rapée dont on voit les fils, aux
yeux de cette société chrétienne, représente une valeur que l'on peut
estimer par rapport aux revers agrémentés de crachats et de rubans.
S'il veut côtoyer les puissants, il suffit à l'homme pauvre de montrer
son blason — des bottes trouées. Si tu es pauvre, casse ton écuelle de
Diogène au nez de qui t'approuvera, la vaisselle des riches est à ta
disposition ; tu n'as qu'à faire dire au portier qu'il y a là, dans la
cour, un pauvre méritant, qui préfère demander ce que lui doit
l'humanité, plutôt que de s'en saisir de ses propres mains là où il
trouvera la meilleure occasion, et la plus sûre opportunité.
– Et le travail ? Qu'est-ce que la vertu du pauvre, sinon
le travail ? répondit António Joaquim.
– Le travail, en effet ; c'est une vertu, comme c'est une
vertu de manger, de dormir, de ne pas marcher pieds nus, et de profiter
d'autres avantages individuels et relatifs. En ce qui me concerne, le
travail est une nécessité ; l'appeler vertu, cela relève de la poésie.
J'en tombe d'accord avec toi, comme avec Rousseau : "Tout homme oisif
est un fripon.[40]"
J'espère te prouver le reste de ma vie, si je ne
l'ai pas encore fait, que j'ai accepté de bon cœur et sans barguigner
ma condamnation au travail. Quand je poserai ma tête sur les genoux de
la dépendance, mon ami, c'est que je la laisserai tomber de la
dépendance au charitable sein de la mort. Tu peux constater que la
paresse ne m'inspire pas ce qui a tout l'air, à tes yeux, d'une thèse
absurde.
– C'est que je ne vois pas encore ce que tu veux prouver !
fit António Joaquim. Ce que tu me dis, s'il s'agit d'une thèse, ne me
semble pas mieux ficelé que les visions de mon pauvre ami.
– Ce que je veux dire quand je parle de ton malheureux
ami, c'est que beaucoup, dans la détresse qui était la sienne après
avoir perdu leurs biens, et avant de perdre la raison, beaucoup,
dis-je, dans sa situation, en cherchant et ne trouvant pas de travail
répondant à leurs capacités, ont dilapidé leur énergie morale et la
probité qui les stimule, la volonté soutenue de se montrer nobles dans
leur pauvreté. Ces puissantes facultés une fois consumées dans un
effort contre l'ordre des choses…
– Mais qu'appelles-tu l'ordre des choses ?
– Le ministre de la Justice qui n'a pas nommé ton ami
commissaire.
Le ministre des Finances qui ne l'a pas fait contrôleur
des douanes.
Le ministre de la Marine qui ne l'a pas nommé secrétaire
d'un gouvernement d'Outremer.
Le ministre du royaume qui n'a pas voulu de lui pour
diriger une fabrique de députés dans je ne sais quel quartier.
Et ton ami était un bachelier instruit, intelligent, sans
une seule tache dans sa vie de garçon.
Voilà ce que j'appelle l'ordre des choses.
Que voulais-tu qu'il fît ? Bourrelier ? Coiffeur ?
Allumeur de réverbères ? Je te demande de faire appel à ta raison
fondée sur ta solide culture pour me répondre.
– S'il avait eu un peu d'esprit, dit António Joaquim, il
se serait fait écrivain.
Ce qu'entendant, je me signai, levant les yeux au ciel, et
dis.
– La providence divine a jugé bon de le rendre fou par les
moyens ordinaires de la démence courante, plutôt que de le frapper de
l'extraordinaire folie de se faire écrivain au Portugal. Quel paradoxe
! L'intelligence de ton ami ne lui a pas ouvert les portes de la
fonction publique ? Non : fort bien ; essayons de faire quelque chose
de cette intelligence ! Un écrivain — le dernier métier où l'on puisse
profiter de ce rayon lumineux du cœur de Dieu !…
Oh, mon ami, la suprême faveur que puisse recevoir un
Portugais du ciel, c'est de perdre la raison, la veille du jour où il
se fera écrivain public !
XXV
Quelques jours après, je reçus, vers neuf heures du soir,
la visite de
mon cher António Joaquim.
Une douce occasion m'avait gratifié, à ce moment-là, d'une
position décourageant tout commerce, analogue à celle de Xavier de
Maistre, quand il entreprit son voyage autour de sa chambre. Le sublime
philosophe écrivit alors le plus amusant, le plus charmant des petits
livres en ce monde. Tous nos vœux à la police de Turin qui
circonscrivit les horizons de l'auteur du Lépreux aux quatre murs d'une
chambre, qui offrait une ambiance où les idées en or ondulaient comme
l'étincelante poussière sous un rayon de soleil. L'humanité ne
disposerait pas de ce livre de saudade, sorti du cœur, réconfortant, si
un écart de l'écrivain ne l'avait pas contraint à cette réclusion.
Je parcourais, moi aussi, des yeux, les murs de ma
chambre. Mon mobilier, comme des ottomanes et des fauteuils, invitait à
un prudent repos, qui excluait tout tentative de voyager. Chacun de ces
meubles requérait l'immobilité pour conserver les apparences d'un
aménagement. Si je les déplaçais, j'aurais égalé de Maistre dans sa
chute, sans avoir besoin de me distraire.
Les rideaux de ma chambre n'avaient rien des engageantes
mousselines blanches et roses de l'aimable narrateur : elles avaient
cette opaque transparence qui donne à la lumière l'obscurité d'un
cachot. Les tableaux qui pendaient à quatre clous représentaient quatre
malheureuses personnes : une femme assise au bord de l'abîme, qui en
sondait les profondeurs pour s'y précipiter. Le second, c'étaient deux
fiancés, depuis huit mois, enfermés dans leur sépulture avant de voir
fleurir leur premier printemps sous le ciel, où ils s'étaient embrassés
pour s'avancer, durant une longue vie, à la lumière de la même étoile.
Le troisième représentait un artiste vaincu dans sa lutte contre la
misère, donnant l'unique morceau qui lui restait à manger à un chien,
son seul ami, qui allait certainement connaître l'heure suprême de son
agonie, figurant dans le dernier tableau. De tels encouragements vous
invitent à pleurer ; mais pas à voyager. Je déclare une fois pour
toutes que je n'avais pu accompagner mon ami, ni chercher à le voir,
durant quelques journées et quelques nuits. J'étais emprisonné, avec ma
chambre pour me faire honneur l'espace de deux semaines.
Il m'a semblé plus que désolé, António Joaquim. Remarquant
sur son visage une tristesse inhabituelle, je lui dis :
– Porto ne te réussit pas, mon cher. Va-t-en d'ici, si tu
ne dois pas rester à tout prix. Je présume que tu es pris de nausées
provoquées par des ulcères que ta pathologie sociale ne connaissait
pas. Retourne à ton village, António. Les infortunes, résigne-toi à les
connaître par les romans, qui ne te prennent guère de temps. Qu'as-tu ?
Est-ce la vision de ton ami d'enfance fou et tout crotté de la boue des
rues où il dort ?
– C'est tout.
– D'où viens-tu ? Comme ça, en habit noir ?
– Du cimetière. J'ai assisté hier à un enterrement,
aujourd'hui à un autre.
– Je sais que c'était aujourd'hui António Coelho Lousado
que l'on mettait en terre. Et hier ?
– C'était José Francisco Fernandes.
– Je ne l'ai pas connu.
– Moi non plus ; je suis venu, sans y avoir été invité,
m'adosser à l'ombre de la chapelle du cimetière du Prado, parce que
j'ai vu des files de voitures qui participaient à un cortège de
funérailles. Il devait y avoir trois cents personnes qui illuminaient
le passage du cercueil au caveau qui lui était destiné.
J'ai demandé qui avait été en ce monde illusoire ce
défunt, qui s'avançait, si pleuré par se amis, vers l'éternité, et par
une porte sculptée dans du si beau marbre. On m'a dit que c'était le
sieur José Francisco Fernandes.
Comme j'ai reconnu dans le cortège mon honorable parent,
Francisco Elisário, dès qu'il eut éteint son cierge, et se fut essuyé
ses dernières larmes, je m'approchai de lui et lui demandai de me dire
quelque chose de son défunt ami.
Francisco Elisário me répondit :
– Vous retiendrez, Monsieur, ce qu'il a laissé : plus de
cent quatre-vingts contos.
– Je ne vous demande pas combien il a laissé : je voulais
savoir qui c'était.
Il me regarda en prenant l'air bienveillant de ceux qui
tolèrent les questions stupides, et dit :
– C'était José Francisco Fernandes.
– Un homme de bien, honorable, un bienfaiteur de
l'humanité ?
– J'estime que c'était un homme honorable, qui tenait bien
ses comptes, et je n'ai pas entendu dire qu'il eût fait du mal à qui
que ce fût.
– Et du bien ?
– Qu'est-ce que j'en sais, mon vieux ! répondit le mari de
ma cousine. S'il a fait le bien, on lui rendra la pareille dans l'autre
monde. Sinon, qu'il se débrouille.
– Mais il me semble, cousin Elisário, que vous essuyiez
vos larmes.
– Il n'aurait plus manqué que non ! fit-il, en ménageant
des pauses funèbres dans son discours. Imaginez ça : l'on se trouve au
bord d'une tombe, en train de se rappeler que peu importe que l'on ait
de quoi ou non, on finira tous là !
– Ah ! Vous ne pleuriez pas, mon cousin, sur votre ami,
vous pleuriez sur vous…
– Non, c'est une affaire sérieuse de mourir, mon cher
António.
– Je ne trouve pas que ce soit une affaire, sauf pour les
héritiers du sieur Fernandes. Vous me dites donc, Monsieur, que tout ce
monde qui s'est rendu à cette cérémonie, vient de rendre les derniers
honneurs à un cadavre qui était hier un capitaliste.
Et nous nous en allons d'ici présenter nos condoléances à
un neveu qui a fait main basse sur cet héritage. Qui aurait pu imaginer
que ce bon-à-rien allait hériter ! C'était un voyou, qui traînait par
ici, un cigare à la bouche, avec un lorgnon, et un cordon à son
chapeau. Son oncle l'a chassé de chez lui il y a deux ans, et jeté dans
le vaste monde. Personne ne s'inquiétait de son sort.
– Ah ! Ces personnes qui vont maintenant partager son
chagrin ne s'inquiétaient pas de son sort ?
– Il n'aurait plus manqué que ça ! Un vrai faisan !
– Il a changé de plumage. Il avait les cheveux noirs, il
s'est teint en blond[41].
– Je ne comprends pas ce que vous dites, Monsieur, fit
remarquer mon cousin.
– Je dis que le neveu du défunt Fernandes, que Dieu l'ait
en sa sainte garde…
Elisario m'interrompit pour dire : "Amen", en tournant ses
regards vers la lune. Et j'ajoutai :
– Comme il est devenu l'héritier de son oncle, celui-ci
lui a légué, du même coup, les trois cents amis qui viennent ici !… Le
monde est laid, cousin Francisco !
– Et pas qu'un peu, cousin António ! Mourir comme ça,
quand l'on commence à jouir de sa fortune, c'est difficile à avaler !
Moi, chaque fois que je vais à un enterrement, j'y pense toute la nuit,
et je me réveille dans un sale état.
Là-dessus, le mari d'Adriana éternua, et dit :
– On dirait que je me suis enrhumé ! J'ai fait une belle
sottise en venant ici par ce froid ! J'aurais dû rester chez moi. C'est
la dernière fois que je m'y laisse prendre. Quand je mourrai, que
personne n'aille à mon enterrement !
Le monde est triste ! continuais-je à me dire dans mon for
intérieur, j'étais tellement distrait, que je n'ai plus fait attention
à Francisco Elisário, et que je suis allé confier à ma femme et à ma
mère la tristesse qui accablait mon cœur.
J'ai sur moi un journal d'aujourd'hui où l'on annonce
l'enterrement de l'ami des trois cents personnes d'hier soir :
Nécrologie
L'on a mis hier en terre les restes mortels
de M. José Francisco Fernandes, un citoyen irréprochable, qui s'était
ménagé l'estime générale. Quand de tels hommes quittent ce monde, ils
laissent sur la terre un vide, et les larmes sincères de l'humanité.
L'on a bien vu le nombre de ses amis, il y avait une telle affluence
autour de sa dépouille ! Le corps de ce citoyen émérite a été enfermé
dans le magnifique caveau que l'illustre défunt avait fait ériger.
Après avoir accompli leur triste devoir, les amis du regretté Francisco
Fernandes sont allés serrer tristement la main de notre grand ami
António Eleutério Bernabé Fernandes, neveu et fort digne héritier du
défunt. Nous espérons, et tous espèrent, que M. Bernabé hérite aussi de
ses vertus. Un homme de bien est mort, il en a laissé un autre à sa
place. Requiem sternum donna eis,
domine, et lux perpétua luceat eis.
Comme tu vois, l'auteur de cette notice demande à Dieu, en
latin, de donner au défunt ainsi qu'à l'héritier un repos éternel. Et
je demande, moi aussi, à Dieu, en portugais, d'accorder un repos
éternel à tous. Je vais maintenant te parler de l'enterrement
d'aujourd'hui.
J'avais lu d'António Coelho Lousada, de Porto, de gracieux
petits romans dans la Peninsula
et le Comércio do Porto. J'ai
lu des
billets d'humeur aussi cocasses que délicats dans le Nacional. J'ai lu
une magnifique étude du XVIe siècle, dans un roman intitulé : La rue
obscure. J'ai lu un autre roman intitulé Dans la conscience, dont on
m'a dit que c'était une réponse à un autre que tu avais publié sous ce
titre : Où se trouve le bonheur ?
J'ai lu un roman inachevé intitulé Les
Tripiers qui portait sur la glorieuse légende[42] qui explique
d'une façon si sublime ce qualificatif, qui, selon certains niais,
semble déplacé pour la vaillante race des habitants de Porto, lesquels
se sont dévoués aux conquêtes d'outre-mer. J'avais tout lu, et je me
suis pris d'affection pour l'écrivain qui ajoutait les dons d'un esprit
élevé aux vertus d'une noble indépendance, et de l'honneur dans un
dénuement presque total.
Comme j'ai lu hier la nouvelle de la mort de Lousada, je
me suis rendu aujourd'hui au cimetière pour contempler le front
où s'est éteinte la lampe dont il a entretenu la flamme avec
l'huile de ses larmes, peut-être ! J'y suis allé, et j'ai vu ce
que je voulais, parce qu'autour de son cercueil il y avait peu de monde
pour le regarder. Et lui, on aurait dit qu'entre ses paupières à demi
fermées, il les comptait, et filtrer, avec les cendres de son cœur, le
souffle vivifiant des âmes qui lui exprimaient leur regret par un
soupir, un sanglot vacillant. Là oui : de véritables amis entouraient
ce pauvre cercueil, jeté à la fosse commune, pour se perdre à jamais
parmi les ossements des pauvres. J'ai pensé alors qu'il aurait une
magnifique inspiration, celui qui jetterait sur la sépulture nue
d'António Coelho Lousado un de ses livres en disant : Voilà une
épitaphe !
Je suis sorti du cimetière. Les jeunes gens — ils
l'étaient tous — sont partis avec moi, ils avançaient, taciturnes,
recueillis. Certains se sont arrêtés à la porte de la maison d'où était
sorti le mort, ils sont entrés ; d'autres poursuivaient leur chemin, en
disant : "C'est à Porto que nous présentons nos condoléances, pour
avoir perdu l'un de ses plus grands esprits, celui dont on pouvait
espérer le plus de livres glorieux pour une terre qu'il aimait tant."
Je suis entré dans un estaminet, où j'ai chipé ce journal,
dans l'intention de te montrer la notice sur l'enterrement de Lousada,
que je te demande de comparer à celle du financier qui l'a précédé de
vingt-quatre heures au sein du Seigneur.
La voici. Je lis :
Nécrologie
Hier est mort António Coelho Lousada, qui a
écrit certaines œuvres qui méritent qu'on s'y arrête. Il a été fauché
dans la force de l'âge. Nous déplorons la perte de cet écrivain
apprécié de tous ceux qui le connaissaient, et qui n'a guère été
redevable à la fortune.
On voit bien que cette rubrique locale ne pouvait être
écrite que sur un mort qui n'a guère été redevable à la fortune Quand
meurt quelqu'un qui lui doit beaucoup, les plumes funèbres, trempées
dans de l'essence de larmes, se chargent de solder les comptes avec sa
créancière, la fortune, en mettant à contribution les héritiers du
défunt, qui restent les prêtres de cette généreuse déesse.
J'ai réfléchi là-dessus, et j'ai pris le chemin de ta
chambre, car tu me semblais éprouver beaucoup d'affection pour
Lousada.. J'ai imaginé là-bas que tes regrets allaient embrasser le
cadavre de cet ami, et que, parmi les gouttes de rosée, qui au point du
jour, vont humecter la terre, l'une d'entre elles sera la larme que je
vois sur ta joue.
ÉPILOGUE
Hier, le 27 octobre de cette année 1864, vu les dimensions
modestes de ce livre, j'envisageais de mettre sur pied une autre
histoire, que mon ami ne m'a probablement pas racontée, quand se fit
annoncer une personne en capote et bottes imperméables.
C'était António Joaquim.
Cinq ans étaient passés sans que nous nous soyons revus.
– Tu te portes on ne peut mieux ! s'écria-t-il.
– C'est le bonheur qui m'engraisse ! dis-je en tâtant mon
double menton sous la barbe pour me convaincre de mon embonpoint. Et
toi ? Tu es fait à lard ! Tu as la force et la bonne santé d'un
éléphant ! Tu es l'emblème du Minho en chair ; je ne dirai pas en os,
parce que tu as cessé d'appartenir à la classe des animaux vertébrés ;
tu es un mollusque intelligent, António ! Qu'est devenue ta famille ?
Et tes enfants ? Tes associés dans l'arche sainte où tu navigues sur ce
cataclysme de la corruption universelle ?
– Ils se portent tous bien. Le seul individu corrompu de
l'arche, c'est moi.
– Toi !?
– Parfaitement, puisque j'ai involontairement permis que
mon nom fût lu dans vingt feuilletons et plus du Comércio do Porto. Ce
qui garantissait la pureté de ma vie et de mes mœurs, c'était
l'obscurité. Tant que le monde m'ignorait, je savais que ma cachette
serait à l'abri d'une curiosité malveillante et pestilentielle ; mais
depuis que tu m'as fait vivre, discourir, débiter des fadaises comme
n'importe quel membre de ce funeste club qu'on appelle la société, ma
personne, mon moi subjectif a
cessé d'être moi, pour
devenir toi. Je
veux dire que tu as anéanti mon individualité propre ; tu m'as fondu
dans la matière universelle ; et tu m'as contaminé, je souffre de la
peste commune.
Tu as été ingrat envers l'homme qui t'a offert sa litière
pendant vingt heures ! Tu as mis sous presse le témoignage de ton
ingratitude, et tu ne trouveras plus dorénavant de personne assez
généreuse pour te rendre un service au risque de devenir l'auteur de
tes livres. À ce que je vois, tous les malheureux qui s'entretiennent
avec toi sont tes collaborateurs, et gratuits en plus. Cela ne se passe
pas comme ça en France. Balzac payait les intrigues de ses histoires,
et tout écrivain de bonne foi répartit ses gains avec ceux qui lui
apportent leur concours.
– Tu viens donc réclamer ta quote-part des Vingt heures de
litière ? demandai-je, tout disposé à respecter la propriété
intellectuelle de mon ami sur ses idées.
– Non, répondit-il. Je ne suis pas irrémédiablement
infecté par la gangrène mercantile qui pourrit l'humanité. Je ne vends
pas d'idées. L'intelligence est un éclair de Dieu, c'est un rayon de
lumière qui ne se décompose pas en boue. Louer l'esprit pour un certain
nombre d'heures au lecteur qui t'achète un livre, c'est de la simonie,
un trafic infâme, un ignoble marchandage avec les dons d'une lumière
éternelle.
– Tu renonces donc à ta part sur les bénéfices pour ta
collaboration dans les Vingt heures
de litière ?… Merci beaucoup.
– Je renonce aussi à la gloire.
– Ça, c'est impossible ! rétorquai-je aussitôt avec la
vanité de ceux qui immortalisent leurs semblables. L'immortalité, on ne
la peut décliner. Tu peux juste devenir indigne avec moi des
applaudissements des générations à venir. Ton nom figure dans vingt
feuilletons ou plus ? Compte en siècles le temps que tu te survivras à
toi-même. Les personnes qui conçoivent des romans, et celles qui sont
conçues ou reprises dans les romans ne peuvent pas mourir tout à fait.
Si elles ne sont pas perpétuées dans le bronze, elles durent, plus ou
moins racornies, autant que des momies. Les nécropoles, ou les salons
mortuaires où l'on dépose ces momies intellectuelles, ce sont les
épiceries, conformément à la règle. Le beurre et le cumin sont la
résine et l'asphalte aromatique de ces embaumements.
Je ne puis, cher ami, réparer les dégâts que j'ai faits.
Te rendre immortel, ç'a été une irrémédiable sottise comme beaucoup
d'autres. Pardonne-moi, mon intention était honnête ; et tu dois
imaginer combien il me serait pénible d'irradier d'une immortelle
auréole ton nom qui s'y prête bien mal. Un homme qui s'appelle António
Joaquim dispose de tous les atouts pour être une excellente créature ;
mais il jure avec la lyre classique, et le luth des romantiques.
– Tu es de plus en plus niais ! fit mon ami, en me serrant
dans ses bras affectueux, soulignant le côté innocent et frelaté de ces
facéties que je sers aux personnes que j'estime le plus.
– Pourquoi donc es-tu venu ? M'as-tu été envoyé par la
Providence des romanciers en mal d'imagination ? M'apportes-tu
l'épilogue des Vingt heures de
litière ?
– Je suis à ta disposition ; mets-moi à la question.
– Raconte-moi ce que sont devenus les héros encore vivants
des vingt-cinq chapitres déjà publiés. Voici les Comercio à portée de
ta main.
L'héroïne du premier récit, c'est la jument qui t'a sauvé.
Est-elle encore vivante ?
– Je pensais que tu m'épargnerais ce douloureux souvenir ;
mais puisque…
Infandum...
jubes renovare dolorem[43]
,
...tu sauras qu'alors que je goûtais les délices d'une reposante et
grasse invalidité, cette bête qui m'a sauvé en la dix-huitième année de
ma vie a reçu un méchant coup de sabot d'un âne et n'a pu survivre à
cette ignominie.
– Telle était la mort promise à ta jument ! fis-je
observer. Rares sont les personnes distinguées qui ne finissent pas de
la sorte sous les ruades de nos baudets. Ton illustre défunte s'est
montrée l'égale des grands hommes d'État blanchis sous le harnais, des
grands génies qui viennent clore le cycle intellectuel de leur
génération. Il y a de lamentables exemples au Portugal de ces coups de
sabots homicides. Console-toi, mon ami, en te disant que ta jument a,
en fin de compte, bu la lie de cette liqueur enivrante qu'on appelle la
gloire. Ce qui me manque, ce sont des informations sur la position
sociale à laquelle cet âne s'est hissé. Je parie qu'il n'a pas à se
plaindre !
– Je n'en sais rien.
– Je vais me renseigner sur ce point, quand j'aurai la
patience de me pencher sur tous les individus de son espèce. Je sais où
ils se trouvent ; mais je ne les dis pas ici pour ne pas m'exposer au
triste sort que ta jument.
Continuons. Les fils de João do Cabo, l'homme qui a
déterré de l'argent ? Son père l'emmène-t-il encore aux mines où il a
expié la dissipation de ses biens ?
– Son père est mort. Le cadet qui a fait ses études à
l'Université, a reçu son patrimoine, et l'a joué en moins de trois ans,
ici à Foz. Il avait vingt-cinq ans, il était pauvre. Il est allé
demander à ses frères de lui venir en aide. L'aîné qui est un prêtre
intelligent, l'a bien accueilli, il a dit à la bonne : "Faites le
meilleur lit et préparez les meilleurs plats pour notre hôte." La
gouvernante lui présenta qu'on avait pas besoin de faire tant de
cérémonies avec un frère. La prêtre rétorqua : – C'est un hôte.
Au bout de trois jours, ils sortirent ensemble, et là dans
un ravin de la montagne où se trouvait l'entrée d'une des mines où
avait travaillé leur père, à tous les deux, le prêtre s'arrêta, et dit
au diplômé :
– Ton père et le mien, que Dieu le garde, a dilapidé ses
avoirs ; mais il n'est pas allé mendier des faveurs et demander
l'aumône ; il a travaillé dans cette mine et dans d'autres. À l'endroit
même où nous nous trouvons, il nous a confié ses fautes et ses
châtiments, et il a conclu son discours en disant : "Mes enfants !
Maudit soit celui d'entre vous qui jouera ! " La malédiction de ton
père pèse sur toi, parce que tu as joué et perdu ton patrimoine. Je ne
sais si tu as aussi perdu ton honneur et je ne te le demande pas ; la
société le saura et te le demandera. La malédiction qui va
douloureusement peser sur toute ta vie, il n'y a qu'une façon d'en
adoucir l'âpreté ; c'est le travail, le travail comme expiation, qui
mène à la vertu. Ton père était agriculteur, il s'est fait mineur; tu
es un homme de lettres, tu as passé cinq ans à l'Université ; je crois
que tu n'as pas besoin de creuser des mines. Ouvre ton étude d'avocat,
et travaille. Si tu me dis qu'il y a chez tes frères du pain en
abondance, et plus qu'il n'en faut, je te réponds que c'est vrai, grâce
à Dieu ; mais nous le gardons pour les invalides, pour ceux qui veulent
travailler et ne le peuvent pas ; pas pour toi qui le peux et ne le
veux pas. Je vais faire pour toi, mon frère, ce que je ferais pour un
étranger. Si tu n'as pas de quoi te lancer dans la vie, je te donne mes
économies ; mais des biens, qui ont appartenu à ton père, pas un liard.
Le lendemain, l'ancien étudiant partit pour Lisbonne, avec
les ressources que lui avait fournies son frère. Il consacra une telle
énergie pour se perfectionner dans la pratique du barreau, qu'il est
aujourd'hui un avocat renommé, et commence à récupérer son patrimoine.
Dans les lettres qu'il écrit au prêtre, il ne l'appelle pas son frère ;
il l'appelle sa providence.
– Voilà qui me semble fort édifiant, mon cher António
Joaquim !… Et ce João Carlos, l'héritier de Rosalinda, la veuve du
général français ?
– João Carlos est resté dans la charmante villa dont il a
hérité ; et, quelques années après, il s'est marié avec une fille
pauvre, jolie, et malade comme les créatures dont l'air de cette vie
semble empoisonner les organes respiratoires de l'âme.
– C'était donc ce qu'elle avait !? Des organes
respiratoires de l'âme ?!
– C'est toi qui n'as aucun organe dans ton âme, espèce de
scélérat ! Tu n'as que du style. C'est ce que disent tous les gens qui
possèdent un corps et une âme en bon état de marche.
– Poursuivons… L'épouse de João Carlos est morte de
pneumonie ?
– Non : elle a pris du poids.
– Ah ! Les organes de son âme se sont concertés ? Tant
mieux !… Ont-ils donné beaucoup d'enfants à la société ?
– Une foule de petits anges qui se confondent et
s'entretiennent avec les fleurs du jardin, où leur père leur parle de
la généreuse dame qui leur a procuré des crues de bonheur à tous.
– Et ce Lourenço Pires de l'Histoire des fenêtres fermées
depuis trente ans ?
– Il est mort il y a deux ans. Il a échappé à son supplice
par l'issue la plus douloureuse. Cette première femme dont il avait
fait le malheur a continué à le traquer comme je te l'ai raconté. Il se
trouvait un jour couché et endormi au bord de l'Ave. La mendiante
descendait de la montagne qui le surplombait ; elle le reconnut. Elle
s'approcha de lui, à pas de loup, en l'épiant entre
les arbres. Elle s'arrêta à deux pas pour le contempler en faisant des
grimaces, en bougeant les mains. Puis, elle se jeta comme un fauve sur
lui, et d'une brusque poussée, avec force imprécations, elle le
précipita dans l'eau.
– Il a dû être bien surpris en se réveillant ! fis-je
remarquer, sincèrement ému par le sort de cet homme. Qui te l'a
raconté ? Permets à la critique de te poser cette question.
– Des laboureurs qui se trouvaient sur les plaines de
l'autre rive, sont accourus aussi vite qu'ils pouvaient, mais en vain,
pour sauver Lourenço Pires.
– Et qu'a-t-elle fait après ?
– Elle s'est enfuie dans la montagne, elle a gravi la
falaise la plus escarpée, et a lâché quelques éclats de rire qui
ressemblaient à des cris de geai, d'après les laboureurs. La justice a
déployé ses filets dans tous les districts avoisinants et a découvert
ses ossements, au bout de quelques mois, au milieu des rochers du mont
Córdova, à une demi-lieue de Santo Tirso.
L'enterrement de Lourenço Pires a été convenablement
organisé par le fils de Felicidade Perpétua, qui était également le
sien. Cette sainte femme a fondu en larmes. Dieu l'a emportée après lui
avoir montré la justice divine accomplie par les hommes.
– Et qu'as-tu à me dire sur ce Manuel de Mó qui, après
être rentré pauvre du Brésil, a fait ériger cette croix, en action de
grâces au Très-Haut ?
– Je l'ai rencontré cette année à Basto, à la foire de la
Saint-Michel. Cet homme s'est enrichi grâce à un héritage qu'a reçu son
épouse à la mort d'un oncle brésilien. Il m'a dit qu'il allait faire
édifier une chapelle au Très-Haut, pour voir si la main divine lui
épargnerait le titre de baron.
– C'est que cet héritage lui a donné de l'esprit, à ce que
je vois ! Et ce saint homme, Luís, l'enfant trouvé, peut-il encore nous
donner quelque leçon sur la morale de Jésus ?
– Oui. Le regarder en face, cela revient à entendre la
morale de Jésus. il n'y a pas de visage plus serein et plus gai. Ses
yeux ne pleurent jamais, parce que, dès qu'il voit des larmes chez
autrui, il n'a pas assez de tout son temps pour les essuyer.
Autour de Luis Ferreira, sa femme, ses enfants, ses
parents, ses amis, les étrangers, tous communient dans cette vertueuse
allégresse ou dans la compassion devant les douleurs qui ne font pas en
vain appel à sa charité. C'est l'homme de Dieu avec son paradis en ce
monde. Je ne sais si les théologiens partagent mon avis. Certains
exigent que le cœur du juste soit affligé de chagrins, qui leur
vaudront une récompense éternelle. Je suis un profane en ces matières.
Ce que je sais, c'est que Luís Ferreira est bon et heureux, ce qui doit
encourager les méchants malheureux à devenir bons. Que la théologie
débatte sur ce point.
– Et Miguel de Barros, que nous avons rencontré à
Penafiel, et qui ne parlait que d'enfants ?
– Il en avait alors six, il en a douze aujourd'hui.
– Ah ! le pauvre homme !
– Chaque enfant de lui qui naît, à ce qu'on dit, et je le
crois, est une nouvelle source de gaîté qui germe en sa demeure. Comme
il est robuste, il porte trois enfants à chaque bras, deux sur chaque
épaule, un à son cou, et les autres s'accrochent où ils peuvent.
– Voilà en groupe qui nous donne envie d'avoir beaucoup
d'enfants ! Et ta cousine Adriana, combien d'enfants a-t-elle à présent
?
– Tu ne sais donc pas que ma cousine a perdu son mari il y
a quatre ans ?
– Je l'ignorais ! Si ça se trouve, Francisco Elisiário est
mort du rhume qu'il a attrapé à l'enterrement de son ami Fernando ! Son
éternuement était sans doute de mauvais augure.
– Il n'est pas mort d'un rhume. Il a commencé par se
plaindre de douleurs au ventre, et par manger beaucoup. Il a souffert
de flatulences, et la médecine l'a laissé sans une seule goutte de
sang. Quelqu'un lui a suggéré qu'il pouvait avoir un ténia. Il a
consulté le Gérard de cette bête, le sieur Oliveira de Gondifelos, qui
lui a sorti six solitaires d'un seul coup. Francisco Elisário s'est
alors senti vidé, et plus mal. Il en est mort, laissant une "fortune"
considérable et six ténias baignant dans de l'alcool.
– Et ta cousine ?
– Tu me demandes si ma cousine baignait dans
l'alcool.
– Non, qu'est-elle devenue après ?
– Après avoir porté le deuil un an, ma cousine a épousé un
muguet de Lisbonne, qui l'a emmenée d'ici, et là-bas, elle jouit de
toutes les pompes que l'on peut se procurer avec cent contos réis, qui
se dissipent en dix ans. Je suis le tuteur du fils de Francisco
Elisário. Je le garde chez moi, en attendant qu'il arrive à l'âge où je
le ferai éduquer au collège. Ma mère me dit que d'ici quelques années,
il nous faudra faire asseoir à notre table la pauvre Adriana,
dépouillée de ses biens par son mari. Je lui ai trouvé des excuses,
quand elle s'est mariée. Elle avait besoin d'aimer. Elle a vu un homme
avec les yeux de son cœur. Elle l'a élu, elle a noué avec lui des liens
honorables. Si elle s'est trompée, si elle est malheureuse, ne la
condamnons pas.
– Est-ce que je la condamne, moi ? Elle est bien bonne !
Un trimestre d'amour, ça vaut bien cent contos réis, cela me semble
même bon marché. La condamnation sociale représente une remise bien
frivole pour qui s'est appauvri par amour ; ce que je trouve
déplaisant, c'est la pauvreté, et je veux croire que ta cousine ne la
trouvera pas plaisante. Elle doit essuyer force douleurs sourdes, force
humiliations pour son amour-propre, et des repentirs qui ne réparent
pas les ruines de son cœur, de ses biens, et de son âge. Eh bien, il me
semble à moi, que ta cousine aurait mieux fait d'avoir renoncé à cet
amour qui lui tranche d'un coup tant de liens importants qui la
rattachent à la vie. En ce qui me concerne, si j'avais la sottise de
vouloir condamner ta cousine, je devrais lui reprocher d'avoir senti le
besoin d'aimer, en ayant un fils. Un fils réunit en lui tous les amours
du ciel et de la terre. Quand il veut mettre un maillon entre lui et la
femme, le Très Haut lui donne un enfant.
António Joaquim m'interrompit :
– C'est joliment dit, il se peut même que ce soit vrai,
mais, pratiquement, cela ne va pas de soi. Si l'on aborde cette
question d'un point de vue physiologique…
Je le coupai, car il ne me semblait pas que la physiologie
fût une science, elle tend juste à épaissir les couches de matière :
– Laissons là les questions physiologiques. Dona Antónia
est morte ?
– Non, elle s'est retrouvée veuve, elle aussi.
– Ça, par exemple ! Eusébio Luís a-t-il été, lui aussi,
mangé par six ténias ?
– Je l'ignore. Les correspondants locaux des journaux
n'ont pas les connaissances requises pour exercer leur métier, ils se
dispensent de donner aux lecteurs des clartés sur les dérangements qui
affectent les viscères des personnes décédées.
– Dona Antónia doit être inconsolable !
– Elle l'a été assez longtemps ; elle est allée jusqu'à
attendre que s'écoule le délai raisonnable que l'on accorde au
désespoir d'une veuve ; j'ai appris, il y a six mois, qu'elle s'était
mariée avec un garçon de vingt-quatre ans.
– C'est encore pire !… Était-ce une obligation que lui
dictait son amour, comme le mariage de ta cousine ?
– Qu'est-ce que ça pouvait être d'autre ?
– Comment son mari va-t-il remplir le vide de son cœur ?
– Parfaitement, comme on remplit une vessie. En soufflant
dedans quelques soupirs, ce qui est facile pour un homme qui ne manque
ni de poumons, ni d'air.
– Mais, d'après ce que tu m'as dit tout à l'heure, j'ai
supposé que Dona Antónia avait la tête sur les épaules.
– Qu'ai-je dit maintenant qui te laisse supposer qu'elle
ne l'ait pas ? Elle a aimé. Cette parole absout tous les accès de
folie. S'il faut vraiment critiquer l'une de ces veuves, ma cousine est
plus coupable que Dona Antónia. La veuve d'Eusébio Luís n'avait pas
d'enfant, ni de parent, ni de proche, pour éclairer les ténèbres de sa
vieillesse. Elle aime comme une épouse, offre le tendre amour d'une
mère à l'homme qu'elle a épousé. Et s'il est un mauvais mari, elle peut
l'estimer comme un bon fils. Comme elle est en outre fort riche, même
si son mari jette l'argent par les fenêtres, il est probable qu'elle ne
sera pas réduite au dénuement. Elle pourra dire à l'heure de sa mort,
en regardant son mari : "J'ai manifesté ma vertu, en t'abandonnant mes
biens, pour que tu les partages avec une autre qui sera plus digne de
toi."
– Je te donne ma parole d'honneur, m'exclamai-je, que tu
ne pousses pas de vieilles dames riches à se marier avec des jeunes
gens pour l'ineffable plaisir de leur laisser leur richesse, qu'ils les
partagent avec des jeunes femmes. Mais quant au sentiment maternel,
j'entends qu'il sera profitable de le développer chez les dames âgées,
mais en faveur des orphelins sans appui, des enfants de pères pauvres,
des milliers d'enfants de Dieu qu'elles doivent adopter, épousant de la
sorte l'esprit de Jésus Christ. Prends donc un cigare et dis-moi
quelque chose qui remplisse trois pages. Qui avons-nous de plus sur qui
tu puisses me raconter quelque chose qui fasse trois pages ? As-tu
quelque chose à dire sur cette petite Teresa qui avait deux bœufs.
– Ah ! s'exclama António Joaquim, je vais proposer à ton
livre un dénouement tragique.
– Tu veux dire que les deux bœufs sont morts et
elle-aussi ?
– Les bœufs sont tombés sous le coutelas du boucher. Ils
ont été naturalisés anglais sous l'effet de la métempsycose. C'est
Teresa elle-même qui conseilla de les vendre quand son père fut réduit
à une indigence presque totale, après avoir perdu sa maison, à la suite
d'un litige avec des parents. La jeune fille a fait preuve à cette
occasion d'un courage héroïque. On l'a vue assister au départ des bœufs
pour Porto. Elle leur a caressé la tête entre son sein et ses bras.
Elle n'a pas pleuré. Son âme noble a étouffé ses larmes pour ne pas
exacerber les angoisses de son père.
Comme ils sont restés sans terres, ils en ont loué
d'autres. Teresa travaillait sans ressentir la fatigue, pour alléger
les charges de sa mère. Le vieillard, absorbé par son infortune, tomba
dans une indolence proche du marasme, il cachait son visage entre ses
genoux pour pleurer. Les terres, faute de bras, n'étaient guère
cultivées. Teresa était l'homme de la maison, mais elle était seule. La
récolte suffit à peine à payer le loyer de la première année. Ce
dernier échec ouvrit la sépulture au pauvre vieillard.
Luís, l'enfant trouvé, vint en aide à cette famille. Tu as
là cette leçon morale de Jésus que tu me demandais il y a un instant.
La mère et la fille acceptèrent l'asile que leur offrait le commandeur.
Rien ne leur manquait, si ce n'est le bien-être.
Teresa pensa à se marier pour trouver un soutien plus
légitime, et plus acceptable pour son cœur.
Un filleul de Luís Ferreira, commis au Brésil, vint
prendre l'air de sa patrie. Teresa lui plut, il éveilla dans son âme
vierge ses premières sensations. Il la demanda à sa mère, et à son
parrain Luís Ferreira n'accueillit pas bien la requête de son filleul,
et lui dit : "Va gagner de quoi assurer ta subsistance et la sienne, et
viens après, Teresa sera célibataire, et t'attendra." Contraint par sa
passion à mentir, le commis dit qu'il disposait déjà de quelques contos
réis qui lui permettaient de s'établir au Portugal.
– Comment les as-tu gagnés, demanda Luís.
– En faisant du commerce, avec ce que m'avait avancé mon
patron.
– Mais quand tu es arrivé il y a deux mois du Brésil,
répliqua son parrain, tu m'as dit que ton salaire arrivait mal à
couvrir tes frais. Pourquoi m'as-tu menti à ce moment-là, si tu ne me
mens pas maintenant ?
Le commis bredouilla. Luis Ferreira pardonna au jeune
homme ce mensonge inspiré par l'amour, mais déclara qu'il ne se sentait
pas concerné par ce mariage.
Ils se marièrent étant bien entendu que Teresa resterait
chez son bienfaiteur, tandis qu'il partirait et reviendrait du Brésil
après avoir réalisé ses capitaux. Ils devaient s'établir ensuite à
Braga avec un magasin de blanc. Teresa y consentit.
La mari de la belle fille obéit à la terrible nécessité de
se séparer d'elle, après avoir lutté deux mois.
Il se sépara d'elle, en l'aimant plus qu'il ne l'avait
prévu. Il savait bien que revenir du Brésil avec assez de fonds pour
s'établir, c'était une tâche qui exigeait beaucoup de fatigue et
d'économies. Il réfléchit aux moyens de s'enrichir rapidement ; son
expérience du Brésil contredisait cependant tous ses calculs. Autour de
son esprit chauffé à blanc, voletèrent des expédients honteux,
quoiqu'ils présentassent les attraits d'heureux exemples. Parmi de
nombreuses solutions, il était obligé d'accepter celle qui lui
paraissait la moins répugnante. Il pensa à la fausse monnaie, et quitta
sa femme avec ce cancer qui rongeait les liens qui le rattachaient
encore à l'honneur.
Il arriva à Porto. On lui avait dit qu'on y fabriquait de
faux billets absolument parfaits. Je ne sais qui l'a entraîné dans le
sentier du crime, au point de se confronter avec les agents de
l'admirable faussaire. Avec son propre argent, et quelques emprunts, il
acheta quelques faux contos réis à bas prix, estampillés brésiliens.
Il partit. Il reprit son ancien emploi, de façon plus
avantageuse, en tant que comptable. Sans qu'il le sût, par
l'intermédiaire de certains de ses amis, Luís Ferreira sollicita du
patron de son filleul des faveurs et une protection pour le commis,
pour qu'il pût regagner sa patrie, retrouver sa femme, et l'enfant
qu'il avait laissé dans son ventre. Le patron critiqua ce mariage, mais
associa son comptable à ses affaires. Le mari se trouvait donc à même
de faire venir sa femme au Brésil.
Il ne le fit pas ; le dessein de s'enrichir malhonnêtement
avait été signé par le démon.
Il introduisit dans les échanges monétaires de
l'entreprise quelques faux billets, en soustrayant les sommes
équivalentes. Il s'en sortit bien. Il avait mis de côté un conto réis.
Il se sentit encouragé à recommencer l'opération. Il profita encore du
vent portant de l'enfer. À la troisième tentative, il fut foudroyé par
un retour de fortune. On soupçonna les billets qu'il présentait, de ses
propres mains, d'être des faux. On l'appréhenda au guichet de l'agence
bancaire. On perquisitionna à son domicile. On en trouva d'autres, en
liasses séparées des vraies. On le poursuivit, on le jugea avec toute
la sévérité des lois qui sanctionnent ce délit.
Cette nouvelle parvint à Luís Ferreira, alors que Teresa
attendait anxieusement une lettre par le paquebot. Quand il lut celles
de ses amis de Porto qui avaient reçu de Rio de Janeiro cette
information, le saint homme perdit connaissance. Teresa, qui avait
assisté, haletante, à cette scène, fit main basse sur ces lettres et
demanda aux enfants de Luís Ferreira de les lui lire. Le plus jeune,
sans mesurer les effets de son imprudence, lut à voix haute l'une
d'elle qui disait :
" Il se peut que votre filleul soit déjà mort à cette
heure. Les jugements, au Brésil, sont sommaires. Les faux-monnayeurs
finissent au gibet, alors que les nôtres ici fréquentent des endroits
où les pauvres honnêtes n'arrivent pas à aller… etc.[44]"
Teresa se mit à crier, en s'agitant frénétiquement dans
les bras de sa mère.
Revenu à lui, Luís Ferreira réprimanda son fils pour avoir
lu cette lettre. Il prononça quelques mots d'une inspiration toute
évangélique, mais convenus, invitant Teresa à se résigner, et partit le
lendemain pour Porto afin de se renseigner sur la façon dont il
pourrait sauver son filleul, en remboursant les sommes détournées, et
en suspendant cet arrêt moyennant finance. Personne ne put lui donner
de renseignements sur ce point. Tous lui disaient :"Si cela se passait
ici, au Portugal, on pourrait s'arranger."
Luís Ferreira rentra chez lui, résolu à envoyer son aîné
avec des pouvoirs illimités pour racheter le criminel en payant. Il
réconforta Teresa, qui inspirait des craintes à sa famille, en lui
faisant miroiter un semblant d'espoir. Les hurlements, les cris,
les appels à Dieu, c'étaient déjà des transports annonçant des accès de
démence. Les promesses réconfortantes du vieillard la calmèrent un tant
soit peu. Il lui donnait une lueur d'espoir, en lui disant que, si son
mari avait été condamné à mort, l'Empereur commuerait cette sentence en
peine de prison, et qu'elle irait rejoindre le prisonnier jusqu'à ce
que Dieu les prenne tous les deux en pitié.[45]
Le paquebot suivant apporta la nouvelle de la
condamnation du prévenu à seize ans de galère, il partait pour l'île de
Fernando.
Teresa reçut alors, elle aussi, une lettre de son mari,
juste quelques lignes :
"Quand tu recevras cette lettre, c'en sera fini de mes
malheurs…"
La malheureuse entendant ces mots littéralement poussa un
cri de joie.
Voici la suite de la lettre :
"Je me suis perdu pour toi ; mais Dieu sait que je ne
t'accuse pas, et que tu ne peux être accusée par le monde. J'ai joué
une carte, sur laquelle j'ai misé ma vie. J'ai perdu : je vais
maintenant me tuer parce que je ne puis vivre ainsi, avec une chaine de
fer, pendant seize ans… une vie entière ! Demande au Seigneur de
prendre mon âme en pitié, et dis à mon parrain de te donner un morceau
de pain, et un autre à notre fils. Adieu, Teresa. Si tu n'avais pas un
enfant, je te demanderais de quitter ce monde, où je n'ai pu vivre
honorablement. Ton mari, Z."
En entendant les derniers termes de celui qui lisait cette
lettre, Teresa poussa également un cri ; mais c'était comme si on lui
arrachait une raison qui se débattait dans ses affres.
Elle avait perdu la raison, elle est restée folle six
mois. Au bout de ces longues ténèbres, elle fut touchée par un éclair
d'intelligence.
Cette étincelle lui fit voir l'éternité, le ciel
peut-être. Teresa s'arracha des griffes de son effroyable supplice, et
s'envola dans le rayon de lumière que lui avait envoyé la miséricorde
de son Seigneur.
– Et son fils ? demandais-je.
– Il était mort dans son ventre, répondit mon ami, avant
de continuer :
Voilà comment a fini cette charitable amie de ses veaux. Les
sentiments qu'elle éprouvait permettaient de comprendre que le tendre
cœur de Teresa serait déchiré quand il se laisserait prendre à l'amour
d'un être humain, un amour qui renferme et cache des catastrophes sans
nom, et d'innombrables malédictions.
Y a-t-il assez de matière pour ton livre ?
– Oui. Il finit mal. Je verrai si, au prix d'un pieux
mensonge, j'invente quelque péripétie, qui étonne le lecteur, ou le
fasse du moins rire des tares de mon imagination.
– Je ne consens pas à ce que l'on mente en mon nom, dit
Joaquim sur un ton solennel.
***
NOTES
[1]
Faut-il préciser que l'auteur évoque les litières à deux
mulets, avec un double brancard auquel on attelle une bête à l'avant,
une autre à l'arrière, l'ancêtre de nos quatre-quatre, dans la mesure
où il y a quatre pattes motrices devant, quatre pattes motrices
derrière, si l'on considère que ce moyen de transport dégageait une
puissance de deux mulets-vapeur ? (NdT)
[2]
Là se trouve et
sera éternellement assis le malheureux Thésée
: Sedet aeternumque sedebit infelix Theseus. C'est dans l'Énéide au
vers 617 du livre VI, qui se passe aux Enfers. Comme les bons auteurs,
Camilo ne cite pas toujours exactement. (NdT)
[3]
Les curieux pourront consulter
l'Évangile selon Saint-Mathieu (25,14-30). (NdT)
[4] Le pinto vaut 480 réis. (NdT)
[5]
Plus connu sous le nom de Costa Cabral, qui gouverna en sous-main
le pays, d'une façon officieuse, sous le règne de Dona Maria II, après
avoir proclamé, à Porto, en 1842, le retour à la Charte, sans empêcher
les désordres qui ont suivi. Révoltes de Maria da Fonte, puis de la
Patuleia, entre autres. Le mouvement de la Regeneração qui prend le
pouvoir en avril 1851, officiellement dirigé par le maréchal Saldanha,
naguère écarté du gouvernement par Costa Cabral, s'engage à assurer la
stabilité politique. (NdT)
[6]
Les
mots alecrim et rosmaninho désignant tous les deux le romarin,
je me permets d'introduire une pincée de sarriette pour respecter le
rythme de la phrase. L'auteur n'emploie deux dénominations de la même
plante que pour obtenir un effet sonore que je m'efforce de conserver.
(NdT)
[7]
Malencontreuse inadvertance ? Ici, la future Maria Pires est encore
Maria Martins. (NdT)
[8] R comme reprovado, ce qui signifie recalé.
[9]
Le terme docteur, comme en français, ne désigne pas que les
médecins, quand il s'agit d'un titre universitaire.
[10]
Vasco Peixoto avait quitté ce monde quand on mettait la
deuxième édition de ce livre sous presse. Pourvu que ses héritiers ne
laissent pas à l'abandon les célèbres pêchers, qui rappellent encore la
valeur de leur admirable jardinier. Il y a bien des gens qui ne
laissent pas de si agréables
souvenirs. Les feuilles d'un arbre aux productions d'une telle douceur
en disent plus à la louange de celui qui les a plantés que celles du
plus fervent des panégyriques. (NdA)
Il n'y a, en portugais, aucun à-peu-près entre pêcher
(pessegueiro) et pécher (pecar) quoique la traduction ne
puisse éviter de produire un tel effet. (NdT)
[11]
Puisque l'auteur parle de lusitanisme, nous nous croyons tenu de
conserver le nom portugais d'un tel établissement. (NdT)
[12]Un affluent du Douro (NdT).
[13]
Le très polysémique casco, signifiant la boîte crânienne, partant
l'activité du cerveau qui se trouve dedans, ainsi que les sabots des
ongulés de base, l'Auteur se permet un calembour que nous ne sommes pas
parvenus à rendre. (NdT)
[14]
Le vintém vaut 20 réis, la pataca brésilienne 320, soit seize fois
plus. En réis, quatre vinténs donnent 80 réis, trois patacas, 960,
douze fois plus.(NdT)
[15]
Ce mot signifie sabotier. Le Portugal est si plein d'honorables
Lapins (Coelho) que j'hésite à
voir dans le barão de Coelho une malice
de l'auteur. Caetano da Chã dos Codessos, n'a pas honte d'avoir un nom
qui évoque une plaine couverte de cytises. (NdT)
[16]127 kilos (NdT)
[17]
Restauration de l'indépendance, acclamation de Jean IV Bragance.
Le Portugal cesse d'être une province espagnole. (NdT)
[18]
Sorte de génoise pour le moins pesante : 12 jaunes d'œufs, pour le
blanc de quatre œufs, 250 g de sucre, 150 g de farine. Il faut prendre
son temps pour battre les œufs avec le sucre (45mn à la main) on ajoute
la farine et l'on recommence l'opération pendant un heure ; ménager un
trou au milieu, limité par du papier sulfurisé, la pâte reposant sur le
dit papier, trente à quarante minutes au four. Une tranche de cette
préparation vous permettra de récupérer les calories perdues, les
commensaux se contenteront de prendre du poids. (NdT)
[19]
Cette exécution nous semble confirmée par ces paroles de Tomé
Pinheiro ou d'António Vieira au chap. LXV de l'Art de Voler : "Voler ce
que l'on va vous réclamer et faire payer, à vos dépens, c'est la pire
sottise, comme l'on voit d'après ce qui est advenu à Carvalho, la
semaine où je rédige ce chapitre. Il était gardien aux douanes de
Lisbonne, et gardait fort bien les étoffes d'autrui, vu qu'il les
mettait dans sa maison, comme si elles lui appartenaient : il fit
l'objet d'une plainte pour cela ; et comme il n'a pas présenté de
bonnes raisons, on l'a traîné de porte en porte ; il a prétendu lever
la tête aux frais d'autrui, on la lui a tiré au-dessus de son cou, à
ses frais " (NdA).
[20]
Le mot relação désigne aussi
juridiquement un tribunal de seconde
instance.(NdT)
[21]
Dom João est le fils qu'a eu Inès de Castro, la fameuse
reine morte, de Dom Pedro. C'est Alphonse IV qui fit mettre à mort la
maîtresse de son fils par trois sicaires, en l'absence du prince, et
non le père de celle-ci. Peut-être s'agit-il d'un autre Dom João et
d'une autre Inès. (NdT)
[22]
Dans la deuxième édition, que reproduit celle-ci, revue par
l'auteur, où les contes paraissent pour la première fois avec un titre,
à la place de ce titre, il y en avait un autre, erroné : "Histoire d'un
Billet" ; cette erreur se retrouvait dans la table des matières.
[23]
T, pour tolo, qui signifie
sot, mais n'a pas le sens que peut
prendre en français ce mot dans la langue classique, laquelle traite de
sot un mari qui ignore encore son infortune. (NdT)
[24]
Quartier à l'Est de la Ribeira, au bord du Douro, à Porto. Théâtre
de certaines festivités, surtout le jour de la Saint Jean. (NdT)
[25]
Certaines éditions, au lieu de mãe (mère)
donnent mão (main) tous
les deux féminins, je me permets de corriger. Le lecteur pourra se
permettre de comprendre "ma main trouva que l'attente était
courte".(NdT)
[26]
Traité de bonnes manières, paru en 1619, dont le titre se
justifie du fait que le Portugal est occupé par une puissance que
l'auteur estime étrangère. Ce n'était pas l'opinion à l'époque de tous
les Portugais. La Cour ne peut se tenir à Lisbonne, vu que les gens de
bien refusent de reconnaître l'autorité de Philippe III. Le Portugal ne
retrouvera son indépendance que vingt-et-un ans plus tard, et dix-huit
ans après la mort de l'auteur. (NdT)
[27]
Poète brésilien du XVIIIe né à Porto (NdT)
[28]
Cela fait l'quivalent de
cinquante-deux centimes. (NdT)
[29]
En espagnol dans le texte. L'auteur ne se croit pas tenu de
traduire. (NdT)
[30]
Ce mot désigne le griottier qui, comme chacun sait produit des
griottes (ginjas) ce qui
justifie certaines considérations de l'auteur.
(NdT)
[31]
L'auteur emploie indistinctement les mots désignant les bouvillons
(bezerro, boizinho) et les
taurillons (tourinhos, voire touros montés
en graine). Peu importe au traducteur, comme à l'auteur, que les bêtes
aient été coupées ou pas. Camilo aurait pu se contenter de n'employer
que le terme novilho, qui ne
distingue pas les jeunes bovins châtrés
des autres. Que ne ferait-on pas pour éviter les répétitions ! (NdT)
[32]
En français dans le texte. (NdT)
[33]
Soit un peu plus de quatre cents kilos. Beaucoup moins que les
bêtes que l'on présente actuellement aux concours, et qui en pèsent
souvent plus de sept cents. (NdT)
[34]
On frôle les
cent quatre-vingt mille réis, soit un peu moins que le prix des bœufs.
(NdT)
[35]
Ces bovins pouvant vivre plus ou moins vingt ans, la jeune fille
n'est pas près de se marier. (NdT)
[36]
C'est actuellement le nom d'un parc à l'est de Porto. En ce
temps-là, le quartier de Belleville à Paris était encore un village.(
NdT)
[37]
Alva désigne, outre l'aube et le
point du jour, le vêtement de lin
blanc que portent les prêtres catholiques au cours de certains rites,
et la chemise des condamnés au gibet (ce dernier sens étant conforté
par l'emploi du mot patibulo). Est-il impossible que l'auteur joue sur
tous ces sens ? L'aube est sinistre, la religion autorise de ces
manigances, la condamnation ne laisse aucun recours. (NdT)
[38]
L'auteur, qui voit des gallicismes partout, sait que le mot fortuna signifie avant tout le
hasard, le destin, et que, comme ce
hasard peut être heureux, il n'y a rien de plus heureux pour bon nombre
de gens, que d'avoir du foin plein les bottes, et la bourse bien
garnie. Oserons-nous lui faire remarquer, à titre posthume — le sien —
que ce dernier sens est apparu vers 1580, date de la première édition
des Essais de Montaigne ? Ce
qui permettra à La Fontaine de parler plus
tard de la fortune répandue
d'une laitière un peu trop ingambe. Cette
acception vient en treizième position chez Littré ; elle
existe en latin classique. Voilà un gallicisme qui remonte à Cicéron.
(NdT)
[39]
Il est mort un an après à Rilhafoles. (NdA). Il s'agit d'un asile
d'aliénés de Lisbonne. (NdT)
[40]
En français dans le texte. (NdT)
[41]
Il est difficile de rendre les jeux de mots, à partir de
l'expression troca-tintas qui
désigne un barbouilleur qui change
d'encres et de couleurs, aussi bien qu'un escroc, ou un individu
simplement brouillon. "Les couleurs, il a su les changer, preuve en est
qu'il s'est teint" Irons-nous jusqu'à imaginer que sa blondeur toute
nouvelle évoque la couleur de l'or ? (NdT)
[42]
À l'époque où mon ami parlait de ces choses-là, tout n'était pas
un ramassis de légendes en ce monde. (NdA)
[43]
C'est une indicible
souffrance, que tu me demandes, (ma
reine), de raviver . Les
contemporains de Camilo n'avaient aucune peine
à reconnaître le troisième vers du deuxième chant de l'Énéide. L'auteur
pouvait remplacer la reine par des points de suspension. Nous
précisons, à l'intention des lecteurs de notre balbutiant millénaire,
que c'est Énée qui s'adresse à Didon, la reine de Carthage, laquelle
vient de lui demander de raconter par le menu la fin du siège de Troie.
(NdT)
[44] Cette
peine n'est pas mentionnée dans le code brésilien. La loi du
3 octobre 1833 précise, à son 8e article que : "Les producteurs ou
introducteurs de fausse monnaie seront condamnés, la première fois, aux
galères, ils partiront à l'île de Fernando, ils subiront leur peine
pour une durée deux fois plus longue que celle de prison qui, dans le
code criminel, est prévu pour chacun de ces délits." (Deux à huit ans,
c'est la peine modifiée dans le code par la susdite loi). Les récidives
entraînent une condamnation aux galères
perpétuelles.(NdA).
Nous nous permettons de traduire gancho, qui signifie
crochet, attache, et prison au sens figuré, par gibet, comme le suggère
le contexte. (NdT)
[45]
Luís Ferreira n'était pas plus au fait que ses informateurs de la
jurisprudence criminelle au Brésil. (NdA)
|
|
