Le vingt et un mars de cette année mil huit cent
cinquante-six, vers onze heures et demie du soir, il y a précisément
quarante-sept ans, le sieur João Antunes da Mota, demeurant rue des
Arménios dans notre bonne et l'on ne peut plus loyale ville de
Porto, se trouvait chez lui. Il n'y a rien là d'extraordinaire.
Monsieur João Antunes pouvait se trouver où il voulait.
Voilà le début de cette histoire, un début froid et sans
grâce. L'on dirait un
Extrait de
Naissance. La description d'une
tempête, avec de la grêle claquant sur les vitres, le vent du nord
sifflant entre les solives, un bois séculaire qui agite ses branches en
craquant, et quelques-unes des grimaces que la nature fait à une
humanité saisie d'épouvante et que les romanciers, de Longus à nos
jours, rendent avec les expressions de rigueur, chaque fois qu'ils
n'ont rien d'autre à dire... Je crois que j'entendais vous présenter le
sieur João Antunes da Mota. À moins que j'aie caressé une autre idée.
Elle m'est venue, je l'ai oubliée. Quelle qu'elle fût, à n'importe quel
moment qu'elle arrive, elle tombera toujours à point ; et vous serez
alors, cher lecteur, dédommagé de la pauvreté, de la trivialité, du
style exténué dont je viens de vous gâter un palais habitué aux mets
plus épicés du roman, dont la tête ne manque jamais, et ne doit jamais
manquer de se présenter tout entourée de violentes rafales
et d'éclairs éblouissants. Un tel luxe de détails nous ferait gaspiller
beaucoup trop de cire pour un João Antunes. Lamartine fait d'un
maçon
un philosophe : l'omnipotence du génie est le Saint Antoine de ces
temps incrédules :
facit mirabalia.
Qui est donc cet habitant de la rue des Arménios ?
L'on y arrive. Quand João Antunes da Mota, surnommé le
Kágado(1),
naturel
de Lixa, était venu à Porto, c'était un gamin : son
oncle maternel, le père António Cabêda, l'amenait là afin de le faire
embarquer pour le Brésil. Il admirait, sur le quai de la Ribeira, la
taille d'un yatch que le bon António Cabêda appelait un
gréement de
guerre maritime, devant le garçon ébahi, lorsqu'un gros homme
s'approcha, qui portait une veste de toile jaune, et des babouches de
lin, et demanda au père António si le petit allait s'embarquer. Après
avoir reçu une réponse affirmative, le gros homme pria les admirateurs
du
gréement de guerre maritime
de se couvrir, précisa qu'il était le
propriétaire de deux épiceries à la Fonte Taurina, et désirait fort
engager dans l'une d'elles un garçon qui aurait la bosse du commerce.
– Pour ce qui est de la bosse, on ne peut mieux l'avoir,
dit l'oncle, en relevant fièrement la tête de son neveu, comme un
maquignon qui montre les dents d'un cheval.
– Pour ça, il a l' œil, dit l'épicier. Voulez-vous me le
confier ? Le Brésil, c'est partout. Il lui suffit d'avoir une bonne
tête, et bonne pour le commerce, avec ça l'on peut se faire de l'argent
n'importe où.
– Veux-tu partir ou rester, mon garçon ? demanda l'oncle
en donnant un coup de son pied droit à une motte de boue séchée.
– Eh bien... marmonna le garçon en tortillant le bord de
son bonnet.
– Allez, décide-toi. C'est bien le moment d'enfiler des
perles ! Il a raison, ce Monsieur, après tout : le Brésil, c'est
partout. Tu veux ou tu ne veux pas ?
– Je ferai ce que vous voudrez ; je préfère, moi, rester
plus près des gens que je connais.
– C'est décidé, cria le cultivateur en tapant sur l'épaule
grassouillette du marchand de morue. Le gamin reste avec vous.
Traitez-le bien : pour ce qui est de lire et d'écrire, ça va ; et de la
force ? Là, si vous permettez, il peut vous soulever deux arobes avec
les dents.
João Antunes entra chez son patron, dîna avec son oncle,
et lui fit ses adieux.
Quelques années après, le neveu du père António Cabêda
était le premier caissier, plus tard, le gendre de son patron, enfin
son héritier. En même temps que d'une richesse considérable, il hérita
du surnom de
Kágado, déjà
fort ancien, que lui avait laissé une antique
lignée de marchands de morue de la Fonte Taurina, comme le confirment
de bien étranges notes, qui, si elles étaient exactes, feraient
remonter cette généalogie à João Antunes da Mota, dont un serviteur
était allé s'installer à la Fonte Taurina, le premier des
Kágados. Il
était donc légitime, l'orgueil qu'inspirait ce surnom à João Antunes da
Mota, même si la branche mâle des
Kágados
s'était éteinte avec son
beau-père.
João était devenu veuf, sans laisser de descendance. La
lignée collatérale, représentée par d'autres marchands de morue de
Miragaia, avait demandé au veuf s'il voulait leur céder ses épiceries,
pour lesquelles ils verseraient de gros intérêts, à seule fin de ne pas
les voir sortir de la famille. João Antunes y consentit, céda son
entreprise, et se retira avec son énorme capital chez lui, rue des
Arménios. Selon les calculs de ses voisins, monsieur João se trouvait à
la tête d'au moins cent
contos,
en monnaie courante, solide, et
palpable.
Le capitaliste avait besoin d'employer à quelque chose son
immense besoin de se dépenser. Ne trouvant rien de plus commode et de
plus rentable, il prêtait de l'argent à intérêt sur des hypothèques ;
mais, sur le papier, les intérêts légaux étaient un innocent mensonge.
Monsieur João prêtait à quarante pour cent ou plus, et les
fidalgos ne
se lassaient pas d'engraisser son argent, en transformant en capital
l'usure énorme qui leur permettait de s'amuser et de se ruiner.
(Regardez leur enfants, qui sont nos contemporains).
Notre homme n'avait pas démenti la bosse qu'avait
pressentie dans son regard, António Cabêda, son défunt oncle. Usurier,
avare, dévot de Notre Dame des Douleurs des Congréganistes, ami intime
de l'évêque-gouverneur, en relation avec des familles nobles, et
spécialement avec le Garde des Sceaux, valant plus de cinquante contos
depuis qu'il s'était retiré du commerce, bien que pièce rapportée et
intrus dans la vénérable lignée des Kágados, João Antunes était
indubitablement le plus fripon de tous, sans vouloir le flatter.
Jamais, pourtant, les traits de caractère de João Antunes
ne ressortent autant que la nuit du 21 mars 1809. Ils justifient
parfaitement le début laborieux de ce roman, la crème des romans
véridiques, miracle d'une littérature mercantile, comme celle où
malheureusement la désinvolture de l'imagination fait que le lecteur
avisé n'accorde aucune confiance aux chroniques dont je suis l'éditeur,
le moins scandaleux des auteurs.
Il suffit de leur donner cette date, les
contemporains de João Antunes et les nôtres savent que l'invasion des
Français est survenue peu de jours après celui où le marchand de morue,
à onze heures et demie du soir, plein d'angoisse, impatient,
frénétique, glissait à chaque instant, rue des Arménios, sa tête, à des
hauteurs vertigineuses, dans l'entrebâillement d'une fenêtre en bois.
À la tombée de la nuit, João Antunes était rentré chez
lui, atterré. Il arrivait d'effrayantes nouvelles de partout. Les
Français étaient entrés dans Chaves, et descendaient, comme un torrent
dévastateur qui ne respectait pas les avoirs, la vieillesse, la pudeur,
la religion – des expressions employées dans les journaux de cette
époque. Pour la plus grande consternation des âmes croyant en Dieu, au
premier rang desquelles figurait celle de João Antunes, d'après un
message parvenu du quartier général de Braga en retraite, le général
Bernardim Freire, qui passait pour un jacobin, avait été assassiné par
le peuple, et les loyalistes, commandés par le baron d'Eben, avaient
été à ce point défaits à Carvalho de Este, qu'il leur restait juste le
temps de se replier sur Porto. Les informateurs ajoutaient que les
barbares dévastaient, incendiaient ce qu'ils trouvaient, déshonoraient
les vierges, tuaient les vieilles déshonorées, mangeaient les enfants
comme des anthropophages, et, pire encore, se livraient au
pillage. Cet
horrible vocable dans un discours à faire dresser les
cheveux sur la tête, mit João Antunes dans un triste état.
Pour comble d'infortune, le capitaliste atterré avait
prêté cent pièces quelques jours avant à quatre-vingts pour cent au
fidalgo de la Bandeirinha, João da Cunha Araújo Portocarreiro,
lieutenant-colonel au 6e d'Infanterie. La précipitation avec laquelle
le débiteur était parti pour les retranchements dont il assurait le
commandement, et le désordre qui régnait dans les administrations,
furent cause que l'on ne rédigea pas une reconnaissance de dette, une
imprudence que ne s'était jamais permise l'usurier dans ses
transactions !
Le pire, c'était que des populaires séditieux de la légion
grognaient que João da Cunha était un jacobin, et s'entendaient pour
l'arrêter, en tant que rebelle à son Roi, notre seigneur.
Voilà donc Antunes sans reconnaissance pour ces cent
pièces ! "S'ils tuent le jacobin, avec quel justificatif me
présenterai-je chez la veuve ?" Cette funèbre incertitude produisait
chez l'illustre greffon des
Kágados,
des fourmillements dans les
doigts, et une bonne crampe à la jambe droite, qui risquait de se
trouver paralysée.
L'avarice ne parvint pas à secouer la lâcheté naturelle de
l'usurier. Dans les nombreux accès de vertige devant la situation
désespérée de ses cent pièces, António da Mota songea à enfiler sa
capote de camelot, à traverser la ville, avec pas même cinq réis en
poche (le prudent João Antunes n'accordait aucune confiance à la
loyauté des vassaux fidèles, à juste titre), jusqu'à la batterie de
Bonfim, où l'on avait détaché Portocarreiro, le débiteur dont
l'insolvabilité paraissait évidente à son esprit halluciné. Sa nature,
en attendant, renâclait ; les jambes se dérobaient sous le sordide
créancier, et une sueur froide, accompagnée d'une brusque révolution de
ses intestins, redoublait la détresse de ce malheureux Gobseck, un
personnage bien connu des lecteurs de Balzac.
Pourquoi ne se couchait-il pas sur son lit en bois
de pin, et ne cherchait-il pas le sommeil où il pourrait au moins faire
valoir un document authentique à propos de ces fatales cent pièces ?
Il ne se couchait pas, d'abord, parce qu'il n'avait
pas sommeil ; deuxièmement parce que si les nouvelles de Braga se
confirmaient, d'après lesquelles les Français marchaient sur Porto, il
était indispensable de mettre en lieu sûr les loques de son lit, la
seule chose que l'on pût piller ; et enfin, parce que João Antunes
attendait quelqu'un si l'on en croit les coups de tête qu'il donnait
dans le vide, en la lançant dehors, par la lucarne, aussi vite que le
ferait une catapulte.
Il ne passa pas âme qui vive, jusqu'à minuit, rue des
Arménios.
Le marchand de morue tendait l'oreille vers Miragaia,
quand il entendit un bruit de pas. Il colla son menton à la lucarne,
mit sa main derrière le pavillon de son oreille, et attendit jusqu'à ce
qu'il fût convaincu que son voisin, le batelier António Corrêa,
surnommé
le Maure, était
enfin arrivé.
– Monsieur João, brailla, de la rue, le batelier.
– Je suis là à t'attendre, mon vieux. Alors ? Qu'est-ce
que tu as à me dire ?
– Que voulez-vous que je vous dise, Monsieur João ? Il a
été emporté par trois millions de diables...
– Qui ça ?
– Le fidalgo de la Bandeirinha.
– Dieu du ciel ! Je peux faire le deuil de mon argent !
Vous l'avez complètement tué ? Il ne peut plus parler ?
– On lui a définitivement coupé le sifflet ! Voilà comment
ça s'est passé. Nous l'avons arrêté pour l'amener chez l'évêque ; mais
ça ne faisait pas un pli, l'évêque était capable de le mettre dehors,
parce que les grands, ça se serre les coudes. Quand nous sommes arrivés
au
Padrão das Almas, Raimundo
José a fait un sermon au peuple, comme
quoi le mieux, c'était de faire un sort à tous les jacobins. Avant
qu'il ait fini, Francisco Reteniz colle une balle en haut de la tête du
fidalgo, et moi, je n'ai pas pu m'en empêcher, je lui flanque un coup
dans le dos. Le jacobin a demandé qu'on le laisse se confesser. Mais
là, ça démangeait tout le monde de cogner que c'en était une
bénédiction ! Il reste là, étendu de tout son long au
Padrão das
Almas... Demain, il aura des copains... On n'en restera pas là.
Luis de
Oliveira va passer l'arme à gauche. Quant au Garde des Sceaux, le
diable va l'emporter, lui aussi. Tous les prisonniers arrêtés pour
Haute Trahison, on va les couper en tranches dans la Relação.
João Antunes n'entendit plus son voisin sanguinaire.
L'expression "Garde des Sceaux" agit sur lui à la façon d'une coulée de
plomb qui tomba sur les ventricules de son cœur, qu'elle boucha.
Antunes ne respirait pas ; les contractions de son diaphragme
secouaient ses intestins rugissants. C'est que tous les chocs moraux,
dans cet organisme excentrique, retournaient immédiatement son estomac
et les organes environnants. Une infirmité originale et unique ! Une
suprême disgrâce pour un capitaliste atterré à cette triste époque où
les Français envahissaient le pays ! Les coups répétés d'une colère
sporadique qui donnait au malheureux des élancements dans le
bas-ventre, chaque fois qu'il se trouvait sous la menace d'un pillage,
à chaque assaut imaginaire contre ses cent cinquante mille réis.
Mais pourquoi le traitement que le batelier réservait au
Garde des Sceaux met-il João Antunes dans un tel état ?
Nous allons le voir.
Sa décision est prise : ses terreurs livides se dissipent
devant l'usurier, le voici qui met sa capote de quarts, enfonce son
bonnet de tortis sur les oreilles, glisse ses tibias tremblants dans
ses épaisses chaussettes de laine. Il dévale les dangereux colimaçons
de ses escaliers, colle une oreille sagace à la serrure, ouvre et ferme
doucement la porte disloquée. Ensuite, à pas comptés, João Antunes se
retrouva rue de Cedofeita, à la porte du Garde des Sceaux, Manuel
Francisco da Silva e Veiga Magro do Mouro (la longueur de ce nom ne
convient guère à un roman, mais la vérité que l'on doit au conte admet
l'extravagance des noms de famille, qui constitue au Portugal l'unique
propriété de beaucoup de fils de quelqu'un). On lui ouvrit la porte au
troisième coup de sonnette. Ces tintements accélérés trahissaient
l'émotion de l'importun qui, à une heure du matin, interrompait le
paisible sommeil du magistrat.
La voix éraillée de l'ancien marchand de morue était bien
connue des domestiques. On lui ouvrit la porte, et on le conduisit,
sans l'annoncer, dans la chambre du maître de maison.
João Antunes exhiba, entre les tentures du lit du Garde
des Sceaux, une tête épouvantable. Ses petits yeux d'une couleur
indéterminée, étaient enfouis sous les contractions de sa paupière
supérieure, un effet de l'effroi provoqué par le meurtre du fidalgo de
la Bandeirinha. Le long de ses joues, spongieuses et vermeilles quand
sa prospérité n'était pas menacée, la corrosion de la terreur avait
asséché les sécrétions huileuses, laissant paraître, sur la surface
aride de la peau, les traces d'une agonie qui ne se peut comparer qu'à
celle de l'avare qui voit rouler tous ses biens dans l'abîme.
– Qu'est-ce qui vous arrive, Monsieur Mota !? dit le Garde
des Sceaux, alarmé.
– Vous êtes encore en vie, Dieu merci ! s'exclama João
Antunes en essayant de reprendre son souffle.
– Encore vivant ?! Elle est bien bonne ! Vous vous
attendiez donc à me trouver mort ? Le ciel m'en préserve ! Asseyez-vous
là... Qu'est-ce qui se passe ?
– Savez-vous ce que vous devez faire, là, tout de suite,
sans plus de préambules ? Fuyez, sinon l'on va vous tuer... Fuyez !
– L'on va me tuer ? fit le magistrat, impressionné, sur
son lit.
– C'est comme je vous le dis, Monsieur le Garde des
Sceaux... On va vous tuer...
– Pourquoi ?!
– Ça, je ne sais pas. Vous êtes condamné à être exécuté
avec Luis de Oliveira, et les prisonniers arrêtés pour Haute Trahison.
– Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Qui est-ce qui va
m'exécuter ?
– Ceux-là même qui ont tué aujourd'hui le
lieutenant-colonel João da Cunha, qui s'en est allé comme ça, avec cent
pièces à moi, sans reconnaissance, et sans témoins. Si je vous le
dis... c'est parce que je le sais de l'un des propres assassins du
fidalgo de la Bandeirinha.
– Serait-ce parce que j'ai voulu sauver hier le malheureux
João da Cunha ?
– Je ne sais pas pourquoi. Il n'y a qu'une chose qui
importe, Votre Excellence, vous devez vous enfuir au plus tôt...
– C'est impossible ! J'occupe un poste honorifique ; je ne
vais pas le lâcher.
– Il est bien question d'honneur ! Ce n'est plus une
affaire d'honneur ni de honte. Chacun doit sauver son argent et sa vie
des griffes de la canaille que vous auriez dû mettre, votre Excellence,
dans un cachot, et sous les fers. Enfin, il n'y a pas de temps à
perdre. Vous ferez ce que vous voudrez... Moi, je viens chercher mon
coffret.
– Votre coffret se trouve là-bas dans le grand tiroir de
ce secrétaire, à l'endroit même où vous l'avez laissé ; mais dites-moi
; cette terrible nouvelle que vous m'apprenez, a-t-elle un fond de
vérité ?
– Je vous ai déjà dit ce que je sais. Si vous voulez un
conseil d'ami, fuyez ; si vous n'avez pas peur, je ne donne pas cher de
votre vie.
– Vous cédez à la panique ! Vous avez écouté les discours
de quelque gueux de la bande des brigands qui ont assassiné João da
Cunha, et vous oubliez que l'on va mettre cette canaille aux fers et la
conduire, sur l'ordre de l'évêque, au château de la Foz.
– Vous voulez que je vous dise ? Je n'aimerais pas me
trouver entre la peau et la chemise de l'évêque. Ils vont découvrir, un
jour ou l'autre, que c'est un jacobin, et ils le tueront. Si j'avais du
temps de reste, j'irais le prévenir aujourd'hui.
– Pour qu'il s'enfuie ? dit le Garde des Sceaux en
souriant.
– Tout juste.
– Ce que je vois, c'est qu'il manque une case à votre
cerveau. Je comprends à présent, Monsieur João Antunes, l'origine
étymologique du nom
Kágado(2). En ce qui me concerne, vous avez rêvé
que
l'on me tuait, et que, par la même occasion, l'on volait votre pécule.
Vous vous êtes réveillé affolé, et vous avez couru chercher votre
argent, en inventant n'importe quel bobard sans queue ni tête pour
justifier ce coup de tête. Vous n'aviez pas besoin de vous mettre en
frais. Du moment que vous m'avez confié votre coffret, vous pouviez
venir le reprendre quand bon vous semblerait. Vous n'aviez pas besoin
de venir me faire peur, à moi qui ne suis qu'un enfant aux cheveux
blancs. Je vais appeler un de mes domestiques, il va se charger de
votre coffret.
– Non, ce ne sera pas nécessaire, Monsieur le Garde des
Sceaux. Je vais me débrouiller. Pourvu que vous n'ayez jamais à vous
repentir d'avoir fait si peu de cas de mes avis.
– Ce ne sera pas le cas, si Dieu le veut.
– Plaise à Dieu, alors !
– C'est bon : allez vous coucher tranquillement ; mettez
votre coffret sous votre oreiller ou, pour plus de sécurité,
endormez-vous à plat ventre dessus, et réveillez-vous avec des idées
plus gaies. Si vous êtes demain tout à fait remis, venez me voir, vous
me raconterez votre rêve sanglant à tête reposée.
Le Garde des Sceaux riait, tandis que João Antunes
gémissait en soulevant, dans le grand tiroir de son secrétaire, un
coffre volumineux de deux empans de haut sur deux de large. Il le cala
sur son genou, gémit encore pour l'enlever dans ses bras, faisant là
preuve d'une admirable énergie, puis s'en alla, avec une gravité
comique, tandis que le Garde des Sceaux était pris du plus sonore et du
plus interminable des fous rires.
João Antunes sortit indemne de son trajet entre la rue de
Cedofeita et celle des Arménios. Il s'assit de temps en temps pour
reprendre son souffle. Dans sa rue, à cette heure, il régnait un
silence sépulcral, quand le batelier, son gênant voisin, ne prolongeait
pas comme d'habitude ses délires d'ivrogne jusqu'au petit matin.
Le capitaliste s'enferma de l'intérieur ; il alluma une
bougie ; il inspecta le contenu de son coffret, vérifiant les rouleaux
de pièces, et ses valeurs en brillants, pour la plupart des gages sur
des prêts aux principales familles nobles de Porto. Il avait un
couvercle à compartiment secret, avec une clé spéciale, découvrant six
petits tiroirs, eux aussi fermés par des serrures avec une clé
différente pour chacune : une précaution inutile, dérisoire contre un
voleur qui aurait un bras pour porter le coffret et disposerait d'un
clou pour l'ouvrir à loisir. Cinq de ces tiroirs contenaient de la
monnaie en or, et des billets. La joie scintillait dans ses yeux;
contrariée par une peur bleue qui lui donnait des frissons dans le dos
et l'empêchait de digérer tout à fait le chyle de son bonheur.
Il descendit au sous-sol de la petite maison. C'était un
espace carré sans plancher, froid comme un souterrain, avec aucun signe
de vie, juste foulé par le cultivateur de São Cosme qui venait chaque
année enlever ses dépouilles accumulées et marchandées. C'était
une branche du commerce de cet habile économiste, qui, selon ses
calculs infaillibles, devait être rentable : il recevait des navets en
échange.
Dans le recoin le plus obscur de ce réduit glacial et
sombre, monsieur Antunes creusa un trou de quatre empans, à l'affût du
moindre bruit, allant jusqu'à se méfier des échos sourds de sa bêche.
Puis il plongea comme un dernier regard, profondément amoureux, sur le
coffre qu'il déposa tendrement au fond du trou, comme Joung l'avait
fait pour sa fille chérie. Il piétina et piétina encore la terre, avant
de la recouvrir d'ordures, d'éclats de pierre et de copeaux de bois
pourri.
Il était trois heures du matin. João Antunes mangea deux
sardines en escabèche, qu'il noya dans une demi-bouteille de vin, puis
se coucha. Mais, au moment où le sommeil semblait effleurer ses
paupières grasses, il fut assailli par une idée funèbre – la perte des
cent pièces prêtées au fidalgo de la Bandeirinha – et ne put retrouver
le sommeil. Le jour pointait : le roulement des tambours parvenait des
batteries du sud, l'émeute grondait de tous les côtés, c'était un
mélange confus de voix, de clairons, de grincements de charrettes, les
cloches sonnaient le tocsin. João Antunes bondit de sa paillasse, salua
le premier rayon de soleil qui glissa sur ses joues livides, descendit
à la tombe provisoire de son argent, s'applaudit de la perfection de
son travail et sortit, plus rassuré que jamais, sur le sort de son
dépôt confié aux entrailles de la terre.
L'usurier allait se lancer dans une tentative désespérée,
dont l'idée lui était venue durant son insomnie, pour sauver les cent
pièces prêtées au défunt brigadier João da Cunha.
Il lui restait la maison de la Bandeirinha. La veuve du
pauvre jacobin devait y vivre. João Antunes resta quelques minutes
piqué, indécis, devant l'héraldique portail des Portocarreiros. La
ladrerie finit par l'emporter, et cet homme sans cœur tira la sonnette
avec la détermination d'un créancier. Un serviteur en larmes vint lui
demander ce qu'il voulait. En donnant à sa voix une tonalité
compatissante, le marchand de morue dit qu'il avait besoin de
s'entretenir avec Dona Maria Rita d'affaires de la plus haute
importance.
Abandonnée de tous, entourée de ses tout petits enfants,
mais plus courageuse que ne l'est d'ordinaire une femme qui a perdu,
quelques heures avant, un tendre mari, la malheureuse veuve avait
besoin de quelqu'un pour la conseiller, compatir à son malheur et
proposer un endroit où cacher ses enfants. En d'autres circonstances,
elle eût été contrariée d'entendre le nom de João Antunes ; face à un
tel hôte, toujours abject quand il était question d'argent, elle aurait
pensé qu'il préparait quelque nouvelle escroquerie. En ces moments
d'intense désespoir, cette veuve désemparée avait besoin de
quelqu'un, ami ou ennemi, parce que ses larmes auraient attendri des
fauves, et que les fauves devaient avoir pitié de son état de veuve.
João Antunes fut donc reçu dans une
alcôve où Dona Maria, entourée de servantes, avec deux petites filles
dans ses bras, perdait connaissance tous les quarts d'heure, avant de
revenir à elle, terriblement consciente de sa propre vie, pour invoquer
son mari, la chair en lambeaux, le visage contre la terre ensanglantée,
attendant qu'une corde le traînât par les rues de Porto.
– C'est affreux, Monsieur Mota ! s'exclama la veuve, en se
précipitant sur l'impassible marchand de morue. C'est affreux ! mon
mari mort... mes toutes petites filles sans père... mon mari chéri !...
– Résignez-vous à la volonté de Dieu, chère Madame.
– Je suis incapable de me résigner à la volonté de Dieu...
– Ne blasphémez pas, Dona Maria !... Que Notre Dame des
Congréganistes vous pardonne.
– Comment croire que Dieu ait permis que mon mari soit
mort d'une façon aussi ignoble ? Pitié, Monsieur, n'allez pas dire que
c'est Dieu qui a voulu cela !... Quelle souffrance ! Et il y en a tant
qui m'attendent !
– Ce n'est rien pour vous.
– Pour moi ? C'est tout pour moi. Je suis la femme de ce
soldat estimé, qui a été tué par des êtres infâmes. Je veux demander
justice contre ses assassins ! Vengeance, Dieu de Justice, vengeance,
ils ont tué le père de ces petites filles, le mari de cette veuve, qui
vous demande à genoux vengeance, justice et miséricorde.
Dona Maria fut prise, à la fin de cette imploration, par un
tremblement de toutes ses fibres. Son visage plein de couleurs devint
subitement livide. Des larmes bouillonnaient sous ses paupîères closes,
et des spasmes nerveux contractaient ses doigts, qui prenaient la forme
de serres, donnant à ce composé d'horreur et d'infortune l'apparence
d'une mort particulière, celle d'une douloureuse agonie entrecoupée
d'épisodes délirants.
Comme personne ne l'invitait à s'asseoir, João Antunes
s'assit le plus spontanément et le plus commodément qu'il put, en
murmurant, sur un ton plein de compassion :
– Que Notre Dame des Congréganistes nous aide ! Il n'y a
que des chagrins en ce monde. Il nous faut tous souffrir !... – Et, se
tournant vers les domestiques qui soutenaient la veuve évanouie, il
demanda sur le même ton : – Elles durent longtemps, les vapeurs de
cette dame ?
– Ce ne sont pas des vapeurs, répondit avec humeur la
vieille Genoveva, une ancienne domestique de la maison, qui détestait
l'usurier, dont elle connaissait les ficelles aussi bien que sa
maîtresse. Si vous appelez ça des vapeurs, ajouta-t-elle, hors d'elle,
vous êtes bien capable de dire que Madame fait semblant de s'évanouir.
– Ne faites pas votre mijaurée. J'ai toujours entendu
appeler vapeurs ou pâmoisons ces choses-là. J'ai été marié, moi aussi,
et ma femme (que Dieu parle à son âme) avait des vapeurs, elle aussi.
– Comme ça ? Si elle pouvait en avoir moins... Il semble
que le Bon Dieu choisit les bons et ceux dont on a le plus besoin, pour
racheter la méchanceté de ceux qui ne manquent à personne...
– Que voulez-vous dire par là ? fit l'ancien marchand de
morue, froissé, qui n'était pas tout à fait stupide.
– Ce que j'ai dit... Vous voulez savoir, Monsieur João ?
Votre arrivée n'annonce rien de bon ; le mieux, c'est que vous ne
veniez pas faire encore plus souffrir ma maîtresse. Que lui voulez-vous
?
– Ce que je lui veux ? je ne l'ai pas encore oublié ; vous
le prenez de bien haut ; ce n'est pas ainsi que les maîtres de cette
maison paient les faveurs qu'on leur a faites.
– Ah ! je vois que vous choisissez le bon moment pour
réclamer le paiement de vos faveurs. Vous tombez à pic... Que
voulez-vous que je vous dise ? lança-t-elle brutalement en se tournant
vers les domestiques. Emmenez ces petites filles qui pleurent, pendant
que je porte Madame dans son lit... Quant à vous, Monsieur João, venez
à un autre moment.
– Tous les moments sont bons... Quand monsieur João da
Cunha m'a demandé cent pièces avant-hier, je ne lui ai pas dit que ce
n'était pas le bon moment.
– Je reviens tout de suite, dit la domestique en prenant
dans ses bras sa maîtresse inanimée pour la conduire dans sa chambre. À
son retour, elle prit l'attitude d'une dame, ce qui décontenança un peu
l'imperturbable stoïcisme de l'usurier.
– Que voulez-vous, à la fin ? De l'argent ?
– Si c'est possible, je veux mon argent ; si ce ne l'est
pas, je veux une reconnaissance de dette ou un gage, parce que je suis
pauvre, et que je ne gagne pas en un an ce que Dona Maria Rita gagne en
un mois ; je dois faire face à bien des difficultés, et je me tue au
travail dans mon bureau pour vivre sans avoir à rougir aux yeux du
monde et être utile à mes amis, quand ils ne veulent pas me faire du
tort. Voilà où l'on en est. Que Notre Dame des Douleurs des
Congréganistes me refuse toute assistance, si ce que je dis, ce n'est
pas la pure vérité. J'ai prêté au fidalgo cent pièces, et j'ai besoin
de savoir si la fidalga est prête à endosser le règlement de cette
dette ; je prouverai d'ailleurs, en prenant tout Porto à témoin, que je
suis incapable de réclamer ce qu'on ne me doit pas.
– Mais vous rendez-vous compte que c'est un véritable
crève-coeur de réclamer de l'argent à une pauvre veuve le jour où on
lui a tué son mari ?
– Mourir, en fin de compte, de cette façon ou d'une autre,
cela revient au même, on meurt. Vous dites que la veuve est malheureuse
; je n'y suis pour rien ; je suis malheureux, moi, si je perds mon
argent ; alors qu'elle, si elle était riche, elle le reste : son mari
n'a pas emporté ses propriétés avec lui dans l'autre monde. Je ne
dis pas que je veux mon argent tout de suite ; mais comme il nous faut
bien vivre aussi bien que mourir, et que je suis bien décidé à fuir les
Français je ne sais où, j'ai besoin d'emporter un document que cette
dame pourra récupérer n'importe quand.
– Et qui va lui parler, à elle, d'une telle chose ?
– Moi. Je ne mâche pas mes mots, Dieu merci. Allez voir
Madame dans sa chambre, et dites-lui que, si elle est en état de
m'écouter, j'ai besoin de lui parler, pour notre tranquillité à tous
les deux.
– Je ne vais pas me charger d'une telle commission.
– J'attendrai donc que Dona Maria vienne me parler. Je ne
m'en vais pas d'ici sans une reconnaissance de dette ou de l'argent.
– S'il y avait un homme dans cette maison, ça ne ferait
pas un pli...
– Voilà que vous me menacez, maintenant !... Que Notre
Dame des Congréganistes me vienne en aide... L'on se met en quatre, et
l'on se retrouve le nez dans l'eau... C'est ce qui arrive à quelqu'un
qui donne son argent. En tout cas je vous le dis, madame la vieille
boniche, sans aucune honte et sans craindre Dieu, ça m'est égal qu'il y
ait ici des hommes ou des femmes. Je n'ai pas peur du tout. C'est comme
je vous le dis ! Et ne venez pas m'échauffer la bile, sinon ça va mal
tourner, et l'on verra ce que l'on verra ! Attention ! Je suis bien
capable de vous coller un huissier dans les pattes.
Genoveva ne doutait pas de la perversité de l'usurier, et
cela lui inspira bien plus de craintes que ce que leur promettaient ses
ignobles menaces. L'aplomb avec lequel elle lui parlait jusque là fut
étouffée par la peur, l'espace de quelques minutes ; mais il lui vint
tout à coup une idée, qui lui rendit tout son courage. Elle quitta la
pièce, où João Antunes resta seul ; il calculait les conséquences de
son initiative, et se félicitait d'être aussi fripon. Genoveva revint,
et lui jeta à la tête un rouleau de papier.
– Tenez, espèce de salopard ; voilà deux actions de la
Compagnie ; c'est le salaire de cinquante années de travail au service
de cette maison. Quand la fidalga vous paiera vos cent pièces, vous me
rendrez mes actions ; et, si vous refusez de le faire (vous en êtes
bien capable) qu'autant de démons vous accompagnent tout au fond de
l'enfer que j'ai travaillé de minutes pour gagner cet argent !
– Je suis incapable de garder le bien d'autrui. Vous ne me
connaissez pas.
João Antunes rentrait chez lui fou de joie. Le choc du
rouleau de papier sur sa figure crevassée, il le prit comme l'on prend
la tendre impertinence d'une amante jalouse, qui dépose un baiser à
l'endroit où elle nous a pincé. Radieux dans sa gloire, le pas ferme et
le front haut, comme quelqu'un qui rentre après être venu à bout d'une
périlleuse entreprise, l'intrus dans la sordide rangée des
Kágados se
trouvait près de la Cordoaria, d'où lui parvenait le tumulte d'une
forte effervescence ; il se dirigea de ce côté, en boutonnant
soigneusement ses poches, pour les soustraire aux explorations de l'un
des fidèles vassaux qui vomissaient leurs poumons en beuglant : "Vive
la Sainte Religion ! À mort les Jacobins !"
En effet, les essaims de la populace s'agglutinaient
autour de la Relação, en hurlant comme mille diables. Un tourbillon
d'hommes venait d'arriver à la
Porta
do Olival, les uns en uniforme,
d'autres en guenilles, des enfants, des femmes, la poitrine nue et les
jambes pleines de boue. Une forêt d'épieux, de baïonnettes, d'épées et
de fusils qui se croisaient, se touchaient, se mêlaient dans l'air,
ajoutait au vacarme des voix, l'âpre cliquetis des armes et au tableau
de la canaille effrénée, saoule, terrible et omnipotente, les touches
sanglantes du carnage.
La canaille jouissait donc à présent de son heure de
triomphe, comme à chaque siècle. Le tribun d'un jour était applaudi aux
comices des tavernes. Vous pouvez être surpris de la rudesse de ce
langage. Vous trouverez peut-être malvenus les termes que j'emploie
pour noircir les révoltes populaires, que des politiques de mauvaise
foi trouvent le moyen de justifier en invoquant quelque cause sublime,
et même l'inviolable providence du progrès. Notez quand même que le
peuple sanguinaire qu'évoquent ces lignes et d'autres aussi
méprisantes, n'embrassait pas, mais rejetait l'idée d'une réforme, elle
assassinait ses apôtres ; il ne venait pas sur le théâtre
de la
rébellion échanger sa vie contre une bouffée de cet air de liberté qui
soufflait du côté de la France, tout imprégnée qu'elle fût d'une odeur
de sang ; il venait étrangler, dans la gorge des rares chantres de la
liberté au Portugal, la timide parole de sa rédemption.
João Antunes avait reconnu de loin son voisin, le
batelier, et António da Sousa, le boucher et l'ami de son voisin. Fort
de telles protections, il se hasarda à venir regarder de près ce qui
occupait le centre de cette multitude. En s'approchant, il vit le
cadavre de João da Cunha, attaché par le cou, le visage en bouillie, le
corps en lambeaux, enfin, parce qu'il avait été traîné là depuis le
Padrão das Almas.
João Antunes souffrait des dérangements chroniques de son
intestin. Il posa naturellement la main sur son abdomen insurgé, comme
nous la levons vers notre tête quand elle tourne. Il voulait se
retirer, mais ses jambes vacillantes le trahissaient. Et il ne pouvait
plus reculer. Il suivait les mouvements de la foule qui s'agglutinait
autour de lui. Il se retrouva à la porte de la Relação, et assista, à
son corps défendant, à une scène qui devait lui proposer un rôle digne
d'un autre personnage. L'on va voir comment un infâme peut se
transformer en honnête homme.. L'on verra aussi comment l'avarice étend
le domaine de ses fonctions jusqu'aux endroits où l'on ne trouve plus
aucun reste de nobles sentiments... et, malgré tout, l'aisance est plus
admirable encore avec laquelle les grandes infamies se dissimulent.
À la tête de ces mouvements anarchiques, l'on trouvait
Constantino Gomes de Carvalho, sentinelle à la forteresse de la Foz ;
Francisco José Reteniz, soldat de la légion ; António Corrêa, dit l
e
Maure (le voisin de José Antunes) et António de Sousa, le
boucher. C'étaient là les fervents apôtres de la révolte contre les
jacobins ; ils ont été les responsables de ce mémorable jour du 22 mars
1810 ; jour de honte et d'opprobre pour cette ville qui a laissé percer
de coups, en son sein, par des mains infâmes, quelques-uns de ses plus
honorables enfants, les premiers martyrs d'une idée dont ils ont tiré
si peu de profit !... et qui ont payé si cher leur renommée que
l'Histoire ignore, quarante ans après, leur sacrifice.
(3)
L'usurier suait d'abondance, serré dans les compresses de
la populace, quand, de différents points de la multitude, s'élevèrent
ces cris : "Nous voulons les traîtres emprisonnés ! Mort à Luis de
Oliveira ! Mort à Vicente José Silva !"
Ce plan infâme fut suivi d'effet. Le geôlier ouvrit les
portes presque à reculons. Le premier prisonnier traîné dehors est le
brigadier Luis de Oliveira. Les bourrades qu'il avait essuyées jusqu'à
la porte de la prison furent tellement originales, ou tellement en
harmonie avec les instincts des "fidèles vassaux du trône et de
l'autel" que le pauvre homme était presque nu, tandis que sa veste, sa
culotte et son gilet étaient remplacés par les haillons des vaillants
champions de l'indépendance nationale.
Embrassé à une statue de la Vierge, Luis de Oliveira
demanda à genoux qu'on lui permît de se confesser. Certains émeutiers
étaient d'accord, d'autres non, jusqu'à ce que Constantino Gomes de
Carvalho, pour couper court à toute discussion, et empêcher toute
mésentente malvenue, jugea bon de lui plonger la lame d'une épée dans
le cou. Quelques instants après, le brigadier n'avait plus visage
humain, c'était un ulcère où les germes sordides de la plèbe
rassasiaient leur férocité.
L'on assassina après lui dix ou douze hommes condamnés
pour Haute Trahison. Il se forma une longue ligne de cadavres ; la
canaille victorieuse vomit un tombereau d'imprécations ; c'était comme
un hymne à cet infernal triomphe. L'on offrit par toutes les rues de la
ville ce carnage en spectacle. Puis l'on passa à Vila-Nova, où l'on
jeta, du quai de la Bica, les corps dans le Douro.
João Antunes n'avait pas suivi ce cortège de cannibales.
Je ne saurais dire si sa situation était moins difficile que celle d'un
prisonnier arraché à sa cellule, et mort : il arrivait à peine à
respirer à l'air libre. En voici la raison : étourdi par les rapides
évolutions du massacre, l'usurier oublia qu'il portait dans la poche de
ses épais caleçons de velours un rouleau de papier. Pris dans le filet
dont les attroupements de la foule l'enveloppaient, il avait déjà fort
à faire pour éviter d'être proprement écrabouillé. Il s'était en vain
débattu tout un quart d'heure. Il se sentit à trois reprises
malmené dans la partie la plus sensible de ses chatouilleux intestins.
Il était enfin parvenu à filer par une clairière où Vicente José da
Silva devait être solennellement sabré. C'est alors qu'il avait
songé à palper sa poche... sans trouver son rouleau ! Une sueur froide
suinte entre les humeurs grasses sécrétées sous la pression. Il sent
des nausées, suite à la brusque révolution de ses viscères. Il prend
automatiquement sa tête sphérique dans ses mains convulsées. Il arrache
du fond de lui-même un rugissement semblable à celui d'un singe dont on
écrase la queue. Il pâlit, titube, tombe, je ne dirai pas comme un
sapin sur une montagne, mais comme le grec Lucius métamorphosé en âne
sous le poids de son infortune !
L'on porta José Antunes chez un cordonnier de la Porta do
Olival, on l'aspergea de l'eau croupie d'un baquet où celui-ci laissait
son cuir s'assouplir. On lui infligea de généreuses secousses, à
réveiller un mort, avant de le tenir pour ivre-mort, comme l'on tient
de nos jours un ivrogne pour un colérique, et de l'envoyer au diable,
puisque l'on ne pouvait rien tirer de cette misérable brute.
João Antunes finit par reprendre connaissance, et se
retrouver face à une bonne douzaine de coquins, séparés du gros de
l'armée qui, à cette heure-là, traînait les cadavres dans les rues, une
hécatombe offerte à la Patrie, à la Religion, et au Prince Bien-Aimé,
qui mangeait des bananes au Brésil.
Encore mal réveillé, il promena ses yeux craintifs sur
l'assistance, et commit l'imprudence d'accuser les estimable patriotes
qui l'entouraient de lui avoir volé ses papiers. À peine eut-il
prononcé ces mots, le malheureux fut complètement réveillé ; sous
l'effet de quatre coups de pied homériques qui le remirent d'aplomb. Il
se trouva que le commissaire passait par là avec des ordres pour le
geôlier, en compagnie du Père Domingos de Queiroz, sergent
d'artillerie. Ils reconnurent João Antunes et durent déployer des
trésors de touchante éloquence pour l'arracher aux griffes du peuple.
Le malheureux raconta au prêtre-sergent et au commissaire l'infâme
spoliation dont il avait été victime, lui qui vénérait à ce point la
Religion ! qui était un si fidèle vassal de son Roi ! qui, de notoriété
publique, révérait tellement Notre Dame des Douleurs des Congréganistes.
Larmes et prières inutiles. On lui conseilla de se
résigner pour ne pas perdre le précieux capital de la vie. Mais il
n'avait plus de jambes qui l'amenassent jusqu'à l'endroit où ce crime
abominable avait été perpétré. Il espérait voir son voisin, le batelier
; peut-être arriverait-il, lui, à tirer quelques ficelles pour lui
rendre ses actions de la compagnie, le gage pour ses cent pièces tant
pleurées. Et il attendit.
À deux heures, la plèbe revenait, en exigeant des têtes.
João Antunes vit son voisin de loin ; il courut après lui,
mais le Maure ne lui accorda pas une grande importance, bien qu'à
maintes reprises, il lui eût, en tant que gardien vigilant de sa
maison, soutiré, pour s'acheter du vin, quelques liards, qu'il avait
d'abord serrés dans ses mains d'avare.
– En voilà un autre ! s'exclama le batelier. Je ne vous
l'ai pas dit ?
– Qui ça, António ? dit João Antunes.
– Le Garde des Sceaux, ce Jacobin, cet hérétique ! À mort
le Garde des Sceaux, qui voulait nous faire coffrer à la Relação, pour
avoir tué le Jacobin de la Bandeirinha !
- À mort, à mort le Garde des Sceaux ! répondaient à l'unisson
des centaines de voix rauques, fatiguées, exhalant une atroce
haleine de fond de barrique.
Le Garde des Sceaux, malade, arrivait en effet, dans une
petite chaise à porteurs, pour être supplicié sur l'échafaud bas,
dégoulinant encore du sang des autres victimes abattues. Le magistrat
qui s'était moqué de l'avertissement du Kágado était pratiquement mort
de mort naturelle. Près de la petite chaise, l'on distinguait le Frère
Manuel da Rainha dos Anjos, avec son vénérable visage, et sa touchante
éloquence, qui parlait aux tourbes aussi vite déchaînées que domptées,
dans la stupide conscience de leurs devoirs. Le moine les invitait à
conduire le prisonnier devant le révérendissime évêque-gouverneur, pour
y être plus solennellement condamné à la peine suprême, s'il la
méritait. Le bon prêtre avait eu recours à la ruse, après avoir
constaté l'impuissance de la sacro-sainte parole de son ministère de
paix.
João Antunes avait assisté à la scène. Il eut une de ces
inspirations qui ne viennent que rarement à un homme serré dans les
brodequins de l'infortune ! "C'est le seul moyen de sauver mon argent
!" rugit-il du fond des sombres cavités que le ver de l'avarice avait
creusées dans son âme.
Rapprochant son épaule de celle du batelier, il lui glissa
à l'oreille :
– Dis, António, veux-tu gagner vingt pièces ?
– Si je veux ! Voulez-vous, Monsieur João, que je massacre
quelque âme damnée.
– Non, je veux que tu sauves le Garde-des Sceaux.
– Ce n'est pas possible !
– Si... Et tu touches aujourd'hui même vingt pièces.
– Mais vous voyez bien, Monsieur João, que je ne suis pas
le seul chef de ce peuple ; il y a Constantino, Reteniz, le boucher, et
moi...
– Eh bien, on leur donnera dix pièces à chacun.
– Dix pièces, ça ne fait pas beaucoup.
– Douze.
– Vingt, comme à moi.
– Vingt, c'est beaucoup : quinze.
– Attendez ici, je reviens tout de suite.
Le batelier siffla entre ses doigts ; l'on entendit des
sifflements identiques ; en une seconde, ils étaient tous les quatre en
conférence, un peu à l'écart de la populace, qui semblait ébranlée par
les touchantes représentations du confesseur du Garde des Sceaux.
Pendant ce temps, João Antunes était plongé dans ses calculs... mais le
parlementaire ne lui laissa pas le temps de les achever.
– C'est entendu : soixante cinq pièces en tout, lui dit le
Maure à l'oreille. Notre homme va être remis à l'évêque, qu'ils en
fassent ce qu'ils voudront. Ça vous va ?
– Et vous le lâcherez pour soixante pièces ? Ça fait un
compte rond ! répliqua jovialement l'usurier.
– C'est notre dernier prix, Monsieur João ! Si vous êtes
d'accord, ça marche ; sinon, il est là-bas, et il va faire un plongeon
dans le Douro.
– Eh bien, soit ! Cochon qui s'en dédit ; mais tu ne diras
jamais que je t'ai fait cette proposition.
– Ça va de soi, si vous nous le dites, motus et bouche
cousue ! Vous avez entendu ?
– Oui ; pas un mot là-dessus.
Le batelier fit un signe à l'orateur attitré, le boucher,
et celui-ci hurla :
- Oh, les gars ! On va remettre le jacobin à
l'évêque-gouverneur, qui le condamnera et lui infligera la peine qui
conviendra à la Sainte Religion et au Roi, notre seigneur. Relâchons-le
et partons faire leur fête à quelques hérétiques, qui se trouvent
encore en prison, et puis nous irons à la prison ecclésiastique faire
leur fête à l'autre Garde des Sceaux de la Relação, à l'abbé de
Lobrigos, et au Penteeiro. Exécution ! Personne ne touche à cet homme !
L'un de nos chefs va vous accompagner à la Cour de Monseigneur
l'Évêque. Qu'est devenu le Maure.
– Me voici !
– Accompagne-le, et vive le Prince Régent, notre Seigneur !
– Vive le Prince Régent !
– Et vive la Sainte Religion !
– Vive la Sainte Religion !
– Et vive le peuple de Porto !
– Vive le peuple de Porto !
– À mort les jacobins, les hérétiques, et les fidalgos qui
ne sont pas des compatriotes comme nous !
- À mort !
La foule céda le passage à la petite chaise. Ils était
suivi de près par le moine, l'usurier, et le batelier. João Antunes dit
à l'oreille du moine.
– C'est moi qui l'ai tiré d'affaire.
– Vous avez bien agi. J'ai tout de suite vu que mon
éloquence était trop molle pour y arriver, sans le secours de Dieu.
– Ne dites rien, votre Révérence. Taisons-nous.
Après avoir mis pied à terre, le chef de la justice monta
l'escalier du palais, soutenu par son confesseur et son vieil ami, le
marchand de morue.
– Vous me le disiez bien, Monsieur João Antunes, murmura
le Garde des Sceaux, tout pâle.
– Je vous ai prévenu. Vous vous êtes moqué de moi, et
c'est moi qui vous ai tiré d'affaire.
– Vous ?!
– Oui, Monsieur.
– J'ai cru que c'étaient les exhortations de mon
confesseur.
– Ils n'étaient pas du genre à l'écouter... La meilleure
des exhortations, c'est l'argent.
– Vous avez bien fait... Nous en parlerons là-haut... Qui
est cet homme qui reste à côté de la chaise ? Il me semble que c'est
l'un de ceux qui m'ont arrêté.
– Absolument ! C'est avec lui que j'ai passé un contrat
sur votre vie.
– Et cet homme vient récupérer son argent.
– Si vous l'avez sous la main... Sinon, c'est moi qui le
lui donnerai.
– Ce ne sera pas nécessaire... L'évêque doit avoir de
l'argent... Il en faut beaucoup ?
– Deux cents pièces ; il y a quatre chefs ; cinquante pour
chacun.
– J'aurais donné beaucoup plus pour ne pas passer par de
telles émotions ; je donnerais tout pour la vie ; j'ai envers l'homme
qui m'a sauvé des obligations dont on ne s'acquitte pas avec de
l'argent. Vous êtes un homme d'honneur.
Dom António de São José de Castro vint accueillir, les
bras grands ouverts, le chef de la justice.
– Je viens me faire juger par vous, Votre Excellence, dit
le magistrat.
– Vous êtes condamné à être mon hôte, dit l'évêque en
souriant.
Peu après, João Antunes fut appelé à l'intérieur du
Palais, reçut deux cents pièces et une chaleureuse embrassade, pleine
de reconnaissance.
L'usurier flottait littéralement dans les airs, en dépit
du poids dont il était chargé. Il y gagnait cent trente-cinq pièces de
commission. On lui avait volé six cent mille réis, la valeur des
actions de la Compagnie, il se retrouva avec deux cent soixante-quatre
mille réis en plus
(4), en dédommagement des
coups de
pied qu'on lui avait
administrés. Il n'avait jamais fait une aussi bonne affaire.
Le batelier reçut les soixante-cinq pièces convenues, et
courut les distribuer, mais pas si vite qu'il n'entrât à la Porta dos
Carros boire une chopine de Alto-Douro, tandis que João Antunes
entrait, comme chaque jour, chez les Congréganistes, pour prier sa
révérée Notre Dame des Douleurs. La prière terminée, il entra dans une
auberge casser la croûte, et se trouva à deux doigts d'avoir sa
digestion troublée par deux coups de poing, suite à des mots avec
l'aubergiste qu'il accusait de l'avoir refait sur une demi-chopine.
Monsieur João avait de magnifiques turpitudes.
Puis il courut chez lui saluer le sarcophage renfermant
son argent. C'est là que se trouvaient sa vie, son sang, dont il
rétablit la circulation, en y injectant plus de trente pièces qu'il
ajouta aux autres.
Quatre jours après les scènes glorieuses que j'ai décrites
d'après des documents sans malice, l'armée française bivouaquait sur
l'Agra de São Mamede, à une demi-lieue de Porto. On engage les
premières escarmouches, au cours desquelles la garnison de la ville se
fait toujours, pour ainsi dire, proprement étriller par un ennemi bien
entraîné. Mais c'est un plaisir rare de savourer en connaisseur
l'hilarante description des événements, un manuscrit inestimable en son
genre, un étrange composé de mensonges dans un style abominable, né des
élucubrations d'un prêtre désœuvré, qui m'est tombé entre les mains
grâce à un illustre antiquaire.
À l'en croire, c'était un bonheur de voir fuir vingt mille
français commandés par Soult, Loison, Delaborde, Quesnel, et tant
d'autres qui ont vu les pyramides et frappé d'épouvante une Europe
ébranlée par le bras de fer de Bonaparte. Ce sont ces hommes qui
fuyaient devant une garnison de six mille loqueteux, de trois cents
moines qui conduisaient l'artillerie composée d'une demi-douzaine
d'obusiers, lesquels servaient de lest à des navires marchands, et se
trouvaient entassés à cet effet dans les magasins de Miragaia. Ce bon
historien, n'arrivant pas à concilier le succès de cette soudaine
invasion avec de tels traits de patriotisme chez les défenseurs, se
retourne vers la Providence, et dit que le Seigneur avait voulu nous
cingler du fouet de sa colère, représentée par le maréchal Soult.
Serait-ce le cas ?
Sans doute. Le 26, cependant, pour échapper à la colère du
Seigneur qu'il respectait fort, après Notre Dame des Douleurs des
Congréganistes, João Antunes voulut passer à Vila Nova de Gaia, et
prendre le vent à partir de là. Il était absolument convaincu que son
argent, enterré à trois empans sous l'écorce terrestre, appartenait dès
lors aux mondes souterrains, et que ce n'est qu'en creusant un trou aux
antipodes, que l'on pourrait mettre la main dessus. Le marchand de
morue à la retraite ne connaissait heureusement rien aux antipodes.
Le pire, ce fut qu'on ne lui permit pas de passer sur
l'autre berge. La plèbe despotique avait obstrué le passage, empêchant
tout accès aux barques, et vociférait contre la lâcheté de ceux qui
fuyaient des Français qui n'entreraient jamais à Porto. D'autres,
moins heureux que João Antunes, qui fuyaient le sac, furent attaqués
par les gardes, des "patriotes". Nous devons pieusement nous en tenir à
la version du religieux historien : "...d'autres furent au passage
délestés d'une partie de leurs objets de valeur (par les sentinelles)
sous prétexte qu'il fallait absolument vérifier ce qu'ils emportaient."
Ah les braves gens ! Il y a des
patriotes
comme ça.
Soult avait eu pitié de cette poignée d'imbéciles qui
l'asticotaient avec leurs batteries hors d'usage. Il envoya un
parlementaire à Porto, proposer une paix salutaire. Le parlementaire
fut dépouillé de ses décorations, et sabré. Une légitime rancœur eut
raison des misérables défenses. Les Français entrèrent, comme ils
auraient pu entrer quelques jours avant. Les "vaillants" défenseurs
réservèrent leurs derniers élans d'héroïsme à leur fuite, et cette
réserve s'avéra pour eux fort utile. Ils fuyaient intrépidement. Le
prêtre dit cependant qu'il fut, à ce qu'il semble, l'un des derniers à
fuir, qu'il s'accomplit là des prouesses inouïes. "Il est juste,
raconte-t-il, de montrer à la postérité l'inépuisable valeur et
l'exceptionnelle intrépidité dont a fait suffisamment preuve, dans la
14e Batterie – São Pedro au Lindo Vale – le père Domingo de Queiros,
naturel de cette ville, et sergent de la compagnie des artilleurs
ecclésiastiques, qui a fait feu sur l'ennemi, avec la plus grande
précision, lui a infligé de notables dommages, et ne perdit rien de sa
valeur et de son intrépidité jusqu'à l'entrée de l'ennemi, mit le feu
aux poudres, ce qui entraîna beaucoup de victimes, et se retrouva
complètement brûlé." Il est bien dommage que l'illustre Père Domingos
Queiroz, sergent d'artillerie, ait été brûlé, du coup. Une excellente
personne ! Un Mucius Scaevola en soutane, qui s'est brûlé spontanément,
entraînant dans la mort nous ne savons combien de prêtres qui étaient
ses camarades ! Comme tu as été outragé, martyr du Golgotha, par ceux
qui renouvellent l'huile de la lampe de son temple, il y a dix-neuf
siècles!...
(5)
Essayer de décrire João Antunes quand on lui a dit que les
Français étaient entrés par la Prelada, c'est absurde. Il perdit la
tête. Il allait d'un coin à l'autre du petit sous-sol de sa maison, les
ongles fichés sur son crâne hérissé. La rue des Arménios, déserte il y
a peu, était envahie par les gens qui fuyaient du Cidral, du Monte dos
Judeus, et des rues adjacentes.
– Au pont ! Au pont ! – C'était le cri de tous. Antunes eut un
moment de lucidité : fuir avec les autres. Son argent restait hors de
la portée des pillards ; en dehors de l'argent, ses vieux draps et
trois chaises disloquées ne lui donnaient pas d'angoisse excessive.
Restait un registre gardant une trace écrite de ses transactions : il
le prit sous son inévitable capote, et se glissa dans le torrent des
fuyards. Le flot grossissait de plus en plus. C'était un vacarme
infernal et dissonant d'exclamations entremêlées. Les enfants criaient
après leurs mères qui les oubliaient. Des vieillards levaient les mains
vers leurs enfants en les suppliant de ne pas les abandonner. De douces
dames piaillaient chaque fois qu'on écrasait leurs chaussures de soie.
Des femmes en guenilles jouaient du poing pour se frayer un chemin à
chaque pas qui les rapprochait de leur supposé salut. Moines et nonnes,
soldats et catins confondus, pêle-mêle, priant, sacrant, se mettant
sous la protection de la Vierge, et invoquant la toute-puissance de
Satan.
Et dans ce vortex, qui tourbillonnait en passant par la
Porta Nobre, João Antunes se débattait, le cœur au bord des lèvres,
tout retourné, hors d'haleine, les vêtements déchirés, tantôt furieux,
tantôt contrit, faisant des vœux coûteux à Notre Dame des Douleurs, et
se repentant de son imprudente prodigalité ; grinçant des dents sous la
pression de la foule, et tentant de donner un coup de pied en traître à
un gamin qui l'empêchait de passer ; serrant sur son cœur son registre
avec la trace écrite de ses transactions, et levant frénétiquement le
col de sa capote rebelle, que les secousses faisaient glisser de son
dos éreinté...
Ce flux torrentiel avait atteint le pont. Tout le monde
sait comment l'on se retrouva avec trois mille cadavres. Négligence ou
trahison, les trappes étaient ouvertes. La multitude s'entassa dans les
barques ; sous le poids, les antennes se brisèrent à grand fracas ; les
gorges de l'abîme engloutirent des masses compactes, un
débordement de centaines de corps, des familles réunies dans une
dernière étreinte.
Si, dans ce magma de cris, l'on put distinguer un
inimitable rugissement, c'est João Antunes da Mota qui l'a poussé.
Un grand coquin était mort, mais l'espèce ne s'est pas
éteinte.
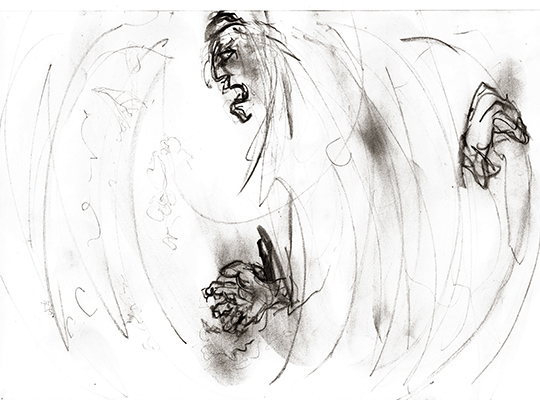
***
I
Les romans font du tort à bien des gens. Des personnes ont
tendance à
s'inspirer de modèles qu'ils admirent et envient dans les fictions, se
perdent en les contrefaisant, et s'offrent en pâture au ridicule. L'on
dispose, ces derniers temps, de bien des exemples de cette vérité,
d'autant plus sensibles que notre société est trop petite pour qu'on
puisse nous les cacher, et trop intolérante pour les admettre sans en
rire. Des hommes sans aucune originalité, ou originalement fous,
singent tout ce qui se distingue du commun. Crédules jusqu'à
l'absurdité, ils acceptent comme réels et légitimes les fruits
excentriques de têtes excentriques, et se permettent de donner le ton à
une société mesquine, où n'apparaissent ni le Zaffie de
La Salamandre,
le Tremor de
Leila, le
Brûlart de
Atar-Gull, le
Vautrin du
Père Goriot,
le Leicester de
Luxe et Misère,
en un mot l'homme fatal. Ces imitateurs
sont extrêmement dangereux, ou grotesques. Ne trouvant pas dans la vie
ordinaire la place qui leur revient, ils veulent s'en emparer de vive
force. Puis, de deux choses l'une : ou ils atteignent les sommets de la
perversité, foulent au pied l'honneur, crachent au visage de la
société, et se piquent de tomber dans le même abîme que leurs victimes
; ou – ce qui se produit presque toujours – ils se prennent pour des
hommes exceptionnels, rêvent comme Obermann, s'emportent comme Hamlet,
se gaussent de la vertu comme Byron, lancent des malédictions comme
Faust, et accusent toujours un monde ignoble qui ne les comprend
pas. présentation d'un personnage.
Je veux vous donner une idée de Guilherme do Amaral. Vous
allez faire la connaissance d'une victime des romans.
Ce garçon de vingt ans et quelques vient de la Beira Alta.
Il est né, et il a vécu jusqu'à dix-huit ans dans le village de ses
parents. À quinze ans, il est allé à Coïmbra faire les études
préparatoires sans lesquelles on ne peut suivre une formation dans
quelque université. Revenu au moment des vacances, il a vu mourir sa
mère, et, comme il n'avait plus de père, il s'est trouvé émancipé à
dix-huit ans. Sa maison lui rapporte douze mille cruzados. Guilherme do
Amaral se considère libre et riche.
Sa principale passion, ce n'était pas la chasse, ni la
pêche, ni les chevaux : c'étaient les romans. Il acheta des centaines
de volumes français, lut jour et nuit, apprit des pages par cœur, qui
électrisèrent une âme déjà combustible, s'attacha aux caractères
inspirant une immense terreur, comme dit J. Janin, trouva mièvres les
amours éthérées de Roméo, de Pétrarque, de Bernardin, d'Antony, de
Rastignac...
Imprégné de ces incandescentes leçons, il regarda autour
de lui, et se trouva seul. Il voulait le monde, il voulait de l'air,
assouvir sa faim de fulgurantes impressions.
Il résolut de quitter son hameau pittoresque, et il
écrivit, sur la tombe de sa mère, un romantique adieu dans un style
apocalyptique qu'elle n'aurait pas compris, si elle l'avait entendu. Il
s'en fut à Lisbonne. Il présenta de flatteuses lettres de
recommandation, et reçut un excellent accueil. Son entrée dans les
salons impressionne les plus fins observateurs, et il n'est pas
indifférent aux femmes. Nous sommes en 1843.
La nature a doté Guilherme do Amaral de quelques attraits,
qui ne démentent pas le moule dans lequel il donne intérieurement une
forme à sa tortueuse vocation. Il est pâle, il a de grands yeux noirs
et ardents, qui ne trahissent pas une pénétrante curiosité ou une
mordante lucidité ; ils expriment on ne sait quelle tendre mélancolie,
une sorte de douloureuse introspection, une plus profonde vision de ce
qui se passe en lui, que des vaines frivolités qui l'entourent.
Au bal, il marche presque toujours de long en large, en
fumant, dans la salle déserte où l'on fume. Il répond, le plus
laconiquement possible, aux obligeantes questions de ceux qui
l'appellent leur ami, qu'il connaît à peine, ou qu'il fait semblant de
connaître à peine. Quand il pénètre dans la salle où tourbillonnent les
valses, il s'appuie au battant de la porte, éteint son regard, penche
la tête sur son épaule, fronce un front comme rongé par l'ennui,
consulte sa montre qui indique minuit, bâille comme s'il n'en pouvait
plus, et regagne sa chambre. Il y ouvre un roman, et lit jusqu'à quatre
heures du matin.
Il vit toute une année ainsi. Il n'a pas d'ami intime ; il
n'a pas de femme qui l'aime ; il n'en voit même pas une, parmi tant,
dont le tempérament singulier pourrait s'accorder à son caractère.
L'une de ces connaissances lui demanda un jour :
– Quel âge avez-vous, Monsieur Guilherme ?
– Vingt-et-un ans.
– Depuis combien d'années vivez-vous en société ?
– Ma société n'est pas de ce monde.
– Si c'était le pontife qui s'exprimait ainsi, les
affaires de l'Église iraient mieux... Vous êtes las...
– Oui.
– Vous avez dû avoir une vie orageuse, souffrir de
terribles naufrages dans la mer des aspirations...
– Je me sens mort ; mais je ne sais pas quand j'ai vécu.
– Quelque existence antérieure. Il y a des hommes qui ont
une vague réminiscence d'une vie antérieure.
– C'est possible ?
– Je ne fais pas de mon opinion un système ; mais, à vous
voir, à vingt-et-un ans, séparé du grand corps de la société, je crois
toutes les merveilles de la métempsycose.
Ramé, en 1840, croyait être
le
Ramus de 1540. Le pire,
c'est qu'il est mort fou. Dites-moi :
Aimez-vous ?
– Je ne puis aimer ; je pose la main sur mon cœur, et je
la retire gelée.
– Vous vous en tenez donc à une image chimérique, qui vous
soustrait aux amours plus ou moins sensuelles de ce monde ?
– Je rêve d'une image. Je ne la rencontrerai pas sur la
face de la terre.
– Quelle idée vous faites-vous des femmes de notre globe ?
– Elle est fort mauvaise : rien que mensonges, appétits
grossiers, vénalité, corruption.
– L'avez-vous constaté par vous-même ?
– Non, je n'y tiens pas. Toutes les désillusions
préexistent en moi. L'on devine de loin le crotale au bruit qu'il fait
en rampant.
– Ce monde doit vous sembler bien infâme. Quel jugement
portez-vous sur les hommes ?
– Celui de Vautrin, le personnage stoïque de Balzac.
– Vautrin est un méchant modèle ; si je m'en souviens
bien, c'est un forçat sorti du bagne.
– Qu'importe ; le malheur l'avait révélé ; il avait la
science des larmes ; il est devenu philosophe, un philosophe plus
crédible que Rousseau, dans les longues veilles de son infortune.
– Voulez-vous le prendre pour maître ?
– Je suis absolument original ; je n'étudie personne.
– Avez-vous aimé ?
– Jamais ; je pense avoir déjà répondu à cette question.
– Vous n'aviez pas encore répondu. À votre place, je me
retirerais dans la Thébaïde de mon village. La vie à Lisbonne doit vous
inspirer une intolérable indignation.
– Je ne vois pas cette vie provocante. Jusqu'à
aujourd'hui, le regard de mon esprit ne s'est pas baissé. L'aigle, pour
l'instant, plane au milieu des nuages. Quand je descendrai, je
laisserai une trace de sang...
L'interlocuteur de Guilherme do Amaral sourit. Le
lendemain, dans les cafés, sur les places et dans les salons, ce
dialogue était répété dans ses moindres détails, soulevant des éclats
de rire. Le provincial, sur le pas de la sarcastique mordacité de cette
connaissance, devint la proie du ridicule, de la "raillerie" comme
disaient les femmes,
qui ne s'y
prêtaient point d'elles-mêmes.
Un
littérateur le traita de
Vautrin en
caleçons, un autre d'
Arthur
des
Puces, un autre de
Byron
mariné, un autre de
Zaffie en
sabots, un autre
de
Leicester empaillé. On
épuisa tous les pseudonymes grotesques ; on
tourna en dérision la funèbre gravité du provincial, l'immolant aux
moqueries des femmes, comme à un supplice mérité pour avoir osé les
outrager.
Sans le nommer, un feuilleton écrit par un certain
Maxime
de Trailles (voir Balzac) qui se distinguait alors dans le
registre du
persiflage et des sarcasmes, avant de devenir une sorte de
Comte
Talorme de Mery (voir
Amour
et Rome) et exercer maintenant les
fonctions diplomatiques de son collègue... ce feuilleton donc, ciselé
de telle sorte qu'il ne dissimulait pas le moindre trait de Guilherme,
fit au provincial une plaisante publicité, dont il ne profitait pas
encore, sauf dans un petit cercle. Pour enfoncer le clou, on lui remit
un journal sous un pli fermé, en lui conseillant de quitter Lisbonne
pour revenir "dans sa patrie" cultiver les choux et les patates. Les
quolibets, les mots et les injures lui paraissaient tellement
cuisantes, elles blessaient tellement sa vanité, qu'Amaral, trop gamin
pour secouer cette banderille, la sentit au plus profond de son cœur,
en conçut de la honte, se concentra sur la conscience de l'importance
qu'on lui accordait, et se repentit d'avoir si textuellement parodié
les monstrueux modèles de ses romans.
Le jeune homme accablé était pourtant fort loin du cynisme
indispensable pour faire face aux insolences du feuilletoniste, qui se
trouvait être précisément l'homme qui lui avait soutiré, au cours d'une
conversation, ses extravagantes théories.
Les quelques jours que Guilherme passa encore à Lisbonne,
il resta enfermé dans la chambre de son hôtel. Personne ne vint le voir
ces jours-là. Mais, la veille de son départ, en allant faire ses adieux
aux personnes qui l'avaient présenté, il en rencontra une qui lui tint
ce langage :
– Vous faites bien de quitter Lisbonne. Cela n'a rien à
voir avec ce que vous avez imaginé. Les excentricités sont bien vues,
ici, mais il faut que l'excentrique ne remue pas le couteau dans les
plaies de ces gens. Vous avez dit à monsieur ***, votre ami ou une
connaissance, que les femmes n'étaient que mensonge, vénalité et
corruption. Peut-être aviez-vous raison, mais ce n'est pas une chose à
dire à n'importe qui. L'excentrique peut se saouler tous les jours,
personne ne le tourne en ridicule pour ça ; à la rigueur, on le plaint.
Il peut être querelleur, hanter la nuit les corps de garde, personne
n'en fait des gorges chaudes. Il peut escroquer, séduire calomnier qui
il voudra... il ne sera pas chassé pour cela par le mari de la femme
qu'il a calomniée ; ce qu'il ne peut se permettre, par contre, c'est de
fixer à travers ses lorgnons, avec un souverain mépris, les femmes des
salons, et de dire : "Tout cela me lève le cœur." Vous êtes célèbre ;
vous êtes peut-être un sceptique, plus qu'il n'est convenable ;
soyez-le autant que vous voudrez, mais ne le dites pas aux hommes,
dites-le aux femmes qui, loin d'en être froissées, se bercent de
l'espoir de vous séduire, en vous galvanisant à grand renfort de
sourires voluptueux. Vous êtes fatigué ? Couchez-vous, dormez, n'allez
pas dans le monde, administrez-vous les toniques ordinaires de la
solitude, qui fortifient l'esprit et font renaître les désirs assouvis.
Les salons ne sont pas bons pour tous. Mais si votre lassitude est une
fiction, je vous conseille en ami d'y renoncer. Vivez comme tout le
monde. Mangez, buvez, dormez, agacez, séduisez, calomniez, défendez les
femmes calomniées par d'autres, battez-vous avec les maris de vos
comtesses de Restaud, jouez votre maison, dédommagez-vous de vos pertes
en faisant comme votre censeur, qui a signé d'un pseudonyme le
feuilleton où il vous caricature joyeusement. Voulez-vous devenir
célèbre dans les salons ? Pas d'insultes, et pas de récriminations
contre les femmes. Un profond silence avec les hommes ; mais, avec
elles, une languissante éloquence, l'élégiaque regret d'un ange dont
vous avez rêvé à quinze ans, de sorte qu'une fois cette vision bien
affinée, l'ange finira par être la femme à qui vous parlez, puis une
autre, jusqu'à la maîtresse de maison, eût-elle cinquante ans. Sans
témoins, en tête à tête, on peut dire à une femme tout ce qui porte
atteinte à son amour-propre : elle souffre, se tait et l'endure ; mais,
avec un homme, c'est très sérieux. Cela prouve que l'honneur ne dépend
pas de la conscience, il dépend de l'opinion publique ; nous nous
sentons déshonorés lorsque les autres disent que nous l'avons été.
Dites à l'oreille d'une femme : "Vous n'êtes que mensonge, vénalité,
corruption." elle éclatera de rire, si elle est parfaitement délurée ;
et, si elle ne l'est pas, elle se tait par timidité, et le devient ;
pas une seule critique en présence des hommes. Si cela vous convient de
dire que vos illusions sont mortes d'une apoplexie foudroyante,
dites-le sans prendre un ton sentencieux, sans la grivoise pédanterie
de certains sots qui donnent des leçons de scepticisme, affalés
sur l'épaule nue de femmes perdues. Je ne sais que vous dire de plus.
Pas de singeries. Lisez, mais n'imitez pas ; et, si vous voulez vous
écarter de la nature, inventez quelque nouveauté qui ne contredise pas
les caprices de l'opinion en vogue. Si la mode est au scepticisme,
soyez sceptique, mais donnez des preuves que vous croyez à la façon de
Saint Thomas, au moins pour ce qui touche... Soyez heureux, mon ami.
S'il n'y a rien à espérer de mes conseils,
stulta est gloria... Tant
pis pour vous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quarante-huit heures après, Guilherme do Amaral, avec sa
mémoire prodigieuse, répétait, dans la chambre d'un hôtel à Porto, les
leçons de son précepteur.
II
Cette graine ne fut pas semée sur un sol ingrat.
Comme tous les hommes sans originalité, à peine conscients
de leur propre personnalité, sans cette réelle expérience des choses,
qui individualise la nature de chacun, Guilherme do Amaral accepta les
théories du gentilhomme de Lisbonne, les jugeant bonnes pour son propre
usage, sans qu'elles sortent cependant de la sphère de l'ordinaire.
Ce qui rebutait le provincial, c'était la vie banale, le
trivial encroûtement des vocations vulgaires, la fade déperdition des
allégresses sottes, et des aspirations mesquines où la jeunesse
consumait les forces de son esprit, entre le plaisir de se mettre une
veste élégante, et la joie de voir sa bien-aimée le soir à sa fenêtre.
Vivre selon les principes développés à Lisbonne par son compatissant
ami, ça lui convenait, ça flattait son nouveau caractère, ça lui
épargnait les railleries dont l'avaient abreuvé d'inexorables
critiques, qui, à mon avis, ne le valaient pas, et devaient une large
indemnisation en ridicule si Amaral leur réclamait la monnaie de sa
pièce.
Guilherme ne connaissait personne à Porto ; mais, à la
table ronde de l'
Águia d’Oiro,
il rencontra des garçons de sa province
qu'il avait connus à la foire de Viseu, qui s'étaient fait des
relations à Porto, et se montraient prêts à le présenter à
l'aristocratie, à la médiocratie et au gratin des bistrots. Guilherme
ne dit pas non.
Le baron de Carvalhosa donnait ces jours-là un bal. Un
gentilhomme de Viseu demanda une carte d'invitation pour son ami, un
provincial riche, valant au moins trois cent mille cruzados,
célibataire, fort sérieux, un excellent parti pour une jeune fille. Le
baron s'empressa de lui donner une invitation, et s'en fut répéter à la
baronne ce qu'on lui avait dit. Outrepassant les règles de l'étiquette,
il alla déposer une carte chez Guilherme do Amaral. Le soir du bal, il
accueillit le provincial avec force démonstrations, le présenta à sa
femme et à ses deux filles, et l'invita au dîner d'anniversaire de sa
fille Margarida, le dimanche qui suivait le bal. Tout cela semblait un
bon début à Guilherme. La franchise de la société de Porto lui plaisait
; mais il se préparait à ne pas démentir la mélancolie de son nouveau
système dans les joyeuses libations d'un festin.
Une heure après l'entrée d'Amaral au bal du baron de
Carvalhosa, toutes les femmes savaient que le provincial était
célibataire, riche, et fort sérieux.
– On dit qu'il est riche, murmurait à l'oreille de son
amie une intéressante jeune fille aux yeux languides, au teint blafard,
et au sourire mélancolique.
– Je l'ai entendu dire, répondit sa cousine.
– Tu l'as entendu !? Et il est vraiment riche ?
– Je pense que oui ; mon oncle, le conseiller, m'a parlé
de trois cent mille cruzados.
– Vraiment ?! Et il ne fait la cour à personne ?
– Je pense que non, du moins à Porto, dit Margarida, qui
était sûre que non.
– Tu vas voir qu'elle...
– A attiré son attention ? C'est vrai, à mon avis.
– Mais n'y a-t-il pas trois ans qu'elle se fait courtiser
par Henrique de Almeida ?
– Et alors ? C'est un passe-temps.
– J'ai cru que c'était une affaire sérieuse. Henrique de
Almeida est un garçon de talent, et qui présente bien...
– Et qui... ?
– Il n'a pas trois cent mille cruzados, mais...
– Mais... tu as tout dit. Pourquoi ne te fais-tu pas
courtiser par des garçons de talent, il y en a tant, qui sont
disponibles ? J'en connais deux ou trois qui te font des vers, et te
dépeignent de telle sorte que qui ne te connaîtrait pas penserait que
tu n'es pas un être de ce monde, et que tu te rends à des bals mondains
après avoir fui la cour céleste.
– Je te reconnais bien là, Francisquinha !... Mais je sais
bien où tu veux en venir...
– Ce n'est pas difficile ! Le fait est que ta pâleur
romantique, tes yeux de vierge de la saudade, ton sourire de
résignation douloureuse ont trompé beaucoup de monde ; mais, en fin de
compte, tu es comme moi, comme ma cousine, comme tu dois être... Vois
comme il te regarde...
– Qui, il ?
– Ce fameux
croquant.
– Ah, je trouve qu'il n'a rien d'un croquant.
– Vraiment ? Tant mieux...
– Il est assez bien mis...
– Mais il n'est pas frisé, et ne porte pas de cravate
blanche.
– C'est de bon ton. Cette négligence lui va si bien...
Moi, j'aime ça ! Il me regarde ?...
– Il n'arrête pas !
– Oh, Francisquinha, je vais me lever pour dire quelque
chose à ma tante, et tu vas regarder s'il me suit des yeux.
– Je n'y manquerai pas.
Elle resta quelques secondes avec sa tante, en mâchonnant
quelque bagatelle.
– Alors ? demanda-t-elle de l'endroit où elle était, avec
ses yeux.
– Oui, répondit la vigilante cousine d'un geste affirmatif.
Elles se rapprochèrent.
– Passons maintenant dans l'autre salle, et nous verrons
s'il me suit.
Elles y allèrent ; mais Guilherme do Amaral resta figé
dans l'attitude sombre où elles le laissèrent, adossé au chambranle
d'une fenêtre.
– Il ne vient pas, fit la jeune fille pâle, blessée dans
sa vanité. Appelle ton frère. Il est là-bas.
Le dit frère s'approcha.
– Connaissez-vous, mon cousin, un garçon venu de province,
qui s'appelle Guilherme do Amaral ?
– Il m'a été présenté. Voulez-vous que je vous le
présente, cousine ?
– Non... Il a l'air triste.
– Il l'est ; mais fort agréable, et il dit très bien le
peu qu'il dit. On peut l'écouter. Voulez-vous que je vous le présente ?
– Non, cousin... J'ai entendu dire que Margaridinha...
– Qu'il la courtise ? C'est une calomnie. Ce garçon est
arrivé il y a cinq jours de Lisbonne, et n'a pas eu le temps de
récupérer son cœur dans ses valises.
– Amusant ! Que dit-il des dames de Porto ?!
– La vérité : qu'elles sont belles, élégantes,
spirituelles...
– Avec qui a-t-il parlé ?
– Je n'en sais rien ; mais s'il vous parle, cousine, il
confirmera l'idée qu'il se fait à juste titre des dames de Porto.
Voulez-vous que je vous le présente.
– Non ! C'est une obsession ! Vous croyez que je meurs
d'envie de lui parler ?! ... Savez-vous s'il reste à Porto ?
– Non, aimable cousine ; il restera sûrement si vos yeux
l'y retiennent.
– Joli ! Et sucré à point. Dites-moi : il ne danse pas ?!
– Je n'en sais rien, cousine.
– Je ne l'ai pas encore vu danser.... Demandez-le lui.
– Voulez-vous être sa cavalière, petite cousine ?
– Moi ? Quelle scie ! Croyez-vous que je me meurs d'amour
pour lui ?
– Je n'irai pas jusque là... Mais avouez que vous le
trouvez sympathique...
– Je ne le trouve pas antipathique... Il ne me fait ni
chaud, ni froid... Tiens, il arrive.
– Je vous le présente ?
– Zut !
En passant près de ce jeune homme qui connaissait sa
cousine à fond, Guilherme do Amaral lui fit un sourire ironiquement
cérémonieux, avec une légère inclination de la tête pour ces dames.
– Monsieur Amaral, dit-il, permettez-moi de vous présenter
ma cousine et ma sœur.
– C'est un honneur qui me flatte. On dirait qu'un étranger
vous inspire assez de pitié pour que le mettiez en relation avec des
personnes aussi dignes d'estime.
– C'est que je ne suis pas égoïste : je veux que tout le
monde, et spécialement les gens qui sont à même d'apprécier vos
mérites, goûtent le plaisir de votre compagnie. Je considère, ma
cousine, que c'est le cas pour vous ; ma sœur... vous êtes ma sœur, et
toute apologie, venant de ma bouche, serait saugrenue.
– Oh, mon cousin !
– Oh, mon frère !
Murmurèrent-elles, toutes les deux, avec un déhanchement
répondant aux règles d'une galanterie fort désuète.
– Je crois qu'il vous a rendu parfaitement justice,
Mesdames, dit Guilherme, en lissant le gant de sa main gauche.
L'orchestre avait annoncé une polka. Dona Francisca fut
enlevée à ce petit groupe par son cavalier. La cousine ne s'était pas
engagée.
– Je n'ai aucun cavalier, dit-elle. N'allez-vous pas
danser ?
– Non, Madame ; moi, je ne danse pas.
– Non ! Vous n'aimez pas ça !
Le cousin qui l'avait présentée s'était éclipsée.
Guilherme offrit son bras à la languide Cecília, la conduisit à un
sofa, et s'assit sur la chaise la plus proche. En face de ce sofa,
était venue s'asseoir la fille du baron avec deux amies. En agitant de
plus en plus vite son éventail, Margarida tournait ses beaux yeux vers
Cecília, et lançait, avec une laborieuse malice, un trait qui les
faisait rire. Cecília fit semblant de ne pas comprendre, elle les
regardait vaguement, de temps en temps, prenant apparemment plus de
plaisir aux frémissements étudiés de l'éventail qu'à la conversation du
gentilhomme.
– À ce que je vois, un bal représente pour vous une vraie
corvée, répondait-elle aux raisons qu'il avait invoquées pour ne pas
danser.
– Les bals ne représentent pas une corvée pour moi,
Madame, je m'y plais ; mais, chez moi, l'organe de ce plaisir est un
sixième sens, tout spirituel, céleste. Je n'ai pas besoin de me
fatiguer, ni de serrer contre mon cœur les fleurs qui s'épanouissent
sur les cheveux d'un ange, pour en humer le parfum. L'haleine d'un
homme est une profanation. De loin, l'on ressent plus vivement les
sensations, et l'esprit reste en possession de lui-même, plus dégagé
pour les savourer.
– En ressentez-vous beaucoup ?
– Beaucoup.
– En songeant au passé, au présent, à quelque espoir ?
– Mon passé est une pérégrination à travers les ténèbres,
je cherchais une lumière.
– L'avez-vous trouvée ?
– Non. Je me suis assis, fatigué, au bord de ce chemin
ardu, et j'ai attendu. Le présent est une angoisse de l'infini, une
soif d'amour, la funeste prière d'un homme qui demande au ciel la rosée
qui fait reverdir une fleur calcinée.
– Et le ciel ne vous écoute pas ?
– Il est sourd ; les anges n'intercèdent plus pour les
hommes.
– Et l'espoir ?
– C'est une tombe que je distingue au fond de mon abîme !
– Une idée si mélancolique ! N'ayez pas de ces pensées !
Vous serez largement dédommagé de vos souffrances... Je vois que vous
avez beaucoup de poésie, mais une bien triste poésie au sein de votre
cœur...
– C'est la poésie de la mort, une guirlande de fleurs qui
accompagne mon suaire, la fleur sans éclat éclose sur ma sépulture...
Je vous rends triste, Madame ?
– Très triste ! Je commence à m'intéresser à vos
sentiments, à les partager. Même si je voulais rester étrangère à vos
douleurs, je ne le pourrais pas.
– Je vous remercie, comme on remercie une goutte d'eau
dans le désert, de votre pitié. Avez-vous souffert ?
– Moi !...
– Votre pâleur m'évoque la nuance dans les coloris que
laissent les larmes sur un visage qui ne s'est pas encore réchauffé au
soleil du printemps des amours.
– Vous avez vu mon âme, Monsieur Amaral.
– Vous avez aimé ?
– Je n'ai pas aimé, si l'amour n'est possible que sur
cette terre. Croyez-vous aux visions ? J'en ai eu une, je me suis
dévorée dans de mensongères espérances, en la cherchant... Je ne l'ai
pas retrouvée dans des formes humaines.
– Nous nous sommes donc rencontrés au bord du même abîme.
– C'est ce que j'allais vous dire.
– Nous n'avons pas notre place dans ce festin servi par le
hasard ou la Providence. Nous sommes des âmes exilées de l'union des
corps, nous errerons de sphère en sphère, le cœur ouvert, prêts à
recueillir la moitié de l'existence que nous n'avons pas eue ici.
– Est-il certain que nous ne l'aurons jamais ? !...
– Impossible.
– Ne dites pas cela... Ne veuillez pas être le bourreau
d'un espoir qui me parle en mon cœur, comme le délicieux écho de vos
paroles.
– C'est un espoir qui ment.
– Laissez-moi rêver d'une aventure que j'ai crue
impossible jusqu'à maintenant...
– C'est un rêve avec des fleurs qui, à notre réveil, se
transforment en épines bien réelles.
– Laissez-moi penser qu'il y a au monde un être qui puisse
vous tirer de cet abattement.
– Autant invoquer un mort sur lequel pèse une dalle moins
lourde que l'oubli.
Le gentilhomme de Lisbonne était capable d'enfoncer dans
une embrassade enthousiaste deux côtes dans la poitrine de son
disciple, s'il avait pu assister à ce dialogue, que vous n'avez
certainement pas compris, cher lecteur, mieux que moi, ni qu'eux-mêmes.
Pendant ce temps, Margarida, visiblement dépitée, disait à
ses amies :
– Qu'est-ce que cette timbrée peut bien lui dire ?
– Naturellement, les mots d'un air qu'elle connaît, et
qu'elle est la seule à comprendre.
– Ô, Mesdemoiselles ! répondit la fille du baron,
n'avez-vous pas remarqué qu'il a l'air de dormir, lui ? Et regardez
cette façon qu'il a de s'appuyer sur elle ! On dirait qu'il va se
coucher sur son épaule !
– Ce sont là des attitudes romantiques.
– Je les trouve indécentes ! Et elle !... une vraie cruche
! Comme elle penche sa tête attendrie... Elle croit qu'on adore ces
singeries!... Elle en a fait autant avec une demi-douzaine de
soupirants que je lui ai connus. Sa lubie à elle, c'est que personne ne
comprend son cœur. Trois jours avant un bal, elle ne mange rien, boit
du vinaigre pour prendre un ton blême et donner à ses yeux cette
hébétude de lapin mort. L'on voit de ces choses ! Elle n'a rien à elle
et elle s'est imaginée qu'elle dénicherait un mari jeune et riche avec
ces simagrées répétées devant un miroir. Comme elle ne trouve que des
poètes pauvres pour lui faire la cour, et qu'ils ne lui vont pas, elle
se rabat sur les Brésiliens, et leur tient de ces discours embrouillés
dont elle a le secret, à des hommes qui viennent demander à son père si
elle a une légitime. Elle croit, cette idiote, que le péquenaud se
meurt pour elle ! Quand il saura ce qu'il en est, il pleurera le temps
qu'il a perdu avec elle...
– Tu es jalouse, Margaridinha...
– Moi ! De quoi ? Comme si j'en avais quelque chose à
faire. Mais je n'arrive pas à supporter de voir cet insipide bas-bleu
toujours prêt à se jeter à la tête de tous les hommes qui sont riches.
C'est une honte pour notre sexe ; vous ne trouvez pas ?
– Tu as raison, ma fille ; si j'étais toi, je lui ôterais
ses illusions.
– Ah, si j'avais quelqu'un qui le lui dise ! Mais je ne
voudrais en aucun cas que qui que ce soit soupçonnât que cela vient de
moi.
– Veux-tu que Mesquita le lui dise ? Je les ai déjà
vus ensemble, et il n'y a rien de plus facile... ils se peut qu'ils se
parlent encore aujourd'hui... Le voilà, justement.
Cette amie serviable demanda à un convive d'appeler le
fameux Mesquita, son soupirant officiel. L'obligeant émissaire
s'éloigna, flatté de cette commission.
Cecília s'était éloignée au bras de sa cousine à qui elle
disait : "Cet homme est un ange : j'ai rencontré mon rêve sur cette
terre ; il me fait perdre la tête, je l'aime à la folie,
frénétiquement."
Mesquita s'assit à côté de Guilherme qui était resté
apparemment absorbé dans une de ces extases acquises à force d'imiter
ses modèles.
– L'on dirait que vous êtes triste, Monsieur Amaral.
– Un peu. Chez moi, c'est un sentiment ordinaire.
– Vous qui venez de Lisbonne où toutes les dames sont
physiquement et moralement intéressantes , vous devez trouver nos bals
bien fastidieux...
– Au contraire. Je viens d'entendre une dame qui a une
façon divine de s'exprimer.
– Dona Cecília Pedrosa ?
– Je pense ; je ne connais pas encore son nom, mais ce
doit être elle, parce que les indications que je vous donne ne
peuvent s'appliquer à beaucoup, sans vouloir sous-estimer les autres.
C'est celle qui se trouve là-bas avec une robe écarlate.
– C'est bien elle. Elle est fort spirituelle ; dommage
qu'elle soit si volage.
– Volage ? Que signifie ce mot pour vous, mon cher
Monsieur ?
– C'est une femme qui a eu trente soupirants. Ce qu'elle
dit à tous, c'est la même page d'un roman qu'elle a appris par cœur ;
aujourd'hui, elle se laisse courtiser par un poète qui l'a appelée
Sapho, demain, ce sera un idiot qui est passé deux fois à cheval devant
sa porte ; puis un délégué, qui deviendra peut-être juge ; puis un
Brésilien avec cinquante contos, et cetera, et cetera, et elle dit à
tous qu'elle n'a pas été comprise jusqu'au moment où elle les a
rencontrés. Tous, à l'exception du poète, qui s'accroche à ses
sentiments, filent du mieux qu'ils peuvent, et elle attend toujours le
dernier qui aura de l'argent, pour être comprise. C'est une folle
excentrique.
Guilherme sourit, et invita son informateur à passer dans
le fumoir. Celui-ci attendait quelque indiscrétion du provincial à
propos de Cecília, mais Amaral, échaudé, ne pipa mot.
Un journaliste entrait, justement le poète aux petits
soins pour Cecília. Mesquita voulait, avec dextérité, venir à bout de
sa délicate mission. Pour confirmer le jugement qu'il avait donné sur
Cecília, il présenta le journaliste à Guilherme, et lui demanda.
– Tu courtises toujours Cecília ?
– Je la courtiserai toute ma vie.
– Mais comme un Othello toujours malheureux, toujours
trahi.
– Qu'est ce que cela peut me faire ?! Tu ne comprends pas
comment j'aime cette femme.
– À la folie.
– Comment ça, à la folie ! C'est un filon littéraire.
– Je ne comprends pas ; et vous y comprenez quelque chose,
Monsieur Amaral.
– Non, Monsieur.
– Je vais vous expliquer. Mon amour pour cette femme
connaît quatre saisons par an, et chaque saison comprend trois mois. Je
l'aime en janvier, en février et en mars. Toutes les semaines, je lui
écris une poésie palpitant de tendresse. Au bout de trois mois, ça fait
douze poésies. Avril, mai et juin sont ensuite réservées à la jalousie
; j'écris douze poésies furieuses, affreusement tristes, et aussi
incisives que le grondement du chacal auquel on a enlevé sa femelle. En
juillet, août et septembre, j'écris douze poésies pleines de
scepticisme, dans un style hybride, destructeur, lancinant, caustique,
enfin, une kyrielle d'insultes contre les femmes. En octobre, en
novembre et en décembre, j'écris douze poésies, où j'exprime mon
découragement, dans un style plaintif, tout empreint d'une vaillante
faiblesse, un
memento à faire
pleurer les femmes de nos tailleurs, un
adieu de Chatterton à la vie, une malédiction de Gilbert contre la
société, une chose horrible que j'écris toujours après le dîner, comme
le cauchemar d'une digestion laborieuse. À la fin d'une année de
quarante-huit semaines, je dispose de quarante-huit poésies, que je
vends à un éditeur, pour au moins cinquante pièces. Me comprenez-vous à
présent ?
Mesquita se tenait les côtes, Guilherme répondit par un
sourire méprisant et presque imperceptible, que le journaliste
accueillit comme il accueillait les méprisants dédains de Cecília. Et
il poursuivit, en tournant, pour se venger, le dos au "péquenaud ignare
et grossier" comme il comptait bientôt le traiter dans un ensemble de
quatrains cocasses, dignes de Tolentino.
– Dis-moi à présent, Mesquita, si cette femme n'est pas
une perle ! continua le journaliste. Alors que les poètes, faute
d'inspiration, se taisent comme les cigales en septembre, je chante
toute l'année, et j'en suis au troisième volume publié de mon existence
tourmentée. Crois bien que, sans Cecília, je ne faisais pas un vers, et
que Cecília, sans moi, je te l'assure, n'aurait pas droit à un quatrain
sérieux, ni à un immortalité à si bon compte. C'est ainsi que l'on aime
: tout ce qui n'est pas cela, vous rend inférieur à ce siècle...
Plaudite cives !
Nous avons des sandwichs et du vin du
dix-huitième siècle. Ne parlons plus des femmes ;
cedant arma !
Et il cala son lorgnon à l'orbite de son œil droit pour
mesurer la profondeur du plateau, et consulter l'étiquette des
bouteilles.
III
Margarida attendait Mesquita avec impatience. Les
informations obtenues
ne calmèrent pas sa capricieuse curiosité. Il dit que Guillerme n'avait
pas tari d'éloges sur l'intelligence de Cecília. Il mentionna, comme un
service, l'épisode du journaliste qui n'avait pas produit les fruits
qu'il en attendait. Selon lui, Amaral aimait Cecília, fasciné qu'il
était par la verbosité de ce bas-bleu, scandaleusement empruntée aux
romans. Margarida haletait, dissimulant derrière son éventail une
rougeur qui ne convenait pas mal à son teint blanc et pâle. Elle se
leva, poussée par l'énergie que donne une décision irréfléchie, et se
fondit dans les groupes, appuyée au bras de son obligeante amie. En
passant d'un salon à une coiffeuse, elles virent, dans un autre, moins
fréquenté, Guillerme do Amaral et Cecília, se tenant par le bras, et
avec dans leur discussion un air de mystérieuse intelligence, comme
s'ils pouvaient, sans faire scandale, la veille de leurs fiançailles,
après une cour de trois ans, se promener ainsi ensemble, tout seuls,
comme des intimes.
Chauffée à blanc par un tel aiguillon, Margarida oublia
d'écarter de son pied impétueux les premiers plis de sa robe évasée, et
les serra de telle sorte qu'ils s'accrochèrent à la pointe de son
soulier de satin blanc. Cela finit de la mettre hors d'elle. Ses lèvres
nacrées lâchèrent, sous l'effet de la colère, une exclamation d'une
telle indécence que personne n'eût osé l'attendre d'elle mise à part
son inséparable amie, qui ne s'étonnait de rien, et n'avait pas besoin
de se faire expliquer des expressions équivoques.
Des dames se trouvaient dans la coiffeuse, qui se
rajustaient mutuellement leur tenue. L'une, dont une spirale de cheveux
frisés au fer s'était affaissée dans les soubresauts d'une polka,
sentait les larmes lui monter aux yeux, parce qu'une mèche rebelle ne
cédait pas aux laborieux efforts des doigts pour reconstituer les
boucles. L'autre serrait la manche pendante de sa robe de dentelle,
complètement affolée, elle voulait quitter le bal. Une autre encore
fâchée contre une épaulette parce que le décolleté de son corsage de
baptiste ne respectait pas la ligne artistique de ses épaules, vouait
Guichard aux gémonies. Il ne manquait plus que Margarida, avec sa part
d'amertume.
Ce n'était pas cependant le pli déchiré de sa robe qui
faisait tressauter son cœur contre les baleines de son corset. Elle
voulait s'isoler avec son amie. Elles passèrent donc dans la pièce
voisine où les bonnes, accroupies dans l'ombre, profitaient du
spectacle, et riaient méchamment des malheurs de ces dames en déroute.
Elle leur intima l'ordre de sortir, et soulagea son cœur
comprimé, en exhalant des angéliques doléances.
– Cette sainte-nitouche me fait monter la moutarde au nez
! Elle va m'entendre, ou je ne suis plus celle que je suis... Je vais
faire en sorte qu'elle ne remette plus les pieds chez moi... Puis-je
compter sur toi ?
– En voilà une question... Que veux-tu ? Une lettre
anonyme ?
– Pas pour l'instant ; ce que je veux, c'est que tu dises
à Cecília que j'ai besoin de lui parler en particulier.
– Maintenant ?!
– Oui ; pourquoi pas maintenant ?
– Et où ?
– Là-bas dans cette petite salle. Qu'attends-tu ?
– J'y vais. Encore faut-il qu'elle n'ait promis à personne
la contredanse qui va commencer.
– Vite.
Cristina trouva Cecília dans la plus sentimentale des
attitudes, en train de murmurer quelque chose qu'Amaral écoutait en
passant, légèrement contrarié, ses mains sur les longues mèches de sa
chevelure.
Cecília écouta ce que l'on avait à lui dire à mi voix,
s'inclina gracieusement, donna au provincial un excuse superflue, et
entra dans le
lavabo où elle
se retrouva seule avec Margarida.
– J'ai besoin que nous entendions bien, Cecília, dit la
fille du baron, en croisant les jambes, une mauvaise habitude acquise
au contact de sa mère, qui n'avait jamais pu oublier le bon temps où
elle était tisserande.
– Que nous nous entendions bien ?! Ça me fait rire,
l'air impérieux et solennel que tu prends pour me donner des ordres !
– Pas de grands mots ; parle comme tout le monde ; je ne
lis pas de romans, et je ne les apprends pas par cœur.
– Tant pis pour toi, ma chère, tu n'as aucun goût, ni
aucune mémoire. Eh bien dis-moi sans prendre la mouche, quel mystère il
y a entre nous, pour que nous nous entendions mieux que nous nous
sommes entendues jusqu'ici ?
– Je veux te parler de cet individu que tu n'as pas lâché
de toute la soirée.
–
Que je n'ai pas lâché
! Je trouve cette phrase bien osée
! Je ne jette le grappin sur personne, ma chère.
– Trêve de plaisanterie. Il faut que tu saches que cet
homme n'est pas venu chez nous pour te donner un
rendez-vous.
– Loin de moi l'idée que votre maison serve à donner des
rendez-vous à qui
que ce soit. Ce serait vraiment la rabaisser !...
Veux-tu dire, Margarida, que ce particulier est ton soupirant ?
– Je ne sais s'il l'est ou non.
– Veux-tu donc que je le lui demande ? Cela va de soi.
C'est à cela que servent les amies en de telles occasions.
– Tu te paies ma tête ?
– Je ne me moque pas de toi. C'est juste que j'ignore où
tu veux en venir.
– Celui qui veut entendre, comprend à demi-mot. Tu ne
manques pas d'anciens soupirants. Il y en a des douzaines dans ces
salons. Tu n'as pas besoin de partir à la pêche aux hommes avec tes
pleurnicheries romantiques.
–
À la pêche aux hommes
! C'est trop d'honneur de faire de
moi une Cléopâtre, dont on dit qu'elle pêchait des empereurs romains.
– Voilà que tu ramènes ta science, une science qui ne te
vaut rien. Tu crois que les hommes se meurent d'amour pour toi en
t'écoutant, et ils sont les premiers à rire.
– Patience, ma chère ! Que vais-je lui faire ?
Heureusement que ton ignorance les fait pleurer de consternation...
– Crois-tu que Guilherme fait grand cas de ta personne ?
Il n'y a pas longtemps, il se moquait de toi au fumoir, avec les autres
hommes.
– C'est bien ma chance ! Je suis ridicule à ses yeux ?
– Oui. Que crains-tu alors en l'occurrence, Margarida ? On
est jaloux de qui possède plus de mérites que soi. Pourrai-je, moi,
pauvre femme dont cet homme se gausse, concevoir la stupide vanité de
te le prendre ?... Tu ne me comprends pas ? Je vais m'expliquer
autrement...
– Ce n'est pas nécessaire, je ne suis pas aussi ignorante
que tu veux bien le prétendre. Ce que je te dis, c'est de perdre tout
espoir...
– De quoi ? De faire sa conquête ?
– Oui.
– Je l'ai perdu, ma chérie ; mais, puisque tu piques mon
amour-propre, je vais quand même voir à quel point je suis la victime
des moqueries de Guilherme...
– Veux-tu dire que tu lui fais les yeux doux ? répliqua
l'inconséquente calomniatrice, en frappant son genou avec un éventail.
– Je veux dire que je m'offre volontairement au sacrifice.
Il me semble que notre Pâris est mélancolique. Je sympathise avec lui,
je lui veux du bien, et si je puis lui donner une occasion de rire,
j'arrive à l'arracher à sa tristesse, et je lui rends un grand service,
tu ne trouves pas ?
– Je trouve que tu es complètement folle, voilà ce que je
sais.
– Tu as raison ; je suis complètement folle de t'écouter.
Bonne nuit, Margarida.
– Tu vas écouter deux mots de plus.
– Juste deux ? Bien. Mais ne froisse pas les poignets de
ma robe. L'on ne s'accroche pas de cette façon, comme des femmes à la
porte de la rue...
Margarida rougit, elle avait compris la blessante allusion
à sa mère.
– Je te promets que cette aventure qui a commencé chez moi
se terminera chez moi.
– Et quoi encore ?
– Il trouvera beaucoup de gens qui lui diront ce que tu as
été.
– Et qu'est-ce que j'ai été Margarida ?
– Une fille légère, une tête folle.
– Merci beaucoup. C'est tout ?
– Sur ce, bonne nuit.
– C'est ça, bonne nuit, mais cela ne te fera pas perdre
beaucoup de temps d'écouter deux mots, toi aussi. J'avais à te
demander, mon cher dragon de vertu, quand je dois te remettre un paquet
de lettres, une mèche de cheveux, un porte-cigares en porcelaine et un
anneau d'or que certain noble de province a donné à mon frère, pour que
je te les rende. Pas besoin de t'affoler, ma chère, ce sont là des
faiblesses que nous nous pardonnons mutuellement ; tu as eu tes accès
de légèreté et de folie, mais cela ne diminue en rien tes mérites. Les
objets que j'ai entre les mains, ce sont des choses qui compromettent
une jeune fille si elle n'a pas elle-même de quoi acheter un
porte-cigares avec une jolie représentation de
Suzanne au Bain, et un
anneau avec un brillant qui vaut quelques pièces ; mais, après tout,
des choses qui se passent entre les femmes ne transpirent pas, nous
nous protégeons, car nous sommes si faibles... Veux-tu tout cela pour
demain ?
– Tu penses me faire peur avec tous ces discours ? Cela ne
me fait ni chaud ni froid.
– Ça, je le savais, Margarida ; tu ne prends pas
facilement peur, et tu n'as pas les qualités de Phèdre.
– De qui ?
– C'était une femme qui disait qu'elle n'était pas de
celles qui, gardant un pudique sang-froid dans le crime, savent garder
un visage qui ne rougit jamais.
– C'est une insulte ?
– Non, ma chère. Pourquoi élèves-tu la voix de la sorte ?
– Je peux élever la voix parce que je suis chez moi.
– Et je ne suis pas tenue, moi, de t'écouter...
– Mais tu es tenue de montrer un peu de pudeur.
– J'en ai, et qui me gêne plus que toi.
– Que moi ?
– Attention ! Nous nous rabaissons au niveau des
poissardes... Bonne nuit.
La plus grande partie de ce dialogue n'avait pas seulement
été entendue par les bonnes qui se tenaient à côté de la petite pièce,
mais par un groupe de femmes qui s'étaient arrêtées, perplexes, en
entrant.
Cecília appela son père, qui jouait au boston, et sortit
au bras d'un monsieur qu'on avait chargé de faire les honneurs du bal.
En passant devant Guilherme, qui fumait dans le vestibule,
elle s'arrêta, quitta son compagnon, et lui dit à mi-voix :
- Si vous vous êtes moqué de moi, vous avez eu tort, je ne
méritais pas vos railleries ; si l'on vous calomnie, je ne vous demande
pas de vous justifier, parce que le temps vous justifiera. Bonne nuit.
Amaral, stupéfait, resta muet ; puis il sortit.
Au bout d'un quart d'heure, tous les hommes et toutes les
femmes étaient au courant de l'accrochage entre ces deux dames à propos
du "mélancolique péquenaud".
Le journaliste prenait des notes pour une satire qui fit
les délices de la médisance, et fut à deux doigts de le chasser des
bals du baron. Celui-ci, mis au fait de cet "indécent déballage",
l'expression qu'il employait, classiquement, pour qualifier cet
incident, envoya au diable les bals et les femmes. Margarida se sentit
mal, et se retira dans sa chambre à trois heures du matin. À cinq
heures, enfin, d'après les journaux, tous les hôtes se retirèrent
satisfaits des attentions des maîtres de maison. C'était un mensonge
éhonté. Cecília n'avait aucune raison d'être satisfaite des dites
attentions.
Le fait est que le "mélancolique péquenaud" reçut cette
nuit-là son diplôme de lion. Les vieilles femmes, elles mêmes, dirent
qu'elles voulaient faire sa connaissance ; mais il était trop tard, en
ce qui les concernait, elles, et si l'on tient compte du mouvement de
la planète.
IV
Ces deux derniers chapitres, qui sont derrière nous, pour
votre plus
grand plaisir, cher lecteur, et encore plus pour le vôtre, chère
lectrice, sont des excroissances de ce roman ; l'on aurait fort bien pu
s'en passer, si je n'avais pas voulu raconter le misérable processus
qui a abouti à la magnifique et tonitruante renommée de Guilherme do
Amaral.
Comme les choses se présentaient ici pour lui différemment
qu'à Lisbonne ! Même en se traînant à ses pieds, l'exilé chassé de la
capitale par les quolibets, ne paiera sa dette à cet homme bon qui lui
a suggéré de se conduire autrement dans la vie.
Si vous voulez savoir les conséquences de la querelle
entre Margarida et Cecília, lisez les quatre pages suivantes. Si
vous n'y tenez pas, sautez-les, et vous trouverez plus loin des
descriptions enlevées, des traits de génie, des choses enfin que vous
ne sauriez jamais si je ne vous les disais pas, bande d'ingrats.
En rendant sa visite au frère de Cecília, Guilherme demanda une
explication pour la situation embarrassante où elle l'avait mis. Cette
demoiselle avisée se donna des airs de martyre, en racontant, avec
d'attendrissante larmes, une partie de son entretien avec sa prétendue
rivale. Guilherme, qui était un peu au courant du scandale, tomba des
nues, il ne trouvait pas la pomme de discorde. Cette mélodramatique
fiction ne plut pas à Cecília. Elle le voulait plus explicite, ou au
moins entendre de lui une phrase honnêtement romantique, qui ressemblât
à une déclaration. Amaral ne se décidait à lâcher ni l'une, ni l'autre.
Cecília prit sur elle de poser une question directe :
– Laquelle de nous vous est indifférente, Monsieur Amaral ?
– Aucune, Madame.
– Nous aimez-vous toutes deux ?
– Aucune ... J'ai pour vous deux le même respect ; mais je
ne puis, comme Prométhée, voler au ciel le feu qui allume un cœur sans
vie, solitaire et aussi ténébreux que la nuit éternelle du tombeau.
– Ce langage...
– N'est pas nouveau pour vous, Mademoiselle. Je me suis
déjà défini. Notre infortune nous a réunis, mais nous ne pourrons nous
lier par le bonheur. Qu'il s'offre une occasion, bien malgré moi, ce
sera le langage persuasif que j'emploierai avec Dona Margarida, avec
toutes les dames qui auront la stérile pitié de toucher le linceul d'un
cadavre. Je suis le symbole du désespoir sur la terre. La Jéricho,
promise au proscrit expulsé d'Israël, n'avait pas souri à mes yeux
avides. Je mourrai, comme Jersey, en appelant la femme fantastique de
mes douloureuses visions.
Quelle hardiesse dans le style ! Quel ciseau de maître
dans les arabesques de ce tas de guenilles ! Quelle précision dans le
tour où l'on façonne ce style dentelé !
Et Cecília aimait beaucoup cela. Ce fut ce qui la décida.
Si jusque là, ses passions étaient du badinage, ou des artifices de ses
ingénieuses spéculations, l'affaire devenait sérieuse. Certaines femmes
se laissent vaincre par la gentillesse, d'autres par la bravoure,
d'autres par le talent, d'autres par l'argent, d'autres par la sottise.
Cecília se laissa vaincre par le style.
Repoussée courtoisement de jour en jour, elle voyait
s'aggraver sa pâleur naturelle, elle devenait plus triste, elle
dépérissait, s'isolait, consultait les étoiles, écoutait en soupirant,
le murmure monotone d'une proche fontaine, et lisait de préférence
Antony, Jocelin, Raphael
et
Amaury. Elle inquiéta sa
famille, et
absorba du lait de jument avec des eaux d'
Entre-ambos-os-Rios. Après
trois mois de ce traitement parfaitement indiqué, et de bains de mer,
elle se rétablit, du moins pour ce qui est du corps. Mais l'âme,
suivant ce que disent les idéalistes, est un être bien plus délicat
dans ses infirmités.
L'âme de Cecília entama une prospère convalescence, dès
qu'un gentilhomme de Porto, rentré chez lui après un long voyage, se
déclara fatigué de la vie, ennuyé de la société, et fort capable de
s'administrer un tonique à l'acide prussique. Grâce au style où l'on
disait ces choses, l'illustre malade se rendit compte que c'était lui,
l'homme de ses rêves, et elle finit par rêver dans ses bras, mais
honnêtement, parce que toute femme, et n'importe laquelle peut rêver
dans les bras de son mari.
J'ai le plaisir de vous annoncer qu'ils furent heureux
l'espace d'une éternité de huit jours. Ils ne se comprennent pas à
présent, et continuent tous les deux de rêver, chacun chez soi, des
songes charmants, qui se réalisent tous les jours, moins effrayants que
ceux de Macbeth...
Passons à Dona Margarida. Elle se livra à toutes les
singeries imaginables pour se faire entendre d'Amaral, à son dîner
d'anniversaire. Mais le provincial eut le front de la dévisager avec
l'indifférence la plus stoïque, pour deux raisons frivoles : la
première, c'est qu'elle avait les épaules larges, qu'elle était
rustaude, qu'elle avait les traits épais, qu'elle était menacée par
l'obésité, et mangeait beaucoup ; la deuxième c'est qu'elle était
ingénument stupide.
Ce n'était pas du miel pour la bouche des Amaral. Il ne fut pas
capable de comprendre cette femme, et il n'y eut, après lui, personne
qui la divinisât comme elle le méritait. Quoi qu'il en soit, Margarida
eut assez d'esprit pour ne point concevoir de passion. Ses amies
l'en dissuadèrent, et il semble qu'un équipage, et un abonnement à une
loge du théâtre lyrique, l'aidèrent fort à évacuer une hydropisie
d'amour qui avait, l'espace de vingt-quatre heures, menacé sa précieuse
existence. Dona Margarida est encore célibataire, elle confirme les
craintes prophétiques de Guilherme, elle a engraissé, elle est devenue
rougeaude, et n'a rien à envier aux bras proverbiaux de Júlia Grisi. On
la voit au théâtre manger des bonbons, rire à gorge déployée, suspendue
à l'accoudoir de sa loge, comme sa mère naguère à son métier,
s'obstiner, avec une belle constance, à dire beaucoup de sottises sur
quelque chose. C'est, à trente ans, une dame vraiment heureuse.
Commençons à présent par le commencement. Un homme d'une
intelligence moyenne, après d'aussi brillants débuts que Guilherme do
Amaral, n'allait pas cracher sur deux aventures flatteuses qui
l'arracheraient à son obscurité.
Quoi qu'il en ait, cet homme faisait une bêtise qui
pouvait lui coûter cher. Cecília et Margarida étaient des femmes qui
faisaient une réputation, mais elles n'avaient rien qui pût servir
l'immoralité d'un conquérant. Épouser n'importe laquelle des deux, ce
n'était pas une gloire pour le provincial. Les séduire comme qui séduit
une femme du peuple, c'était gravement se compromettre, un déshonneur
qui lui vaudrait la haine, une vengeance, et l'obligerait au moins à
fuir, en laissant une trace d'infamie.
Amaral était un modèle de bon sens, depuis qu'il avait
détaché le masque que les Lisboètes avaient accueilli par des huées.
Ce n'étaient pas ces femmes-là qui lui convenaient. Le
prestige qu'elles donnaient, il en profita sans se déshonorer. Il
devint connu, célèbre, se distingua du vulgaire ; c'était ce qu'il
voulait. Il s'était placé à un barreau de l'échelle d'où il devait
descendre. Il descendit, sans courir le risque de se casser une jambe.
Il trouva de quoi nourrir une âme d'Épicure, tout en se réservant pour
la chimère l'âme de Platon. Il se conduisit de telle sorte que personne
ne lui demanda de comptes, parce que ceux qui devaient les régler
s'étaient libérés de leurs dettes bien des années avant... C'est
pourquoi, s'il était en délicatesse avec Dieu, il n'en était pas de
même avec les hommes et les femmes. Il était apprécié, pieusement
consolé de ses tristesses, imité (rien que sous son aspect moral) par
beaucoup, et admis auprès des dames qui savent ce qu'elles disent et
font, relativement assurées qu'il n'en abusait pas dans le monde. Ce
qui est vrai.
Il vécut ainsi un an, sans meurtrir le moindre oignon de
la morale publique, une respectable matrone, qui respecte fort peu de
gens et n'a jamais eu l'occasion de trouver une imperfection chez son
benjamin.
Et il s'écoula de la sorte une année, tout doucement.
Guilherme s'ennuya, et envisagea un voyage. Il s'ennuya,
parce que les fèces du plaisir, c'est la satiété, et que le véritable
plaisir, il ne l'avait pas connu. Il lui était facile de jouir d'un
plaisir ; mais la jouissance d'un jour c'est la veille du dégoût ;
c'est la gourmandise pour le miel, qui vient de l'estomac blasé
jusqu'au palais, pour donner une haleine acide. Il ne trouva pas, parmi
tant de femmes, une amie ; et qui n'a pas connu une femme qui fût son
amie, s'il pose la main sur son cœur, n'y rencontre pas la fleur qu'on
arrose de larmes de joie ou de tristesse partagée.
Aimer, c'est un sentiment profané par ce mot très commun.
Amaral n'avait aimé personne. Fort de son habile imposture, il vainquit
de faibles résistances ; les femmes vaincues tombaient cependant comme
les nymphes de Camoëns de l'Ile des Amours : elles se laissent
attrapper par les lévriers.
(6)
Si, une fois abandonnées elles se donnaient des airs de
dames endolories, c'était de la jalousie, une pudeur tardive, ou le
dégoût, dont elles étaient saisies plus que lui, ou la règle qui veut
que personne ne s'accommode du sort qui lui a été assigné là haut. Il
n'a jamais vu ce que sont les larmes d'une femme abandonnée, quand en
se traînant le plus à ses pieds elle s'humilie devant le caprice d'un
homme, qui prend pour fuir son élan en écrasant du pied le cœur de
celle qui reste, n'a plus qu'à ravaler sa honte, et mourir dans cette
lutte inégale. Ce qu'il a vu, c'est ce par quoi il aurait dû terminer
sa carrière d'homme résolu à tirer, selon les circonstances, un
avantage décisif des désirs nobles, un autre de son imposture, et un
dernier de son cynisme. Il avait commencé à cueillir des fleurs des
Marais Pontins ; il en sortit infecté.
Le sang qui parvenait d'un cœur noble à se poumons viciés
par la pourriture, s'était corrompu. Son cœur sentit une secousse,
quand il se vit dépourvu des sensations intimes qui vont graver une
action noble, une image sainte, une glorieuse date dans la conscience.
Son humeur s'assombrit. Ce qui n'était avant qu'un artifice, c'est
maintenant sa nature altérée qui le lui donnait.
C'est pour cela qu'Amaral décida de voyager quelques
années.
V
C'était un soir, celui du 28 juin 1845, la veille du jour
où l'on fête
Saint Pierre, l'apôtre miraculeux.
Vous savez comment, dans notre fort pieuse Cité de Porto,
l'on fête tous les saints de la cour céleste, et notamment Saint
Antoine, Saint Jean et Saint Pierre. Ce dernier, le plus précieux de
tous pour son importante mission de concierge de la béatitude, se
glorifie d'être fêté chaque année dans la Cité de la Vierge par une
fabuleuse pétarade, un indescriptible enfer de feux de joie, et une
surnaturelle consommation de pipes de vin rouge, d'andouilles
frites, de darnes de colin, et de beuveries dont le nombre
atteint un chiffre jamais imaginé par Bézout.
(7)
São Pedro de Miragaia, est incontestablement le plus chéri des
Saint Pierre. Cette spacieuse grève ne parvient pas à contenir les
flots humains qui affluent des rues qui la dominent. Comme par
magie, surgissent des files de lampes bariolées ; de mâts de paille et
de goudron, qui brûlent et puent ; des orchestres militaires, qui
passent la moitié du temps à faire retentir leurs trompettes
stridentes, et l'autre en d'homériques libations, libéralement offertes
par les intendants ; les échoppes reconnaissantes à la gastronomie
immonde des reliefs qui s'y entassent, lancent des vivats au saint,
vomissent des obscénités et des insolences contre la tavernière qui
tarde à servir ses demi-canons par tête ; finalement, la grève de
Miragaia est un mélange de tous les privilèges qui enthousiasment le
peuple, en lui donnant l'occasion de faire surgir sur ces visages, tous
les traits d'une stupide allégresse.
En suivant le pâté de maisons qui s'étend le long de la
plage, vous verrez cette nuit-là des têtes supportables, que les
reflets à moitié fantastiques de ces éclairages vous font paraître
belles. Vous en verrez d'autres, réellement belles, qui se placent de
sorte que les jets de lumière faibles les mettent en valeur, dans cette
exposition nocturne, en les éclairant aux yeux de l'amateur patient qui
se promène en-dessous en savourant par ses pieds l'humidité du sable.
Parmi eux, cette-nuit-là précisément, vous auriez pu
voir Guilherme do Amaral, seul, les yeux plongés, plus loin, dans les
ténèbres du Douro, absorbé, recueilli dans les antres de cette
tristesse qu'un homme raisonnablement sensible emporte partout avec
lui. Comment ce sage censeur de ces grossières réjouissances
avait échoué à Miragaia, je ne saurais vous le dire. Il se trouvait là,
sans savoir ce qu'il était venu chercher, et regrettait de ne pas avoir
les ailes d'un chérubin ou d'un hippogriffe pour se transporter dans
les déserts de Lybie, ou au moins dans sa chambre de l'
Águia d’Oiro.
En caressant ce rêve dont l'impossibilité l'accablait, il
prit la première rue obscure et vide qui se présenta. Il traversa une
ruelle d'un aspect inquiétant, si dégoûtante qu'on hésitait à s'y
engager : il déboucha dans une rue qui le mena à une autre, dans la
direction opposée à celle de l'
Águia
d’Oiro, où il voulait se rendre.
Il se sentit bien, malgré la répugnante puanteur qui
suintait des fentes des portes. Il ne voyait personne, personne ne le
voyait, pas le moindre murmure : c'était comme si l'on marchait dans
les fouilles d'une rue de Pompéi, pour la vue, et dans le conduit où se
déversent les déchets d'une ville, pour l'odeur. Le romanesque a de ces
sordides caprices. Amaral n'aurait pas échangé cette atmosphère fétide
pour les parfums de nard et de rose de la coiffeuse de l'une de ses
innombrables admiratrices.
Il s'arrêta au bout de cette rue, retenu par les cris de
quelqu'un qui pleurait non loin de lui. Il s'approcha d'une porte, et
constata que ces gémissements venaient d'une maison sans étage. Il
distingua ces mots :
– Ô ma mère, ma mère chérie !
Il s'appuya au battant de la porte. Il entendait toujours
les mêmes cris, auxquels ne répondait aucun autre.
Il frappa trois fois à la porte avec le bout de sa badine.
On lui ouvrit tout de suite ; mais la personne qui lui avait ouvert la
porte recula, surprise, faisant mine de la lui refermer au nez.
– N'ayez pas peur, Mademoiselle, dit courtoisement
Guilherme, en retenant la porte avec sa main.
– J'ai cru que c'était mon cousin... répliqua la jeune
fille en tremblant.
– J'ai entendu crier et j'ai pensé que je pouvais être
utile à une personne qui pleurait à ce point.
– C'était moi...
– Qu'avez-vous donc, Mademoiselle ?
– C'est ma mère qui vient de mourir subitement !
– Vraiment ? Ce peut être une attaque d'apoplexie... Si
vous le permettez, je vais entrer pour l'examiner.
– Entrez, s'il vous plaît. Que Dieu, notre Seigneur vous
entende... Si vous pouviez être médecin...
– Je ne suis pas médecin ; mais si elle est vivante je
ferai tout ce que je pourrai pour qu'elle ne meure pas sans les
derniers secours.
Amaral avait traversé une surface carrée de plus ou moins
vingt empans, séparée d'une autre par une natte pour envelopper des
fardeaux, en guise de paravent. C'est à l'intérieur que, sur un lit en
bois de cerisier, avec une literie correcte, et une couverture de coton
écarlate, gisait, le visage vers le bas, et le corps incliné vers le
plancher, une femme. Guilherme examina le pouls et la tête ; la
retourna, redressant son visage, la souleva, et la trouva raide, glacée
et rigide.
– Alors, Monsieur ? cria la fille, en levant les mains.
– Elle est morte ; je suis désolé de la mort d'une mère
qui mérite des larmes si sincères de sa fille. Dites-vous,
Mademoiselle, que les douleurs de notre cœur ne se soulagent pas en
criant ; les larmes suffisent. Ce qui importe à présent, c'est de
s'occuper de l'enterrement de votre mère. Maintenant, dites-moi :
êtes-vous seule ? N'avez-vous ni père, ni frères ?
- Non, Monsieur : j'ai un cousin qui est fabricant, et vient par
ici de temps en temps ; mais aujourd'hui, il se trouve à la fête de
Saint Pierre, et je n'ai personne pour l'envoyer chercher...
– Que voulez-vous, Mademoiselle, de votre cousin ?
– Je voulais voir ce qui se passera ; j'ai peur de rester
toute seule ; je ne sais pas quoi faire... J'ai peur de devenir folle...
– Vous n'allez pas devenir folle, Mademoiselle ; tout va
se faire de la meilleure façon possible. N'avez-vous aucune voisine qui
puisse vous recevoir chez elle ?
– Si, Monsieur ; mais elle est allée à la fête faire du
poisson frit.
– Comment s'appelle-t-elle ?
– C'est la mère Ana de Moiro.
– Attendez un peu, prenez votre mal en patience, n'ayez
pas peur ; et fermez votre porte ; je vais aller la chercher.
– C'est le Seigneur qui vous envoie... Mais elle ne va pas
quitter la fête pour revenir ici...
– Elle la quittera...
Guilherme partit, vivement impressionné. C'était un
nouveau tableau, de quoi stimuler des sentiments qui le faisaient
vibrer pour la première fois. Les yeux de son âme ne pouvaient se
détacher de la situation angoissante d'une fille embrassant le cadavre
de sa mère, son seul appui qui la lâche en un instant, regardant autour
d'elle, pour se contempler alors que ne peut l'entendre que le silence
de son désarroi. S'il avait pu, cependant, détourner les yeux de son
esprit de cette scène, et fixer ceux de son visage sur la fille de
cette morte, il eût vu une jolie fille.
Il pressa le pas jusqu'à Miragaia, et demanda à une
tavernière si elle connaissait Ana do Moiro.
– C'est celle qui donne là-bas une assiette de poisson à
cet homme au chapeau blanc.
La poissonnière lui demanda s'il voulait du merlu ou du
flétan ; il répondit :
– Vous devez connaître des voisines à vous qui sont mère
et fille...
– La mère Rosa, la femme du charpentier ?
– Je ne sais pas si c'est celle-là ; elle a un cousin
artisan.
– Ce n'est pas son cousin, c'est son neveu ; il est plutôt
le cousin de sa cousine, c'est-à-dire, la fille de la mère Rosa, qui
s'appelle Augusta.
– C'est sûrement ça ; je venais vous dire que la mère Rosa
vient de mourir brusquement.
– Elle est morte ?! Ça alors ! Que me dites-vous là,
Monsieur ? Pauvre femme !
– Ce que je voudrais c'est que vous alliez tenir compagnie
chez elle à sa fille.
– Je le ferais, Dieu me sauve... Mais je ne peux pas
laisser tout ça en plan !
– Je ne vous ai pas encore tout dit. Confiez votre échoppe
à quelqu'un, je vous donnerai une demi-pièce.
– Vrai !? Attention à ce que vous dites !...
– Je sais ce que je dis ; prenez tout de suite ces cinq
pintos que je
vous donne, et venez avec moi.
La philanthropique Ana de Moiro, effarée de cette
aventure, confia à sa fille la responsabilité du réchaud sur lequel
rugissait la poêle, et suivit Guilherme.
– Je n'en reviens pas. C'est la première fois que je vous
vois. Dites, Monsieur, ne vous méprenez pas, je vous fais confiance,
est-ce que vous alliez régulièrement chez la mère Rosa, que Dieu parle
à son âme ?
– Non, Madame. C'est la première fois aujourd'hui...
– On voit de ces choses ! Cette façon que vous avez de
donner de l'argent là, sans plus !... Il y a anguille sous roche, et,
si c'est ça, pourvu que la gamine, si elle doit mal se conduire, tombe
entre les mains d'un homme qui se rende compte de ses qualités.
– Vous vous trompez. Je ne tiens pas particulièrement à
connaître les qualités de cette demoiselle.
– C'est une façon de parler. Pourvu que tout le monde s'y
retrouve, comme dirait l'autre... Si c'est pas malheureux ! Aujourd'hui
même, la mère Rosa chantait à sa porte, et elle paraissait en avoir
encore pour longtemps... On se trompe si facilement dans ce monde !
– De quoi vivait-elle ?
– Elle était pauvre, mais elle s'en sortait très bien.
Elle dévidait de la soie, et sa fille faisait des bretelles à quatre
vinténs la douzaine. Le père était menuisier et se débrouillait
parfaitement, mais il se trouve maintenant dans le Royaume de la
Vérité. Ce qu'elles avaient pour elles, c'est qu'elles n'avaient pas à
payer de loyer. La maison est à elles ; mais à présent, s'il n'y a
personne pour lui donner un coup de main, la gamine n'a plus qu'à
vendre la maison.
– C'est cette rue ?
– Oui, Monsieur. Ça se voit que vous n'êtes pas habitué à
ces ruelles.
– Comment s'appelle cette rue ?
– C'est la rue des Arménios. Ça fait à peu près cinquante
ans que je vis ici, et mon père y a aussi vécu, Dieu lui pardonne, il
était batelier et s'appelait António, on le surnommait
Le Maure. Je ne
l'ai pas connu ; mais c'était un homme, un vrai ! Il s'est bagarré avec
les Français, que le diable les emporte, il en a tué deux avec son
couteau, mais, pour finir, il y est resté lui aussi... C'est ici...
Guilherme n'accordait aucune attention aux démêlés
généalogiques de la poissonnière, il cherchait, à sa droite, la maison
de la morte.
Ils frappèrent et entrèrent. La fille de l'assassin,
jadis, du fidalgo de la Bandeirinha eut l'impression qu'elle se devait
de couiner sur le cadavre de sa voisine, si bien qu'elle pleurnichait,
embrassée à Augusta, en se livrant à la plus sotte des comédies.
– Il n'est plus temps de pleurer, dit Amaral. Vous irez
vous installer, Mademoiselle, chez votre voisine. Envoyez ce matin
quelqu'un dire au curé que cette femme est morte. Je ne sais pas si
vous avez besoin d'argent, mais je crois que c'est le cas. Je vous
laisse de quoi faire face au plus pressé, et je regrette de ne pouvoir
vous consoler de la perte de votre mère. Essayez de vous reprendre,
Mademoiselle. J'ai subi moi-même une telle épreuve, et je sais que l'on
ne s'en remet qu'avec le temps. Allez, partez d'ici avec Dona Ana. Je
passerai demain, ou j'enverrai quelqu'un voir si vous avez besoin de
quelque chose.
– Mais j'aimerais savoir à qui je dois tant de
bienfaits... dit-elle en sanglotant.
– À quoi cela vous servira-t-il de savoir qui je suis ?
Vous ne me connaissez pas, Mademoiselle, et, si vous me connaissiez,
vous ne seriez pas plus à même de me remercier.
– Je pourrai vous payer en travaillant, si Dieu me donne
vie et santé.
– Tirez donc vous-même parti de votre travail.
Amaral avait savouré en sortant les charmes de la bonne
conscience, et goûté un de ces moments uniques où un homme se sent
embrasé d'une étincelle divine, c'est une récompense secrète, intime,
qui ne vient que du cœur, et que seule la charité nous offre.
La voisine fut la première, après le départ d'Amaral, à
toucher l'argent.
– Oh ! s'écria-t-elle quand elle le vit, avant de le
toucher.
– Qu'y a-t-il ? demanda Augusta.
– Deux pièces !
– Seigneur !... dit l'orpheline laissant tomber la tête
sur son sein. Tout cela me paraît un songe... Ce monsieur doit être un
de ces envoyés de Dieu, comme il y en a eu tant !
– Si c'en est un, que le diable vienne nous le confirmer !
dit la fille du Maure, prenant le diable à témoin de l'œuvre de Dieu.
Range cet argent, tu as de quoi voir venir, ma petite. Si j'étais toi,
j'achèterais une petite chaîne, c'est de l'argent dans ton tiroir, une
fois que tu auras payé certaines dettes de ta mère.
– Ma mère, Dieu merci, n'avait pas d'autre dette que les
dix-huit vinténs qu'elle vous devait.
– Tant mieux ! tu ne sais pas le bien que ça me fait
là-dedans, que tu n'aies pas d'autres dettes à régler...
– Cet argent, je vais l'employer à faire dire des messes
pour son âme.
– Renonce à cette idée. Ta mère était une dévote du bon
Saint Pierre, c'est son jour demain, il va lui ouvrir les portes du
ciel... Laissons ici une lampe pleine d'huile, et allons chez moi.
Allez, viens.
Augusta trempa de ses larmes le visage de sa mère. Elle
l'embrassa, lui donna des baisers, l'appela encore comme qui espère un
miracle, son imagination allumée par sa conviction qu'elle avait
affaire à un envoyé de Dieu. Mais le cadavre ne tressaillait pas entre
les bras convulsés de cette jeune fille crédule.
Elles fermèrent la porte et sortirent.
Tandis qu'Augusta, inconsolable, pleurait chez sa voisine,
la poissonnière prévoyante se torturait l'esprit en cherchant la
meilleure façon d'employer les deux pièces.
VI
Deux jours après, Guilherme do Amaral alla, rue des
Arménios, observer à
la lumière du jour la supposée misère de cette maison qu'il n'avait pu
constater à la lueur mourante d'une chandelle, et surtout pour tenir la
promesse qu'il avait faite de subvenir à d'autres besoins de
l'orpheline. L'on ne saurait avoir d'intentions plus pures.
Il était midi, la porte était fermée, et une petite
fenêtre, la seule qui donnât directement sur la rue, était à peine
entrouverte. Guilherme s'arrêta en face. Augusta le vit, et courut lui
ouvrir la porte, comme à un parent, ou à une personne anxieusement
attendue.
– Si vous voulez bien entrer... dit-elle en rougissant. La
maison n'est guère présentable, mais...
– Toutes les maisons sont bonnes, où règne la joie, ou
l'espoir de la connaître un jour. Comment allez-vous, Augusta. ?
– Merci, Monsieur; j'ai passé la journée d'hier au lit, et
je viens de me lever, parce que mon cœur me disait que vous viendriez.
– Votre cœur vous disait donc que je viendrais ?
Augusta baissa les yeux, et sourit d'une façon qui
soulignait sa gêne.
– Pourquoi ne vous asseyez-vous pas ? fit Amaral, comme
s'il ne remarquait rien.
– Je me sens bien, Monsieur.
– Asseyez-vous Augusta : c'est moi qui vous le demande, ou
qui l'exige.
Augusta s'assit, et leva les yeux craintivement vers
l'homme qui ne lui semblait plus un messager obéissant à des ordres
d'En Haut.
– Que comptez-vous faire ? continua son hôte, qui
s'apercevait de la rare beauté de cette femme obscure.
– Moi, Monsieur ?
– Oui ; comptez-vous vivre seule, sans parents...
– Je n'ai qu'un cousin, qui est un orphelin, lui aussi ;
mais nous vivons chacun chez soi.
– Je sais que vous gagnez votre vie en faisant des
bretelles.
– Oui, Monsieur. C'est la mère Ana qui vous l'a dit ?
– Oui. Combien gagnez-vous par jour avec ce travail ?
– Je gagne trois vinténs en veillant tard.
– Et c'est de ça que vous vivez ?
– Jusqu'à maintenant parce que ma mère gagnait quatre
vinténs en dévidant de la soie ; maintenant, ce sera à la grâce de Dieu.
– Cela ne suffit pas... Si vous trouviez, Mademoiselle,
une maison où vous pourriez servir en tant que gouvernante, vous
amélioreriez votre situation.
– Je n'en doute pas ; mais je veux vivre et mourir où ont
vécu et sont morts ma mère et mon père, que Dieu le garde en sa très
sainte gloire. Mon cœur me dit que si je sors de ma modeste maison, je
serai malheureuse. Je connais beaucoup de filles qui sont allées
s'engager comme servantes, et peu d'entre elles ont bien fini. Presque
toutes traînent par ici, dans une maison aujourd'hui, demain dans une
autre, et, quand Dieu le veut, plus pauvres et malheureuses qu'elles ne
sont sorties de leur misère, après leurs gains.
– Une des choses qui me surprennent, ce n'est pas tant
votre bon sens, que le fait que vous soyez encore célibataire. Quel âge
avez-vous ?
– Vingt ans, Monsieur.
– Et vous n'avez jamais voulu vous marier ?
Le teint d'Augusta prit la couleur d'une cerise, et elle
ne répondit pas.
– Vous n'avez pas à rougir, reprit Guilherme, s'engageant
dans cette conversation avec un vif intérêt auquel le cœur... ou son
caprice n'étaient déjà plus étrangers. Je ne veux pas être votre
confesseur ; ce n'était qu'une question, je ne voulais pas vous
froisser.
– Vous ne m'avez pas froissée, Monsieur ; mais... je ne
sais pas si l'on doit dire tout ce que l'on sent.
– Du moins, ce qui ne nous gêne pas peut se dire à tout le
monde ; et ce qui nous gêne, ou bien on ne le dit pas, ou bien on le
dit à un confesseur.
– Je n'ai pas voulu me marier avec un garçon qui m'aime,
il y a quatre ans.
– Est-ce un ouvrier qui travaille dans un atelier ?
Excusez la liberté que je prends en prétendant connaître vos secrets.
– C'est un artisan.
– Peut-être votre cousin, dont vous m'avez parlé...
– Quelqu'un vous l'a dit ?
– Non, pas du tout, Mademoiselle. J'ai lancé cela au
hasard. Vous l'aimez bien ?
– Oui ; mais je ne veux pas me marier ; je voulais qu'il
reste mon ami, qu'il me considère comme sa cousine et rien de plus.
– Vous n'éprouvez aucun amour pour lui, c'est ce que vous
voulez dire...
Le dialogue fut interrompu par des pas, sur les marches de
l'escalier.
– Je peux entrer, Augusta ? dit une voix.
– C'est mon cousin, dit-elle en tressaillant.
– Dites-lui d'entrer... Mais pourquoi êtes-vous effrayée ?
– Entre, Francisco... dit la jeune fille, craintivement.
En voyant l'étrange hôte de sa cousine, l'artisan leva la
main vers sa casquette, et fit mine de se retirer.
– Approchez, Monsieur Francisco... dit familièrement
Guilherme. Il n'y a rien ici qui vous force à partir.
– Cet homme, dit Augusta, toute pâle, est la personne dont
je t'ai parlé, Francisco.
– Je suis au courant... Tu disais que c'était une
âme descendue du Ciel, et j'ai toujours pensé que c'était une personne
de ce monde... dit l'artisan avec une pesante assurance, mais avec un
certain humour.
– Et bien de ce monde, Monsieur Francisco ; mais celui qui
aurait dû être ici, quand votre tante est morte, c'est vous. Un homme
qui a une cousine célibataire, ne l'abandonne pas pour faire la noce à
la foire.
– Il s'est trouvé que j'étais allé me détendre ce soir-là
; mais enfin, il a plu à Dieu d'emporter ma tante, et qui reste ici-bas
n'est pas obligé de se laisser mourir.
L'agacement d'Augusta se lut dans son visage, après cette
réponse incongrue. Amaral la comprit, et eut l'impression de
découvrir dans cette femme quelque chose de spécial, une distinction
instinctive, contrariée par les circonstances. Une idée l'effleura, qui
le laissa quelques secondes songeur, tandis que l'artisan indiquait
grosso modo à sa cousine l'endroit où sa mère pourrait être enterrée,
et le curé à qui elle avait commandé cinquante messes pour son âme.
Amaral l'interrompit :
– Vous avez fait dire cinquante messes pour l'âme de votre
mère ?
– Oui, Monsieur, avec l'argent que vous m'avez laissé, et
j'en ai encore beaucoup pour en faire dire quelques-unes pour l'âme de
mon père.
– C'est une bonne façon de dépenser son argent... dit
ironiquement l'artisan.
– Je trouve, moi, qu'il est bien employé, l'argent qui
nous aide à calmer notre chagrin, en nous acquittant les obligations
qu'ont les vivants à l'égard de leurs proches qui sont morts. Vous avez
fort bien fait, Mademoiselle.
Augusta baissa la tête avec un certain air d'intelligence.
Francisco avait ouvert la bouche en entendant cette justification de
Guilherme, un signe manifeste qu'il n'avait rien compris.
Amaral continua, en se tournant vers lui :
– Vous êtes donc artisan ?
– Oui, Monsieur, je travaille dans les métiers à tisser à
Lordelo depuis cinq ans.
– Combien cela vous rapporte-t-il par jour ?
– Deux tostões, ça fait peu.
– Et vous avez quitté votre travail aujourd'hui ?
– Non, Monsieur. Nous disposons d'une heure et demie pour
la sieste en été, et je viens toujours voir ma cousine.
– Vous devez avoir beaucoup d'amitié pour elle, et l'aider
à vivre, avec ce que vous avez.
– Elle ne veut pas en entendre parler... J'ai voulu faire
venir une dispense pour nous marier, et elle ne me dit pas non, mais
elle ne me dit pas oui.
– Mais, pour se montrer bon avec sa cousine, un cousin n'a
pas besoin d'être son mari.
– C'est ce que je lui ai dit... fit Augusta, toute
contente, et fière d'avoir dit ce qu'Amaral venait de répéter.
– Je n'en doute pas, répondit l'artisan, mais si nous
étions mariés, ce ne serait pas la même chose. Nous pourrions vivre
ensemble...
– Nous pourrions, nous pourrions... dit Augusta, en
l'interrompant.
– Que ce Monsieur dise si une fille comme toi peut vivre
avec un garçon sans qu'on en parle.
Amaral sourit de ce recours imbécile à son témoignage, et
répondit :
– Je trouve, moi, qu'elle peut.
– Mais, objecta l'autre, il n'y a pas de fumée sans feu.
Je l'aime du fond de mon cœur depuis quatre ans, bientôt cinq, et si
elle était avec moi, et qu'il venait quelqu'un pour lui conter
fleurette, je ne sais pas ce qui se passerait, je perdrais la tête, et
les mauvaises langues diraient que je me conduis mal avec ma cousine.
– Tu ferais mieux de te taire... dit Augusta, terriblement
gênée, avec un geste d'agacement naturel, qui plut beaucoup à
Guilherme, parce que même les femmes les plus stylées dans les salons
n'auraient pas mieux exprimé un dégoût affecté.
– Ce que je dis, ça ne mange pas de pain. C'est juste que
ce Monsieur a dit que je devais t'aider à vivre.
– Mais vous pouvez lui être utile sans vivre avec elle ;
épargner le quart de votre salaire, qui, avec celui de votre cousine,
lui permettrait de subvenir à ses besoins ; et, quand l'occasion se
présenterait de faire un mariage avantageux, la laisser se marier, vu
qu'elle ne veut pas être votre femme. On doit se marier librement.
Francisco faisait la tête en brossant le haut de sa
casquette avec sa main. Augusta avait posé ses yeux noirs, humides de
larmes de reconnaissance, et en même temps captivés, saisis par cette
fascination qu'une femme innocente ne sait pas cacher derrière son
éventail, ou maîtriser par un sourire dédaigneux.
Amaral n'avait pas besoin d'être aussi pénétrant qu'il
l'était pour surprendre la secrète inquiétude de la cousine de
l'ouvrier
(8)
. Une femme doit avoir été trompée dix fois pour être capable
de tromper un homme moyennement subtil, et Augusta n'avait pas connu
une seule de ces déceptions qui habilitent l'imposture, en empoisonnant
l'ingénuité. Si les lèvres avaient parlé, elles auraient pu mentir,
parce que la pudeur a ses ruses ; mais pas le silence. Ce qui la
trahissait le plus, c'étaient ses yeux, où un trouble intime, un feu
soudain, qui la brûlait intérieurement, se reflétait dans les
étincelles d'une joie spontanée, dans la langueur d'une retenue qui
réagit contre les indiscrets épanchements de la candeur.
Amaral cédait, à ce moment-là, à l'orgueil, et se demandait si
ce n'était pas la première conquête dont il pût s'enorgueillir.
Était-ce trop facile, du moment qu'il se croyait aimé ? Non, pas du
tout. Seuls les fous peuvent se convaincre que leurs yeux répandent des
torrents magnétiques à l'entour, plongeant dans la prostration les
victimes qu'ils frappent. Heureusement que les moqueries les
refroidissent, pour qu'ils ne soient pas sur la terre l'unique espèce
parfaitement heureuse. Or Guilherme ne faisait pas partie de ce grand
nombre que mentionnent les Saintes Écritures ; il aurait pu, au
contraire, se piquer d'être, sans se vanter, le Bentham de la
Déontologie du cœur, le Herschel des lentilles les mieux travaillées,
pour, à travers la grande distance qui sépare les yeux du cœur d'une
femme, y lire tout ce qu'elles se cachent à elles-mêmes.
Pour détourner la conversation d'un sujet sur lequel il
n'était pas honnête de s'attarder ; Guilherme regarda autour de lui, et
dit avec un sourire bienveillant.
– À voir cette maison de dehors, l'on ne s'imaginerait pas
à quel point elle est propre, fraîche et charmante à l'intérieur.
– Une maison de pauvres, fit Augusta, acceptant la
remarque avec modestie, mais fière de la mériter.
– Une maison de pauvres, reprit Guilherme, mais de pauvres
qui n'ont pas à envier le luxe des riches salons, où l'insatisfaction
et souvent la honte sont une parure sombre au milieu de tout ce lustre.
Amaral parlait alors pour lui. Augusta avait deviné l'idée
sans connaître les expressions. Francisco ne comprit ni l'idée, ni les
expressions.
– Ma mère, disait la couturière, adorait cette propreté.
Ce petit napperon rouge qui orne la commode a coûté fort peu ; c'est
moi qui ai fait la frange blanche qui lui donne du charme. Ces chaises,
c'est mon père qui les a faites, il était menuisier, et tous ces
meubles ont été réparés par lui. Nous avions là, à l'endroit où
se trouvent les nattes, une cloison ; mais cela doit faire un an
qu'elle est tombée, et nous n'avons jamais pu la relever.
– Cette maison, demanda Guilherme, n'avait-elle pas un
autre étage ? C'est ce que semble indiquer le plafond, il est lisse...
– Il y en a eu un, mais il y a eu ici un incendie
qui a brûlé l'étage de dessus.
– Vous étiez déjà ici ?
– Non, Monsieur, je vous raconte ce que mon père me
racontait. Au temps des Français, un homme habitait ici, dont on
disait qu'il était très riche. Quand ils sont entrés à Porto, comme
vous avez sans doute entendu dire, il y a eu beaucoup de monde qui
s'est noyé sur le pont, comme l'indique un panneau pour les âmes du
Purgatoire. L'homme qui habitait ici a été l'un de ceux qui se sont
noyés, ou ce sont les Français qui l'ont tué, parce qu'il n'est jamais
réapparu. Comme il passait pour riche, les Français sont entrés ici,
mais mon père me disait que c'étaient des Portugais...
– Je crois même, fit l'ouvrier en l'interrompant, que
c'était surtout un batelier, le père de cette Ana, que vous êtes allé
chercher à la foire.
– C'est possible ; mais l'on ne doit pas charger son âme
d'une chose dont on n'est pas absolument sûr, répondit Augusta. Qui que
ç'ait pu être, le fait est que les voleurs, furieux de n'avoir rien
trouvé, ont mis le feu au sommier. Quand les gens sont accourus, ils ne
pouvaient plus rien pour l'étage qu'avait cette maison ; tout a brûlé
sauf le plafond. Logtemps après, mon père qui habitait près d'ici a
cherché à savoir qui étaient les héritiers de cet homme, et acheté
cette petite maison très bon marché, dans le but d'arranger le
rez-de-chaussée parce qu'il n'avait pas assez d'argent pour la remettre
complètement en état. Il a fait tomber les murs de l'étage, planchéié
cette boutique qui était en terre battue, et ouvert cette fenêtre car
elle était très sombre. Je suis née ici, et chaque fois que je l'ai pu,
je récupérais du papier de couleur pour couvrir le plâtre du mur qui
est très vieux.
– Et vous devez être fière de votre jolie maison, Augusta,
dit Amaral, en se levant. Je suis en trop ici, et c'est pour ça que je
me retire.
– Déjà ?! demanda-t-elle avec une innocente familiarité.
– Je ne veux pas empêcher votre cousin d'employer les
moyens qui permettent d'adoucir les jeunes filles cruelles,
répliqua-t-il en souriant ; il avait surpris dans ses yeux tous les
secrets de son cœur.
– Nous n'avons rien à nous dire, murmura Augusta en
avalant de travers, et en tordant entre ses doigts la pointe du fichu
noir à son cou.
– C'est vrai... dit l'ouvrier avec une malicieuse
innocence, ou une ingénuité crasse... L'on parle de choses qui
n'engagent à rien. Tandis qu'elle coud ses bretelles, je m'assieds à
côté, et nous passons des heures à ne rien nous dire. Depuis quelque
temps, elle est devenue très sérieuse avec moi, et ne me dit pas un
mot. D'après moi, il y a un mariage dans l'air.. Elle le
coupa :
– Seigneur ! Ne faites pas attention, Monsieur... Mon
cousin n'a pas toute sa tête, et quand il se met à bavasser, il ne
pense pas ce qu'il dit, et ça ne le gêne pas de mentir. C'est un bon
garçon, mais il a une langue qui pend jusqu'à ses semelles... Comment
peux-tu dire... Que la Sainte Vierge me protège ! Et toi aussi...
Ces mots, dits avec légèreté, trahissaient sa mauvaise
humeur et son agacement. Même s'il ne lâchait en parlant que des
pépites d'or, l'ouvrier resterait toujours, à côté de Guilherme, un
goujat. Cette comparaison lui déplairait ; l'écouter, après son hôte,
inspirait presque à Augusta la honte d'avoir un tel parent. Ces
maladresses, grandes ou petites, qu'elle relevait chez l'ouvrier au
langage rude, étaient des signes d'un grand ou d'un petit malheur,
appelez-le comme vous voudrez, que les marquises de Louis XIV et la
couturière qui cousait des bretelles rue des Arménios appelaient AMOUR.
Mais l'amour d'Augusta, si imprévu, s'explique-t-il ? Parfaitement ;
c'est un mot qui s'explique par un autre : le mot FEMME. Admettons :
cependant l'amour ne se présente pas ainsi pour tous les hommes. "Moi,
par exemple, dites-vous, cher lecteur, j'ai consumé ma jeunesse sans
voir une de ces femmes aux fibres flexibles qui se plient sous la main
magnétique de ma volonté." Tant pis pour vous, cher ami : mais
gardons-nous d'instaurer des règles, particulièrement touchant les
femmes, qui constituent toutes des exceptions. Guilherme do Amaral
avait un don. Ce n'était pas l'effet diabolique d'une magie noire ou
blanche, ni les ruses fallacieuses d'un séducteur confirmé. C'était le
pouvoir absolu de la fascination. Vous ne savez pas ce que c'est ?
C'est un fluide qui agit indépendamment de la volonté, et fait qu'une
victime se lance aveuglément sur les traces sanglantes d'une autre,
derrière le même bourreau, comme les femmes d'Henri VIII ; avec cette
notable différence que le monarque anglais magnétisait ses chaînes par
les diamants de sa couronne : tandis que l’homme fatidique, le tyran
des esprits exerce, d'un regard profond, son infernal pouvoir
d'attraction.
Et l'intensité de son magnétisme tient à la promptitude
avec laquelle il soumet la femme cultivée, jusqu'à la faire renoncer à
tout idéalisme, et la femme innocente jusqu'à ce qu'elle soit incapable
de trouver les moyens d'échapper à la domination d'un tel homme.
Et ces monstres existent ?
Oui, mes prudentes dames. Ils existent. Je ne vous dis pas
de faire attention, parce que ce serait inutile.
Voilà pourquoi Augusta... N'avançons pas de conclusions
intempestives ! Je n'autorise personne à plaindre avant moi la
charmante couturière de la rue des Arménios. Elle est si jolie !
Comment João Antunes da Mota, dit le Kágado, aurait pu s'imaginer
quarante-cinq ans avant que ce taudis infect serait habité par la
figure la plus suave, la plus délicieuse, la plus espiègle, la plus
intelligente qui peuplent la galerie de femmes dont je dois assurer
l'immortalité !
Le chapitre suivant peut être lu par tout le monde.
VII
Quatre heures s'étaient écoulées de patientes cogitations
sur sa vie,
quand Guilherme do Amaral, en juge capable de lui-même, décida qu'il
aimait la couturière pauvre, qui faisait des bretelles. Ces quatre
heures s'étaient écoulées entre le moment où il avait pris congé de la
rue des Arménios, où nous l'avons laissé au chapitre précédent, et
celui où il s'habilla pour se rendre à un dîner d'adieu donné en son
honneur par le mari de Dona Cecília.
Là, comme on peut s'y attendre, une fois épuisées les
politesses à l'illustre maîtresse de maison, les attentions, quelque
peu imbibées, se tournèrent vers Amaral. Quelques maris suspects furent
les premiers à chanter les vertus du provincial. Des dames au-dessus de
tout soupçon, applaudirent bruyamment le point de vue de leurs maris.
Ils s'entendaient à merveille.
Puis il y eut des accès de sentimentalisme répondant à une
étiquette à bout de souffle, quand l'on déplore le départ d'une jeune
homme, la gloire et un ornement, à tous les égards, de la bonne
société. Tout était prétexte à boire ; les larmes dansaient dans les
yeux rubescents des convives, tandis que le champagne frémissant
renouvelait le liquide répandu par les glandes lacrymales.
Un député, le front encore illuminé par son auréole
oratoire, conquise dans des luttes parlementaires sur la fabrication
d'huile de médicinier (voir le
Diaro
do Governo de 1843), debout,
haletant, les narines grande ouvertes sous le souffle de l'inspiration,
les cheveux hérissés, et les yeux injectés de son feu sacré, tint ce
discours.
– Mesdames et Messieurs !
Silentium ore facundius : les
discours sont muets, le silence parle ! traduirais-je, avec la
conscience d'avoir dit tout ce qu'on peut dire en de telles
circonstances (
il étouffe, et pose
les yeux sur un Cupidon peint au
plafond) en de telles circonstances... si... si (
une dame imprudente
est prise d'un petit rire contagieux...) si la voix de l'amitié,
de
l'honneur, et du devoir ne m'inspiraient pas au moment solennel de ce
bien triste adieu. ("Bravo !"
crie
le baron de Carvalhosa, en
encourageant son voisin d'une grimace) Oui, Messieurs ; cet
homme que
la fortune nous a donné, le fortune capricieuse nous le vole !
(
Sensation ; un silence à peine
brisée par le sifflement suraigu d'une
prise) En ses vertes années, vous ne sauriez l'imaginer plus
avisé,
plus prudent, plus cultivé, respectant plus les saines coutumes, plus..
plus.. ("plus honnête !"
ajoute
un... Orgon digne de Molière) c'est ça,
plus honnête que cet être aimé de nous tous, respecté de nous tous, de
nous tous... ("Mieux vaut qu'il ne dise pas de nous toutes"
fait
malicieusement observer une dame qui connaissait parfaitement les
autres) nous tous qui le regretterons terriblement, à qui il
laissera
un souvenir glorieux ! (“Bravo ! Bravo !”
lance le baron de Carvalhosa,
suivi par d'autres commandeurs pas encore endormis). Oui,
Messieurs,
notre gentilhomme, Guilherme do Amaral, qui mérite à tous les égards
nos vibrants éloges, va partir !!!! (
quatre
points d'exclamation
figurant dans un brouillon sur lequel il avait travaillé quinze jours,
à raison de deux heures par jour). Un modèle exemplaire pour nos
jeunes
gens, qui par ses vertus nous suggère une précoce sénilité, va partir !
(
Guilherme envoie mentalement
l'orateur à tous les diables.) Le type
même de l'intégrité, de la rectitude, de la probité... va partir
! Et nous, nous restons ! Nous restons, oui ! Nous restons seuls !...
Et qu'il n'y ait pas un aimant qui le retienne auprès de nous ! Et
qu'il n'y ait pas de douce chaîne qui l'emprisonne ! Et qu'il n'y ait
pas... qu'il n'y ait pas... ("un tromblon !"
murmure un journaliste mal
élevé, pas du tout drôle) qu'il n'y ait pas.. qu'il n'y ait pas
("une
commission pour réviser les speechs !..."
glisse le même insolent à
l'oreille d'une dame qui a le mauvais goût de pouffer) qu'il n'y
ait
pas un ami qui le restitue à ses amis !... (
bruyant concert de bravos
et de rots) Eh bien, soit ; que le destin s'accomplisse ! Nous
resterons ici pour boire à sa santé chaque fois que nous nous réunirons
avec les cordiales effusions qui accompagnent ce toast que je propose
en l'honneur de notre si digne ami, Guilherme do Amaral !! (
Beuglements
chaotiques ; l'on boit prodigieusement : un commandeur, erreur
pardonnable, porte à ses lèvres une tasse d'eau tiède dans laquelle il
s'était rincé les doigts. Deux dames éclatent de rire, quatre
coussins se déchirent. L'orateur est radieux.)
La chaleur de l'enthousiasme une fois atténuée, Amaral se
lève, un verre à la main. Un
chut
unanime impose le silence momentané
des orgies érudites. Les dames, ouvrant bien les yeux et les oreilles,
ne cillent pas. Les gros hommes desserrent les gilets qui les
compriment, pour savourer aussi commodément qu'il se peut les délices
prodiguées par l'orateur à la barre. Le député, l'air protecteur, étend
son bras comme pour demander que l'on retienne religieusement sa
respiration. Le baron de Carvalhosa lui-même n'ose porter à son nez la
voluptueuse prise à laquelle il renonce pour ne pas troubler d'une
sifflante aspiration le silence général.
– Je suis fort impressionné, dit Amaral avec le sérieux le
plus hilarant, par la touchante éloquence de Monsieur le Conseiller,
qu'aurait enviée Démosthène ; il est l'honneur de notre patrie, et
c'est à peine si je parviens à articuler les notes confuses d'un hymne
de reconnaissance, que notre cœur égoïste renferme en lui-même, et ne
confie pas aux lèvres qui le profanent. ("Bravo, admirable !"
s'exclame
le député qui bat la mesure avec sa tête chaque fois que l'éloquent
fêtard appuie sur une syllabe.) Si l'inspiration est la mère des
grandes idées combien d'embryons perdus dans ses entrailles ! Combien
d'émotions divines noyées par la grossièreté de la parole humaine !
Combien d'expansions nées au plus profond de nous-mêmes et refroidies
dans la glace des lèvres ! C'est que la langue humaine n'est pas encore
formée. Le savant gentilhomme qui m'a précédé a bien fait de dire, dans
un vers bien frappé : "Les discours sont muets, le silence parle !" Et,
de plus, ma situation est très délicate. Je suis de débiteur de tant de
créanciers ; et les dettes de l'amour ne sont payées que par l'amour,
l'amour silencieux, l'amour dont les anges balbutient le langage,
l'amour qui construit son nid dans les fibres intimes de notre sein et
y meurt quand le poids d'une dalle froide écrase son asile sacré.
("C'est magnifique, inimitable, et tellement original !"
tonne le
député qui arrache aux convives, qui, mis à part d'honorables
exceptions, n'ont rien compris, un rugissement d'admiration.)
C'est cet
amour qui conduit l'homme ; tous les calculs de son cerveau tournent
court, ils ne sont couronnés de réussite s'ils ne sont confirmés par
l'accord de la force motrice qui entraîne l'essieu de cette machine
fragile qu'on appelle la vie. La preuve de cette assertion, je vais
vous la donner, Mesdames, bien que vous puissiez vous en passer, parce
que l'amour en vous représente l'esprit de la vie ; et à vous aussi,
Messieurs, plus ou moins exposés à la pourriture de ce siècle, d'où
l'inspiration s'est enfuie épouvantée, et si loin que peu la
reconnaissent si elle descend du ciel au sein de l'humanité. (
Une
vieille dame pleure, et, en face d'elle, sa fille éclate de rire. Dona
Cecília écrase le pied de sa voisine, toute confuse, persuadée qu'elle
est d'avoir heurté de son pied le plus gros oignon du baron assis à
côté d'elle. L'orateur poursuit son improvisation échevelée.) En
voulez-vous la preuve ? La voici. Il n'y a pas un quart d'heure, je
traçais à gros traits le vaste itinéraire de mes voyages. Je me
demandais dans quelle palmeraie, dans quelle forêt du Nouveau Monde, en
quelle oasis du désert, sous quelle latitude de l'Océan, dans quelle
nécropole des empires dévastés, d'ici un an, je me rappellerais les
personnes pleines de regrets qui sont venues aigrir, dans les rires
d'un festin, les larmes cachées, que je verserais ensuite...
(
Sensation. D'aucuns qui doivent aux
vins secs leur sixième sens de la
sensibilité poétique, ont les yeux embués : l'on voit que Virgile n'a
pas menti qund il a dit : sunt lacrimae rerum
, que je corrigerais
cependant ainsi : sunt lacrimae vini.) Des larmes d'une brûlante
nostalgie auraient coulé de mon visage sur le fût de quelque colonne de
Ninive. Je tournerais, comme l'Israélite sur les berges du fleuve où il
languit, vers l'occident mes yeux mélancoliques comme le proscrit qui
ne connaît pas les hommes qui le regardent, la lune qui l'éclaire, la
brise qui ne le rafraîchit pas, les fleurs qui n'exhalent pas pour lui
les parfums de sa patrie ! ("Que diable veut-il dire ?!"
demande un
commandeur, à son voisin, un conseiller municipal. Réponse : "Je
ne comprends pas un traître mot." ) Voyez combien amer serait pour moi
cet adieu à l'endroit de notre globe où sont réunies, comme des
piédestaux de ce beau ciel, toutes les grâces, toutes les merveilles de
la création, toutes les extases qu'apporte l'amour du poète,
l'admiration de l'artiste, les abstractions du philosophe ! Je ne
devais pas quitter ma patrie, spécialement Porto, où j'ai vécu les doux
et fugitifs moments de la jeunesse, à présent fanée comme la fleur
oubliée sur sa tige, sous les ardeurs du soleil, sans une goutte d'eau
pour la ranimer ! ("Quelle affreuse corvée !"
fit judicieusement
observer le journaliste, qui mourait d'envie de fumer.) Je n'en
avais
pas le droit... et, pourtant, Dieu m'en est témoin ("Un légitime
classique ! "
glissa le député à
mi-voix à une espèce de baron, qui ne
le comprit pas.) Dieu m'est témoin que je suivais les traces de
mon
destin, et, à cet instant même, je m'affranchis de l'ignoble tutelle du
destin, pour déclarer, avec la fierté que me donne ma conscience, au
moment où j'agis comme je le dois, que je n'ai pas le courage de vous
abandonner ; je serai des vôtres, si je le mérite ; je n'irai pas
dessécher au soleil de contrées étrangères, les fleurs de l'amitié dont
vous m'avez ici couronné ! À vous, Mesdames, qui avez le don de
souffler une étincelle sur des cendres éteintes ! À vous, Messieurs,
qui vous honorez en honorant l'amitié... une sincère ovation, un toast
fervent !
– Debout ! Debout ! crièrent les uns.
– Sur les chaises ! rugirent d'autres.
– J'en dispense les dames ! dit Guilherme.
– Les dames aussi ! brailla un idiot.
Le député demande la parole ; personne ne fait attention à
lui. Profitant de la confusion, le journaliste s'est allumé un cigare.
La vieille qui pleurait, touchée par la contagion, s'est dépassée avec
sa jambe goutteuse. Les dames, qui se sont laissé aller dans les
libations, ne s'inquiètent plus de la symétrie de leurs boucles. Cette
scène annonçant une orgie ne leur paraissait pas nouvelle, ni
excessive. Elles paraissaient faites pour les festins, comme les femmes
de la cour de Balthazar. L'une voudrait demander la parole, si on ne
l'écrasait pas douloureusement à ce moment-là. L'autre demandait
familièrement au domestique une coupe de champagne...
Et Guilherme do Amaral, qui n'a pas manqué un seul
épisode, et n'avait rien bu qui embrumât ses yeux pénétrants, se
disait, dans son for intérieur : - Ça lève le cœur ! Voici la taverne
où l'on sert dans du cristal de Saxe ! Encore quelques verres de vin,
et ces hommes ôteront leurs vestes, et ces femmes agiteront en l'air
les thyrses des bacchantes.
Ce morceau était une réminiscence du système qui lui avait
si mal réussi à Lisbonne. Là-bas, ces accès de haine contre le genre
humain étaient exprimés à voix haute. À Porto, le jeune homme avisé se
contentait de monologues, et il avait raison. Il ne faisait confiance à
aucun ami, il ne s'était jamais permis un lapsus hasardeux, une de ces
traits faciles qui flattent la vanité, qui maltraitent la réputation
d'une femme, déjà condamnée, et détruisent celle d'un hommes qui étale
frivolement son arrogance. Elle n'a rien perdu, c'est lui qui a tout
perdu ! C'est une absurdité, et j'y crois parce que c'en est une, comme
Saint Augustin : quod absurdum, credo.
L'homme le plus proche de Guilherme, c'était l'indécent
journaliste-poète, que j'ai eu l'audace de vous présenter au bal du
baron de Carvalhosa. Comment Guilerme avait pu se lier avec un tel
caractère, je ne le sais pas, et lui non plus, il ne le savait pas.
Mais ce fait doit avoir une quelconque explication. Le chantre de
Cecília, avec sa féconde inspiration qui lui permettait de produire
quarante huit poésies par an, était un bavard pas trop agaçant : la
richesse et la nervosité de ses pensées, ses critiques, ses sarcasmes,
son rire foudroyant, son ironie épicée, qui faisait fermer la bouche à
ceux qui l'essuyaient, un expérience acquise au prix de toutes ses
chimères, une désinvolture qu'on passait à son talent, où qu'il
imposait par la puissance de sa plume trempée dans du fiel...
étaient-ce ces qualités qui avaient attiré Amaral ? Oui ; et le poète
n'en avait pas d'autres qui lui valussent, à première vue et même à la
réflexion, l'estime ou le mérpris
Le provincial avait commencé par où il aurait dû terminer
: avant de sortir de son village, il parlait de la société comme s'il
revenait au foyer de ses grands-parents demander à ses dieux pénates
une précieuse paix, perdue dans les tourmentes et les bourrasques du
grand monde. Mais tout en lui n'était que feinte ; toutes ses pensées,
toutes ses paroles (mises à part ses œuvres) n'étaient qu'artifice. Il
ne savait pas plus, en son cœur, que ses romans ne lui avaient appris ;
il n'était pas allé au fond de tout cela, pour mettre son doigt sur les
ulcères ; il ne s'était pas éprouvé dans des méditations formidablement
douloureuses, celles-là mêmes qui constituent des mets empoisonnés
servis en abondance à la table du poète quand il appartient à ce petit
nombre qui s'aventure dans le torrent des faits, en proclamant les
théories d'une morale abstruse et impraticable.
S'il s'était entretenu quelques jours de plus avec son
Mentor de Lisbonne, il n'aurait pas aussi attentivement écouté les
raisonnements bon marché du journaliste. Et personne d'autre que lui
n'aurait pu lui accorder une telle importance.
La désillusion n'était pas un calcul, ni l'immoralité une
vocation chez l'auteur de quarante-huit poésies. Il était devenu
incrédule, parce tout ce que lui promettait son enfance n'avait pas été
confirmé ; il a eu raison de ne plus y croire. Il perdit tout scrupule,
parce qu'il lui fallait communier avec les valeurs de sa société ; ce
n'était pas un sylphe pour vivre de l'air du temps, ni une abeille,
pour assouvir sa faim avec le pollen des fleurs ; il a eu raison de
perdre ses scrupules. Et celui qui en expliquait le plus logiquement la
perte, c'était lui. Ses arguments portaient, et il emportait la
conviction, au point que, dans des éclairs de lucidité, Guilherme do
Amaral reconnaissait que la corruption du poète était la plus
rationnelle de toutes.
Et c'est justement ce journaliste qui, au dîner en
l'honneur d'Amaral, avait qualifié de raseur le discours de son noble
ami qui avivait son envie de fumer.
Pour ne rien perdre, le provincial observa le journaliste
durant le quart d'heure délirant qui suivit sa réponse interminable. Il
le vit assis loin de la table, les jambes croisées, plongé comme un
oriental dans les délices de la fumée, et lançant à Guilherme un regard
chargé de raillerie, avec un rire moqueur, rendu encore plus narquois
par la "position" du cigare au coin de ses lèvres.
Les convives passèrent à la pièce voisine, où l'on servait
le café. Guilherme offrit son bras à la maîtresse de maison, la
poétique Cécília, mariée depuis sept mois, qui s'obstinait à dire que
la fleur de son jardin rêvé n'était pas encore sortie de terre.. Elle
eût dit bien des choses, si le malicieux poète ne s'était pas posté à
côté d'elle, pour réciter, avec une apparente conviction, un quatrain
fort connu de sa cantate intitulée LA BACCHANTE, une chose écœurante,
qu'on eût dit écrite sur la sordide banquette d'une taverne. Cecília
s'était levé, et le poète occupa la chaise libre à côté de Guilherme.
– Tu as fait fuir Cecília avec l'un de ces épigrammes dont
tu as le secret... dit Amaral, en souriant.
– Pas du tout ; je ne fais pas des épigrammes pour
les maîtresses de maison chez qui je dîne, si ce n'est la veille ou le
lendemain. Je lui récitais la plus sainte idéalisation de mes extases,
une poésie intime. Si elle a fui quelque chose, c'est sûrement ta prose.
– Tu es un cynique d'un bon carat ! Tu es le Carlos
Herrera de mes romans.
– Et toi, tu seras le Dom Basílio des miens ! Tu es un
phénomène ! De quelle façon tu peux compter sur les votes de ces
gens-là dans les prochaines élections, ça me dépasse ! Qui t'a donné le
privilège de concilier la vertu avec l'immoralité, Amaral ? Parle
franchement !
– Je suis donc immoral ?!
– Tu es un génie ! Tu es le Scotto si sublime du
caricaturiste ! Tu es capable de prouver à tous ces maris que tu portes
des cilices sur les reins ! Sois sincère pour une fois, rembourse-moi
de tant de sincères confidences que je t'ai faites ; je n'en réclame
qu'une ; réponds : comment te sentais-tu à l'intérieur de toi même
quand tu mitraillais ces gens-là de tes ironies, dans ton toast ? Si
c'est pour mentir, tais-toi.
– Je ne vais pas mentir ; je riais.
Le journaliste l'embrassa debout en s'exclamant :
– Tu es un grand homme ! Si le marbre n'était un hommage
posthume rendu aux fous, on te dresserait une statue de ton vivant. Tu
seras heureux jusqu'à ta mort ! Regarde, je suis inspiré, je prédis ton
avenir. Le dernier jour de tes canailleries, ce sera l'aube de ta
béatification. Grand Maître ! Je ne puis reculer ; si je pouvais, je
serais ton disciple le plus distingué... Je vais prendre un café...
N'as-tu pas vu un plateau noir avec des cigares de contrebande ?... Le
voici qui arrive...
VIII
Si Guilherme do Amaral, d'après sa confession, crédible,
riait au fond
de lui-même, quand il repensait au voyage que les regrets des généreux
habitants de Porto refusaient d'accepter, comment s'explique ce
revirement ? Y aurait-il une raison sérieuse qui l'explique ?
Oui, il ne peut manquer d'y en avoir une. Amaral
partait, las de Porto, sérieusement dégoûté de cette délicieuse
bourgade, qui devait être qualifiée par un João Antunes da Mota de tas
de glaise, il riait alors d'un pauvre étranger, qui ouvre la bouche, en
s'étirant, à s'en décrocher les mâchoires. Il s'impatientait des
retards du paquebot jusqu'au moment où il sortit de l'
Águia d’Oiro, et
se laissa entraîner dans les flots de peuple qui se sont déversés à
Miragaia, la veille de la Saint Pierre.
Quand il alla voir pour la deuxième fois, l'orpheline de
la rue des Arménios, son intention de voyager était restée inchangée ;
il poursuivait ses préparatifs, et l'espoir de passer la barre, en
criant :
fuge crudeles terras, fuge
litus avarum, était toujours aussi
lancinant.
C'est donc Augusta, la pauvre couturière qui cousait des
bretelles, la fille du défunt menuisier, qui passa l'éponge sur la
mappemonde où le voyageur promettait de frayer son chemin en dix ans de
pérégrination, après lui avoir servi un apéritif. Elle avait réussi un
exploit, mais elle l'avait réellement réussi.
Amaral vit cette femme, comme il n'en avait jamais vu
aucune jusque là, à l'œil nu, exempte de la beauté impossible ou de la
monstrueuse difformité des romans, qui n'aurait pas essayé d'abord de
le séduire, sans le double artifice que le désir d'être célèbre lui
aurait enseigné, en ôtant toute liberté à sa nature innocente, crédule
et ouverte.
Cet amour naturel et spontané, né de la simplicité du
cœur, se nourrissant de lui-même, sans s'exposer à l'émulation des
autres, sans avoir recours au jeu des petites misères, autant de mets
qui ravivent l'appétit de la femme blasée, Guilherme n'en avait jamais
éprouvé de tel, et il s'était maintes fois demandé, lui dont l'esprit
etait libre, s'il existait en dehors de l'innocence, ou uniquement dans
les transports des âmes portées sur le fantastique.
La réponse lui était venue d'Augusta, de la femme simple,
de la fraîcheur de ses vingt ans avec toute la sève de ses quinze, du
rose de ses lèvres sans la souillure d'un baiser, de ses yeux d'une
voluptueuse tendresse, comme elle apparaît sans les atours de
l'artifice, des yeux qui n'avaient pas encore versé une larme sur une
illusion perdue.
Le caractère changeant d'Amaral prit pour une réalité ce
qui n'était qu'une nouvelle impression, exagéra le bonheur qui
l'attendait, parce que son cœur, assoiffé d'un véritable amour, et
prématurément vieilli, rajeunissait, s'abandonnait aux joies d'une
affection ingénue, plein de vigueur, tout à fait lavé de la boue dans
laquelle son imposture l'avait enfoncé, s'ouvrant au souffle de l'air
pur, du saint amour qui se nourrit d'espérances, et adore le reflet de
son objet dans le ciel, un lac, une fleur, le matin, dans le silence
des ténèbres, et les rêves plus lumineux que le jour.
Ce qu'il vit en Augusta, c'est tout ce qu'elle pouvait
être, et aussi ce qu'elle ne pouvait pas être. Le génie, épuré par le
désir, prête à la nature des nuances qu'elle n'a pas. La femme, sous le
regard d'un de ces malheureux parias qui vivent loin de nous, pour
s'enfoncer dans le désert de leurs aspirations, se transfigure, se
divinise, c'est le chérubin d'un jour, la lumière éphémère d'une
béatitude impossible sur terre.
C'est ainsi que la couturière, unique par son innocence
entre toutes les femmes qu'Amaral avait connues, apparut à ses yeux.
C'est sur le hasard heureux de l'avoir rencontrée qu'Amaral
réfléchissait quand le journaliste, ponctuel quand on l'invitait à
déjeuner, entra dans sa chambre.
La vérité est expansive ; le mensonge se renferme sur
lui-même, se cache même aux regards des dépravés. Amaral éprouvait ce
qu'il aurait éprouvé à quinze ans, en faisant ses débuts dans la
carrière des passions avec un amour sublime. Il voulait à ce moment-là
un ami, un confident, un homme qu'il aurait associé à son hypocrisie
pour le convertir la vérité des affections pures. Le poète était le
seul qui lui eût été si proche ; mais l'on a déjà dit qu'Amaral, s'en
tenant à la lettre au système qu'il avait ramené de Lisbonne, n'avait
jamais ôté son masque devant aucun homme. Le poète le lui avait arraché
à maintes reprises ; il avait découvert ses traquenards ; il le
connaissait, et lui donnait une preuve exceptionnelle de son estime en
l'espionnant, sans le désigner à la vindicte publique. C'était une
vertu.
Où diable la vertu va-t-elle
se nicher ?
(9)
Après la soirée de la veille dans le salon de Cecília, il
se rendit compte qu'il avait une grosse dette envers le journaliste,
cette langue de vipère, ce satiriste inexorable face à toutes les
vertus hypocrites, mais indulgent envers elles. Cette circonstance
incroyable chez un tel homme lui donnait parfaitement le droit de
susciter la confiance, et, de la part de Guilherme, c'eût été une
ingratitude de la lui refuser.
– Viens, dit Amaral au journaliste, assieds-toi là, sur le
lit. Nous allons parler comme deux poètes de ta force morale, ou de la
mienne.
– Vu que nous allons parler sérieusement, approche, je
préfère me coucher. L'intelligence fonctionne mieux dans une position
horizontale. Je t'écoute.
– Comment expliques-tu la décision que j'ai prise hier de
ne pas partir en voyage ? lui demanda Amaral, avec un sourire fat, et
l'air d'un homme incompréhensible pour tout le reste du genre humain.
– De la même façon que celle de partir demain. Cela ne
retient pas une seconde mon attention. J'en déduis que tu n'es pas un
homme trivial. Concevoir des projets et faire ce qu'on a décidé, c'est
une qualité inhérente aux hommes qui ont autant d'esprit qu'une huître,
et s'accrochent longtemps à la même idée. Je te félicite de ne jamais
savoir ce que tu feras. C'est la marque du talent.
– Il y a une autre explication et plus raisonnable de mon
revirement.
– As-tu été impressionné par une des femmes du dîner
d'hier ?
– Rends-moi justice : je connais ces gens-là depuis un
an...
– C'est ce qu'elles disent à ton propos... Ils... non. De
quoi s'agit-il donc ?
– D'amour.
– D'amour pour qui ?
– Tu ne la connais pas ; c'est une femme du peuple, une
couturière.
– Je connais beaucoup de couturières, en particulier
celles de la Guichard, de la Theodorina et d'Andrillac...
– Ce n'est pas ce genre-là ; c'est une couturière qui
travaille chez elle, et gagne trois
vinténs
par jour.
– C'est un caprice d'un homme fatigué. Tu n'as pas besoin
de me décrire cette femme, je l'imagine plus épanouie et plus belle
qu'elle ne l'est réellement ; je la vois d'une stupide candeur, capable
de s'évanouir si tu lui présentes ton parapluie dans la rue. Elle est
tout ça ; mais ce que tu ressens pour elle, c'est un caprice qui ne
durera que vingt-quatre heures.
– Vraiment ?! Mais si je te dis que je sens en moi, pour
la première fois, les signes d'une passion sérieuse ?
– Je doute de ces preuves, quelles qu'elles puissent être,
et je te dis que cette fille ne constituera même pas une étape de ma
vie sentimentale. Ces femmes exercent un règne qui dure vingt-quatre
heures, et ont sous leurs pieds, un abîme, dans lequel elles tombent
sans laisser le moindre souvenir. Le prophète de l'expérience te parle
par ma bouche indigne. J'ai déjà nourri de telles illusions...
– Tu étais corrompu à ce moment-là ; il ne restait pas une
fibre intacte dans ton cœur. Je n'ai pas encore aimé, j'ai le cœur
solide, mon amour n'est pas une illusion ; la première femme qui
descendra là, doit avoir une grande supériorité sur moi, comme sur
toutes les autres ; elle se perpétuera dans mon existence, elle y
entrera comme un élément de mon être, elle remplira ce vide glacial que
je ressens dans ma vie.
– Te voilà bien, avec les réminiscences toutes fraîches de
ton dernier roman ! D'après moi, tu viens de lire les mièvreries
amoureuses de quelque roué parisien avec une innocente grisette...
Dis-moi donc ; es-tu capable de supporter une idiote vingt-quatre
heures durant ?
– Je ne supporte pas une femme stupide et méchante ; mais
l'ange de la simplicité et de l'amour a toujours des trésors à me
donner qu'elle tire de son cœur, et il y en a tant que je n'en
donnerais pas la moitié pour toute ta science, et celle des femmes
spirituelles, selon toi. Je suis las des précieuses ridicules. Je ne
veux pas de science, je veux de l'amour ; je me passe des dons de
l'esprit qui corrompent ceux du cœur.
– Bien sûr ; j'ai dit tout cela en vers, et beaucoup
d'autres choses. Je conseille aux gens écœurés par le splendeurs de la
société, et de ses amours sensuelles, l'angélique cataplasme d'une
patriarcale jeune-fille, respirant la pudeur et la timidité. Mais je te
dis à toi, qui es un homme compliqué, que ton cœur te ment, si ce n'est
pas toi qui lui mens. Voici une prophétie : aucune femme, Juliette ou
Aspasie, ne remplira ce vide glacial qui te gêne... Voici le déjeuner ..
Le plateau fut placé au milieu du lit ; le journaliste mit
ses jambes autour, comme un amphithéâtre qui s'appuierait aux pieds du
lit ; le provincial disposa les siennes en triangle, et dans cette
posture solennelle et grave, ils poursuivirent leur discussion sur les
profonds secrets de l'âme.
– Je me suis imaginé des délices avec cette femme ! disait
Guilherme. Je sais qu'elle m'aime, sans qu'elle me l'ait dit : c'est
une de ces poitrines transparentes, qui nous laissent étudier le
cœur... C'est un plaisir qui remplirait d'orgueil un imbécile, mais qui
me donne, à moi, une sensation de gloire... Vingt ans, la
virginité de l'âme, la beauté, un terrain en friches avec les germes de
toutes les fleurs en son sein... ma belle captive !
– Tu es délicieux, mais le thé est infect... Ou habite
cette enfant ?
– Là ! répondit Amaral, en posant la main sur son sein,
avec un sourire.
– Joli ! Sois sérieux : je veux voir la couturière,
répondit le devin, la bouche toute grasse de sa côtelette.
– Tu ne la profaneras pas de tes yeux.
– Tandis que tu la sanctifieras de tes mains... Quelle
affreuse distribution des plaisirs ! J'ai noté que nous avons plus
besoin d'une bonne organisation de l'amour, que d'une organisation du
travail... Veux-tu encore de la côtelette ? Elle n'est pas
mauvaise...fais-moi passer le poivre... Ainsi donc, cette petite ne
peut vivre qu'à l'ombre comme le lys de la vallée !... Tu ne lui fais
vraiment pas confiance, ou tu ne t'en fais guère à toi, ou à moi !...
Tu es un ingrat ! Je ne t'ai jamais fait de la concurrence... alors que
j'ai eu mille et une occasions de...
– Et je t'en suis fort reconnaissant, mon généreux ami...
J'ai envers toi des dettes qui ne se paient pas en se contentant de
révéler l'adresse d'une jeune fille.
– Que tu tiens sous ta protection paternelle ?
– Non, je vais m'en occuper.
– Tu vas lui donner une jolie maison à la campagne.
– Parfaitement.
– Entourée de forêts druidiques, où viendront gémir les
brises du soir ; une petite fontaine qui troussera un tercet mélodieux
avec une grenouille et une cigale ; un sofa en liège avec des branches
de lierre sous la verdoyante tignasse d'un saule pleureur... Et elle,
l'épaule nue, un col de cygne, et un bras de Diane chasseresse
s'enroulant volontairement autour d'un cou bienheureux... Le lit
nuptial, ensuite, de contrebande... des tentures blanches,
suspendues au bec de deux pigeons, transparents, avec des peintures
mythologiques d'amours et de grâces, un parfum de chèvrefeuille cueilli
par des doigts d'agate ; un tapis qui étouffe les pas, des pas de fée,
la merveilleuse pression d'une ondine plus légère qu'un songe du matin
; et, pour finir... Le mortel ennui d'un si grand bonheur...
l'implacable désir d'une autre vie... d'une autre sottise.
– C'est un passage de ton feuilleton d'aujourd'hui ?
– C'est le feuilleton de la vie, mon cher Amaral ! La
vérité se cache, sévère et nue, sous les grâces du style. Ce qui a fait
du mal à bien des gens, ce n'est pas le mensonge, c'est l'enveloppe de
paroles artificieuses dont on dore les menottes que les vérités passent
aux poignets de l'homme. En vérité, je te le dis, en vérité, oui, comme
on le dit en Orient, que d'ici un an tu ne seras pas plus heureux, et
que tu auras fait une malheureuse. Laisse cette fille. Ce ne sont pas
des femmes pour nous.
– Pour nous ! le pluriel est absurde. Je t'ai déjà dit que
je ne suis pas mort, j'ai la vigueur de toutes les fois, je crois en la
vertu, j'attends du véritable amour un bonheur durable, je donne à
cette pauvre couturière mon cœur, et elle me le rendra sans les
souillures avec lesquelles je quitte cette société magnifiquement
obscène, indécemment fastueuse.
– Voilà que les adverbes te montent au nez... Ne te fâche
pas. Qu'il en soit selon ta volonté. Je reviens sur mes critiques... Il
arrive qu'un excentrique trouve son bonheur en dehors de la sphère
où gravitent les hommes. La couturière sera la flamme d'un
alchimiste moral. Cherche l'absolu du cœur, comme le héros de Balzac,
mais ne te laisse pas ruiner par lui. Tu trouveras peut-être la vérité
en embrassant une sottise. Que celui de vous qui se croit sage,
embrasse la folie pour trouver la sagesse : ce sont les paroles de
Saint Paul, que j'ai trouvées et introduites comme j'ai pu dans mon
feuilleton où je parle de Catulle et de Jérémie à propos de la Norma .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
IX
Une fois débarrassé du poète, Guilherme do Amaral se
rendit à la rue des
Arménios. Augusta était seule, comme d'habitude. La familiarité avec
laquelle Amaral lui tendit la main l'impressionna ; elle ne lui refusa
pas la sienne ; mais sa rougeur disait combien le procédé lui semblait
singulier et cette liberté gênante.
– Pourquoi rougissez-vous ainsi, Augusta ? Vous serrer la
main, c'est un signe d'amitié, une action innocente, que n'importe
quelle fille peut faire sous les yeux de son père... J'aimerais ne pas
être pour vous, Augusta, un homme qui vous soit si étranger qu'il vous
fasse rougir s'il vous serre la main. Vous ne me répondez pas ? Se
silence signifie-t-il que vous regrettez d'ouvrir votre porte à un
homme que vous ne connaissez pas ?
– Non, Monsieur ; il n'y a rien pour l'instant que je
puisse regretter.
– Et j'espère que ce ne sera jamais le cas ; et, pour vous
éviter d'être injuste avec moi, si quelque soupçon vous inspirait ces
regrets, je dois vous dire dès maintenant que je suis un véritable
ami... Vous ne croyez pas que je suis votre ami ? Regardez-moi,
Augusta, je ne veux pas vous voir aussi gênée ; ou vous vous sentez
avec moi comme avec un frère, ou je ne reviens pas ici.
– Pourquoi ? Je me sens incapable, Monsieur, des mots qui
vous blessent... Je suis à ce point votre obligée....
–
Mon obligée !
Vous m'avez froissé, Augusta, et vous
promettiez de ne pas me blesser !
Mon
obligée ! En vertu de quoi ?...
– Ce n'est pas pour rien...
– Arrêtez ! Plus un mot là-dessus. Vous vous passez
parfaitement de mes services, Augusta, et ceux que je puis vous rendre
ne vous obligent pas à me recevoir chez vous, si, au fond de vous-même,
vous vous reprochez la confiance que vous m'accordez. Ce qui nous
retient, ce ne sont pas les services mutuels, c'est la sympathie, et le
désir d'éprouver nous-même les souffrances et les joies d'une autre
personne. Je ne ressens pour vous, Augusta, que les sentiments que peut
ressentir un père pour sa fille : je souhaite votre bonheur ; je
voudrais vous hisser à la hauteur où votre ambition pourrait s'élever ;
je voudrais enfin vous donner tout ce que j'ai, et être plus que je ne
suis pour vous entendre dire : "Guilherme, je te dois le ciel que tu
m'as fait voir en ce monde."
Augusta n'osait pas regarder Amaral en face. Elle sentait
un tressaillement dans son cœur, comme sous l'effet de la peur. Des
frissons et des vapeurs parcouraient son beau visage, qui trahissait
fidèlement les émotions qu'elle ressentait. Elle aimait et souffrait,
désirait et ne désirait pas entendre ces mots, les uns graves, comme
ceux qu'inspire l'amour paternel, d'autres pénétrés d'une certaine
douceur que l'on ne trouve pas dans les paroles d'un père. Elle ne se
rappelait pas qu'elle était seule et, cependant, il lui semblait que de
telles paroles, il était mauvais qu'une fille seule les entendît.
Heureusement, Guilherme se laissa guider par son inspiration. Ce
n'était pas la duplicité qui l'aidait à tenir ce discours. L'esprit
froid a l'habileté de réchauffer les mots que souffle l'imposture. Chez
lui, non, du moins pas à cet instant. Il dit ce qu'il n'avait jamais
dit dans un jaillissement de son cœur, qui parlait pour la première
fois, dans son langage natif, embaumé de ses propres parfums, avec ses
parures simples, agréable à entendre, point corrompu par la musique de
ceux qui multiplient les conquêtes par affectation.
– Je lâche la bride à mon âme, Augusta, continua-t-il en
lui prenant la main. Notez bien l'assurance avec laquelle je parle...
Cette assurance, il n'y a que l'amour et l'honneur qui la donnent. Je
vous aime, Augusta ; mais cet amour n'exige pas de sacrifices, et ne
recourt pas à des artifices, il ne sort pas du chemin de la vérité,
pour se dissimuler dans les sentiers de l'imposture. Je vous aime
depuis vingt-quatre heures, comme si je vous connaissais et vous aimais
depuis mon enfance. Si vous me dites que cet amour ne peut être
récompensé, je vous baise cette main avec reconnaissance, et je vous
dis : vous avez bien fait, Augusta, d'ôter ses illusions à un homme que
vous pouviez rendre plus malheureux qu'il ne l'est...
– Ne voyez-vous pas que je suis pauvre ? dit-elle, en
retirant sa main tremblante.
– Quel rapport entre la richesse et le cœur, Augusta ?
Vous ne pourriez donc m'aimer qu'en étant riche ?
– Personne ne recherche une jeune fille pauvre... Ça irait
si vous étiez ouvrier dans un atelier. Ma mère disait qu'une fille ne
peut être plus qu'elle n'est, et que, quel que soit le rang
auquel elle s'élevait, elle se retrouvait toujours plus bas qu'elle
n'était.
– Et vous croyez que j'ai la vanité de vous dire que vous
pouvez valoir plus que vous ne valez ? Non, Augusta ; telle que vous
êtes, vous ne pouvez envier aucune femme. Si vous saviez ce que j'ai
été, vous vous considéreriez en ce monde comme la première de toutes
les femmes. Vous m'aimeriez avec dévotion, parce que vous diriez, en
vous voyant tellement aimée, qu'aucune autre ne pourrait produire sur
moi une telle impression... Augusta, nous avons un bel avenir. Soyez
mienne, dites-moi que vous donnez à mon cœur toute autorité sur votre
volonté.
– Je ne comprends pas ce que vous dites, fit la
couturière, effrayée, mesurant le danger de son imprudence.
– Vous ne me comprenez pas ? Dites plutôt que vous ne
m'aimez pas... Vous ne pouvez m'aimer, Augusta ?
La jeune fille baissait les yeux, dans un silence
significatif, lorsque le ponctuel artisan entra, en demandant s'il le
pouvait, avec un pied déjà à l'intérieur de la maison. Augusta
frissonna, Guilherme le fixa d'un air supérieur et agacé.
Francisco, déconcerté par cette surprise répétée, salua sa
cousine en bégayant, sans faire le moindre signe à son hôte, et s'assit
avec une grossière liberté. Guilherme souffrait dans son orgueil, et se
sentait, comme on dit, dans une situation fausse en présence de
l'ouvrier silencieux, et de la couturière gênée. Sa figure à elle
trahissait son anxiété ; celle de son cousin, une colère contenue.
Amaral avait peu d'imagination quand la situation devenait
critique. Il ne lui vint pas quelque futilité pour s'en sortir. On
l'aurait pris, à le voir ainsi, pour un provincial imbécile, tombé dans
un panneau. Il se leva, fit un signe de tête à Augusta, et dit, le
sourcil levé, en regardant l'artisan avec mépris.
– Bonsoir, Mademoiselle.
L'on n'a jamais entendu parler d'une fin aussi prosaïque
pour une scène aussi prometteuse ! Augusta avait baissé la tête, pour
le saluer, sans lui répondre. Francisco, les coudes sur les genoux,
roulait une cigarette, et continua jusqu'à ce que son hôte disparût.
– Que te veut cet homme ? demanda Francisco brutalement.
– Que peut-il me vouloir ? Il est passé par là et il est
entré.
– Tu veux que je te dise, cette rue n'est pas habituée à
voir passer de tels passants... On pourrait mettre la main au feu que
tu ne sais pas ce qu'il veut ?
– Moi ? Non...
– Il ne te l'a donc pas dit ?
– Il ne m'a rien dit. Qu'est ce qu'il pourrait dire ? !
– On te dirait née de la dernière pluie... Tu crois qu'il
n'y a rien là-dessous ? J'ai tout de suite vu que les deux pièces
apportaient de l'eau à son moulin... Le contraire m'étonnerait... L'on
ne donne rien pour votre bonne mine... Je te dis de prendre garde,
Augusta.
– Je me garde bien toute seule... Tu me connais bien mal,
Francisco, je te le dis.
– Ce sont là des fariboles, ma fille... Qui me prévient,
est mon ami... Si je te dis ça, c'est que j'ai l'impression au fond de
moi-même que cet homme ne vient pas seulement voir comment tu vas.
– Laisse-le faire... Avec moi, il se trompe.
– C'est ce qu'elles disent toutes, et c'est au moment de
laver son linge qu'on fait ses comptes.
– Que veux-tu donc que je lui dise ? De ne plus revenir
ici ?
– Je trouve que c'est le plus sûr.
– Ça, il ne faut pas y compter. Je ne suis ni mal élevée,
ni ingrate. Un homme qui m'a secourue dans ma détresse, quand je me
trouvais ici avec le corps mort de ma mère dans les bras, enfermée chez
moi, et qui est allé, en plus, chercher la mère Ana do Moiro, et m'a
fait l'aumône de trois pièces, je vais lui demander de sortir de chez
moi ? C'est une chose que je ne ferais pour rien au monde... Que Dieu
m'en préserve !
– Et s'il te dit qu'il t'aime et te séduit comme font ces
messieurs avec les filles pauvres, comme toi ?
– S'il me séduit !... Et tu sais, toi, qu'il veut me
séduire ?!
– J'en ai l'impression.
– Pourquoi ?
– Parce que tu es jeune, jolie, et que tu vaux bien trois
pièces.
– Tu n'as pas le droit de dire cela ! Tu es une mauvaise
langue ! Aucun homme ne peut parler à une fille sans que ce soit pour
la séduire ! Et s'il a de l'amitié pour moi ?
– Ah ! Tu en es à ce point ? Elle est bien bonne ! Ne
cours pas au-devant des ennuis, Augusta. Fais attention... Je te le
dis, il ne se mariera pas avec toi !
– Est-ce que je t'ai dit qu'il voulait se marier avec moi
? !
– On prie ses saints le dimanche... Ton cœur est déjà
atteint par cette maladie... Si tu veux mon avis, cet homme t'a déjà
rempli la tête de toiles d'araignée... Tu as reçu ta part... On va voir
pourquoi ta mère t'a mise au monde... Si elle était vivante, cet homme
ne viendrait pas ici... Tu lui feras bien plaisir avec un tel
amoureux... Le temps viendra ou tu t'en mordras les doigts, et tu n'en
tireras pas une goutte de sang...
– Reprends-toi, Francisco ! Ne me fais pas de la peine !
Je n'ai encore rien fait qui puise entraîner ma perte.
– Mais ça peut t'arriver...
– La grâce de Dieu ne va pas m'abandonner...
– Ça dépend de toi, Augusta. On dirait même que le diable
y met du sien ! Je veux me marier avec toi pour que tu puisses manger à
ta faim, et tu fais la fine bouche ; un crétin apparaît, qui te donne
deux pièces comme ça, pour rien, et tu le reçois chez toi, tu
t'imagines que ce petit saint se promène dans le monde en distribuant
des pièces aux jeunes filles pauvres... Peut-être, peut-être ; mais le
pire, c'est ce qui t'attend...
– Seigneur Jésus, tu me fais perdre la tête ! Que dois-je
faire ?
– Veux-tu que je lui dise de ne pas venir ?
– Tu sais donc où il habite ?
– Oui. Je l'ai vu entrer dimanche dans une auberge à
Batalha, et j'ai demandé s'il habitait là ; on m'a dit que oui.
– Et qu'as-tu appris de plus sur lui ?
– J'ai appris que c'est un fidalgo de la Beira, très
riche, qu'il a des laquais, on lui donne de l'Excellence à l'auberge.
– Mais il n'est pas marié...? fit la couturière dans un
élan subit.
– Elle s'y croit vraiment ! Tu te demandes déjà s'il se
mariera avec toi ! Mais bien sûr !... On lira les bans dimanche...
c'est sûr que tu les as lus !... Arrête avec ça, Augusta, pendant qu'il
en est temps... Veux-tu que je lui dise de ne pas venir chez toi ?
– Non...
– Non ! Tu n'as pas besoin de me le dire deux fois... Tu
aimes ce gandin ?
– Je ne l'aime pas et je ne renonce pas à l'aimer... Le
choses se passent autrement... Je sais ce que je vais faire. Ne
t'inquiète pas de la façon dont je mène ma vie...
– Ne te fâche pas, ma fille... Tu es dans ton droit. Ce
que je te dis, après tout, ce ne sont que des mots jetés au vent... Tu
t'en repentiras... Que Dieu te garde...
L'artisan allait sortir, quand sa cousine le prit par le
bras, en pleurant.
– Viens, Francisco, ne deviens pas mon ennemi.
– Comme si je l'étais !... Si je n'étais pas ton ami, je
te dirais de faire des bêtises, et de mordre à l'appât qu'il a accroché
à l'hameçon des ces fameuses deux pièces... Réfléchis, et fais ce que
tu voudras. Je resterai ton ami jusqu'à la mort... Quand tu viendras me
chercher, tu me trouveras... Si tu ne veux pas te marier avec moi,
conduis-toi comme il faut, ce ne sont pas les maris qui vont te manquer
; mais un linge avec une tache ne vaut plus un clou... Au revoir,
Augusta, c'est l'heure d'aller travailler...
La couturière, restée seule, pleura beaucoup. Et quelles
larmes ! Les premières, les prémices du fiel que paie un premier amour
! La pauvre, cette fascination était invincible ! Le premier rayon de
soleil a fait éclore cette fleur complètement, tous les parfums
montèrent de son sein, elle ne cacha pas une seule goutte de son nectar
à la première abeille qui se posa.
Mais la prophétie inexorable et brutale de l'artisan
représentait pour elle comme la prédiction d'une chute inévitable. La
générosité de Guilherme lui sembla un moyen de l'obtenir ; et les
visites qui avaient suivi, et les paroles qu'elle avait entendues, une
heure avant, tout venait confirmer les soupçons de Francisco. Voyez
comme il en faut peu pour tuer l'innocence !
Aussi femme que les autres, Augusta voulait bien douter
des intentions de Guilherme ; mais elle ne voulait pas que d'autres les
découvrissent. Elle voulait avoir à lutter contre la tentation ; mais
elle ne voulait pas que son cousin la devinât. C'est donc ainsi que la
conscience transige avec elle-même, et c'est souvent l'opinion des
étrangers que réveille l'inquiétude et les remords.
Une heure de pleurs et de réflexions devait précéder
n'importe quelle décision. Augusta ferma sa porte, et franchit celle de
la mère Ana do Moiro.
– Qu'est-ce qui t'amène, Augustinha ? Tu m'arrives avec
des larmes plein les yeux ? C'est ton maudit cousin qui te harcèle ?
Envoie-le au diable, Dieu me pardonne, si c'est un péché.
– C'est autre chose, mère Ana... Ne m'avez-vous pas dit
souvent que ma mère...
– Que Dieu la garde...
– Que vous vouliez lui acheter la maison ?
– Oui, et cela ne m'arrange pas de la récupérer, après ce
qu'on dit les spécialistes. Et tu veux la vendre ?
– Je vais vous parler franchement, mère Ana ; j'ai besoin
de trois pièces ; si je vous les rends dans les six mois, avec les
intérêts, je garde la maison, sinon, vous me donnerez ce qui manque,
étant entendu que je reste chez moi, tant que je vivrai, en vous payant
un loyer.
– Tout est possible ; mais pourquoi diable as-tu besoin de
vendre ta maison ?
– J'ai besoin d'argent...
– J'ai mis dans le mille ! Si tu veux mon avis, tu as eu
des histoires avec ce monsieur qui t'a donné les deux pièces, et tu
veux les lui rendre... Vas-y, parle, ma fille... Tu sais bien que ce
qu'on me dit, c'est comme une pierre qu'on jette dans un puits.
Augusta ne put retenir ses larmes ; et comme si elles ne
suffisaient pas elle avoua tout à sa roublarde voisine pour qui les
intentions du généreux protecteur de la jeune fille étaient mauvaises,
avant qu'elles le soient.
– Ce ne sont que de petites fâcheries, ne t'inquiète pas !
fit la fille du Maure, jouant de l'entendue.
– Vous vous trompez... dit la couturière en sanglotant,
blessée par les suppositions de sa voisine. Il n'y a aucun arrangement
entre moi et ce monsieur...
– Non ?! répondit ironiquement la poissonnière. J'aurais
juré qu'il était fou de toi ! Ça fait deux jours que je le vois entrer
chez toi toujours à la même heure, ta réputation est faite, ma fille...
– Seigneur Jésus ! Ma réputation est faite ? On parle de
moi ?!
– Bien sûr que oui... Tu pensais donc que les voisines
n'ont pas d'yeux ?!... On ne passe pas son temps à garder les chèvres...
– Je veux bien devenir aveugle, mère Ana, si j'ai
fait quoi que ce soit pour la perdre !
– Bien sûr, bien sûr, mais qu'est-ce que tu veux ? Va-t-en
mettre la main sur le bouche de tout le monde ! Moi, si j'étais toi,
j'en aurais rien à faire que l'on parle ou non. Tu es libre ? Tu n'as
ni père, ni mère ; chacun s'arrange comme il veut. Est-ce qu'il a de
l'amitié pour toi ?
– Comment voulez-vous que je sache s'il est mon ami ou pas
! Peu m'importe qu'il le soit, ou non... Allez-vous me prêter cet
argent ? Finissons-en...
– Je t'ai déjà dit que je le ferai, tu peux compter
là-dessus, mais je veux que tu me dises ce qui s'est passé. Tu peux
faire ce que tu voudras, tout finit par se savoir...
– Je vais tout vous raconter, mère Ana. L'homme dont on
parle s'appelle Guilherme, il n'est pas de Porto, il se trouve dans une
auberge de Batalha, et c'est un fidalgo.
– Bravo ! Mais tu voudrais qu'il soit encore mieux ?!
– Laissez-moi parler... Il a dit qu'il m'aimait fort,
qu'il éprouvait pour moi l'amour d'un père, et qu'il voulait me rendre
heureuse.
– Voyez-moi cette petite folle ! Et tu ne...
– Je ne lui ai rien dit dans un sens ou dans l'autre... Il
m'a dit des choses qui m'ont fait pleurer, et je ne sais pas
pourquoi... En même temps, ça me faisait plaisir de l'entendre parler
de cette façon. Il me faisait peur, et je ne voulais voir personne à
côté de moi ; c'était, je ne peux pas vous dire ce que c'était. Rien
que de penser à lui, ça me faisait oublier ma mère. J'ai l'impression
que je devinais quand il venait ; mon cœur tremblait, et une chaleur me
montait au visage, et ce n'était pas la fièvre. Quand il a dit
aujourd'hui qu'il éprouvait de l'amour pour moi, j'ai senti une joie,
là, au fond de moi-même, qui me rendait folle. Et puis mon cousin et
entré, et il est resté, lui, un moment sans dire un mot, et il est
sorti, l'air contrarié. Francisco a commencé à me dire que ce qu'il
voulait, c'était me séduire, et m'abandonner. Je n'ai pas pu m'arrêter
de pleurer, mère Ana !
– Laisse-le dire... Francisco, ce qu'il veut, on le
sait... Il arrive, Augusta, que ces hommes riches épousent des filles
pauvres, et ils ont beaucoup d'affection pour elles. Rien que parmi mes
connaissances, il y en a trois, mariées à Porto avec de grosses légumes
; l'une, qui servait comme bonne chez les dames Lacerdas, est baronne ;
une autre, qui avait un petit bureau de tabac, rue do Príncipe, est
mariée à une huile qui s'occupe de trucs et de machins au gouvernement,
elle m'a acheté beaucoup de poisson à crédit, quand son ami était à
l'étranger, il avait émigré, elle roule carrosse, et fait comme si elle
ne me connaissait pas... ça arrive dans le monde... Mais dis-moi ce que
tu veux faire maintenant.
– Je veux lui donner trois pièces, et je ne veux pas qu'il
revienne chez moi.
– Tu l'aimes donc ?
– Je l'aimerais, s'il avait de bonnes intentions ; mais,
comme dit mon cousin, ces messieurs ne se marient pas avec des filles
comme moi.
– À ta guise, Augusta... Je ne vais plus te dire un mot
là-dessus. L'argent, je vais te le donner dès maintenant, si tu le veux.
– Oui, s'il vous plaît... Dites donc, mère Ana, est ce que
ce sera mieux de le lui envoyer ?
– Comme tu voudras ; si tu veux, je vais le lui apporter,
moi.
– Je veux bien...mais ce serait mieux qu'il le reçoive de
ma main... Qu'il ne prenne pas cela comme un affront...
– C'est bon...
– Et lui, après ça, il ne reviendra plus chez moi.
– Si tu le mets à la porte, comment pourra-t-il revenir ?!
Seulement s'il n'a aucun amour-propre.
– Mais je ne voudrais pas l'offenser...
– Ô ma fille, je ne comprends rien, que Dieu me vienne en
aide ! Tu veux qu'il vienne ou qu'il ne vienne pas ?
– Je voudrais qu'il ne vienne pas ; mais cela ne me ferait
rien s'il avait de l'amitié pour moi.
– Comment veux-tu qu'il en ait sans te voir ? Loin des
yeux, loin du cœur.
– Je voudrais qu’il...
– Dis-moi ce que tu voudrais, ne meurs pas en avalant ta
langue... Il faut parler pour s'entendre...
– Je voudrais qu'il vienne chez moi de temps en temps ;
mais je voudrais ne rien lui devoir...
– Eh bien, rends-lui ses trois pièces ; mais attention, il
peut ne pas les accepter.
– Non, je vais les lui envoyer.
– Là, c'est différent, mais après ça, ne l'attends plus...
– Cela revient au même... Donnez-moi cet argent...
– Attention, ma fille ; ne tourne pas le dos à la
fortune... Elle peut venir une fois, et ne plus revenir...
– Quelle fortune ?!
– S'il veut te rendre heureuse, va de l'avant...
– Ne me donnez pas de ces conseils, mère Ana... J'ai peur
que ma mère ne vienne de l'autre monde me faire des reproches...
– Fais ce que tu voudras, Augusta.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La couturière sortait de chez sa voisine avec ses trois
pièces, quand pour le troisième fois Guilherme frappait à sa porte.
S'il ne l'avait pas vue, Augusta se serait cachée, tels étaient son
trouble et la crainte dont elle avait été tout à coup saisie. Il était
trop tard pour s'enfuir. Elle avançait sans voir où elle marchait. La
mère Ana, de sa fenêtre, fit familièrement à Amaral un signe, auquel
il répondit. Par cette mimique, elle disait : "Comptez sur moi,
en cas de besoin."
La mère Ana avait négocié l'honneur d'Augusta comme son
père avait négocié la vie du chancelier.
Levant à peine les yeux sur Guilherme qui s'était
courtoisement écarté sur le pas de la porte, Augusta entra chez elle,
en oubliant, ou en ignorant les égards qu'elle devait à cet hôte.
– Vous permettez, Augusta ? dit-il avec une timidité
incongrue.
– Si vous voulez bien entrer...
– Je viens vous rendre la paix que je vous ai volée, mon
enfant. J'ai voulu vous rendre heureuse, et je ne l'ai pas pu. Je suis
entré dans cette maison dans l'intention de faire une bonne action, et
je me retire en vous inspirant, au lieu de l'amitié, de la haine ; au
lieu d'être regretté, je serai oublié. Il eût mieux valu que je
n'entendisse pas vos cris, Augusta, quand je me suis engagé dans cette
rue, guidé par le hasard. Ç'a été pour nous deux un malheur que je vous
visse. Pour moi, parce que je vous aime passion-nément ; pour vous,
Augusta, qui vouliez peut-être m'aimer et ne le pouvez pas. Quelqu'un a
pris possession de votre cœur avant moi. Je n'éprouve aucune haine
contre celui qui vous mérite, qui qu'il soit. Si c'est votre cousin,
soyez heureuse avec lui...
– Mon cousin ! s'écria-t-elle, en frémissant d'émotion.
Vous vous trompez sur moi, Monsieur...
– Eh bien, si ce n'est votre cousin, qu'importe qui
c'est...
– Il n'y a personne.
– Personne ? Pourquoi mentir, Augusta ? Vous n'avez pas
besoin d'essayer de me tromper... C'est un autre amour qui ne vous
permet pas de voir toute l'estime que j'ai pour vous, le bonheur que je
vous prépare, et le mépris que j'éprouve pour toutes les choses de ce
monde depuis que je vous connais, Augusta ; dites que vous ne pouvez
m'aimer parce que vous en aimez un autre.
La couturière laissa voir, dans toute sa splendeur,
l'éclat de ses yeux intelligents, qu'elle fixait sur le visage
insinuant de Guilherme.
– Vous allez me dire la vérité... continua-t-il, vous
allez me dire que vous ne pouvez pas être à moi, parce que vous
appartenez à quelqu'un d'autre.
– Je n'appartiens à personne, je vous l'ai déjà dit...
– Mais votre cousin, il y a peu, s'est montré fâché de me
rencontrer ici...
– Mon cousin n'est rien pour moi... Vous savez qu'il veut
m'épouser, et moi je ne vais pas me marier avec lui...
– Ni avec un autre ?
– Avec un autre ? Je n'en sais rien... Cela dépend de ce
que mon cœur me dira...
– Et sur moi, votre cœur ne vous dit rien...
– Sur vous ?... Si j'étais riche, ou vous pauvre comme
moi...
– Vous voudriez être ma ?...
– Votre femme... bien sûr que je le voudrais...
– Alors, si je ne vous déplais pas autant que je croyais...
– Ça n'a jamais été le cas...
– Et vous m'aimez ?... Vous ne me répondez pas ? Avez-vous
ressenti pour un autre, ce que vous ressentez pour moi ?
– Jamais !
– Jamais ? Vous me le jurez ?
- Par cette lumière qui m'éclaire.
– Pourquoi ne me dites-vous donc pas que vous êtes à moi ?
Pourquoi ne me suivez-vous pas ? Pourquoi ne quittez-vous pas cette
maison pour une maison où vous disposeriez de tout ce qui procure le
bonheur en ce monde ?
– Partir d'ici ? !...
– Pourquoi hésitez-vous à quitter une maison qui n'est pas
digne de vous ?...
– Les choses ne se font pas aussi vite... Avant
cela...
– Avant cela, quoi ? Dites-le moi...
– Vous pouvez fort bien me comprendre... Je veux vivre
d'une façon honorable... Et, quand je partirai d'ici, ce sera pour
entrer dans une église...
– Tout de suite ?
– Quelles sont donc vos intentions ?
– Celle de vous adorer... et plus tard...
– L'on me le disait bien... Ce que vous voulez, c'est
faire mon malheur... Eh bien, non. Tant que je pourrai travailler, je
vivrai honorablement comme ma mère a vécu ; quand les forces me
manqueront, je demanderai l'aumône.
– Cela veut dire que vous ne m'aimez pas...
– Que voulez-vous que je vous dise ? Si aimer, c'est
travailler à perdre une jeune fille, c'est un méchant amour, que le
vôtre...
– Et c'est moi qui travaillerais à vous perdre ? Ne vous
fiez pas, Augusta, aux mensonges de votre cousin. Remettez-vous en à
moi, et accordez à ma volonté la noble récompense de faire de vous mon
épouse, quand un certain temps se sera écoulé... Avant d'être ma femme,
permettez-moi de bien connaître votre caractère ; et s'il correspond à
l'idée que je me fais de vous, je vous ferai la maîtresse de tout ce
qui est à moi, sous les yeux du monde, parce qu'à mes yeux, vous l'êtes
déjà...
– Et si mon caractère ne vous convient pas ?
– Il me conviendra.
– Mais supposez que non. Combien de personnes semblent
être ce qu'elles ne sont pas !...
– Si ce malheur arrivait, Augusta, vous n'auriez jamais
besoin de travailler.
– Pourquoi ?
– Je vous donnerais une dot avec laquelle vous pourriez
vivre indépendante...
– C'est maintenant que je comprends tout, répondit-elle,
comme si elle se réveillait au bord d'un abîme. J'ai vu ce que vous
voulez... Je ne suis pas à vendre... J'ai vingt ans, mais je sais, pour
l'avoir entendu dire, comment va le monde. Ma pauvreté me convient, je
n'envie personne, et c'est pour cela que j'accepte vos services, parce
que je n'en ai pas besoin.
– Ne soyez pas ingrate, Augusta... Je ne vous ai jamais
rendu de services, vous devez juste être reconnaissante au désir que
j'éprouve de vous être utile...
– Vous m'avez rendu des services dont je vous suis très
reconnaissante. Vous m'avez remis trois pièces d'or, mais les voilà,
vous me pardonnerez si je vous les rends en argent...
Amaral recula devant cette main qui lui tendait cet argent.
– Vous me blessez cruellement, Augusta ! Je ne
mérite pas ça de votre part!
– Ce n'est pas pour vous blesser ! J’étais dans le
besoin, je n’y suis plus. Acceptez s’il vous plait
– Je n’accepte pas.
– Pour l’amour de Dieu, prenez cet argent...
– Ne me traitez pas ainsi Augusta, si vos scrupules et
votre honneur vous empêchent d'accepter cet argent, donnez-le de ma
part aux pauvres ; mais, songez à qui vous parlez, dites-moi
plutôt que vous me renvoyez, je ne reviendrai pas ; ce que je ne puis
souffrir, c'est qu'on me mette à la porte comme un vil créancier...
– Je ne vous demande pas de sortir, Monsieur, dit-elle en
l'interrompant, fondant en larmes.
– Quelle est donc cette façon de traiter une personne,
qui, si elle n'a fait pour vous rien de bon, ne vous a fait non plus
aucun mal ? J'ai dit que je vous aimais ; c'est ça qui vous a blessée ?
– Non, Monsieur...
– Je vous ai dit que je voulais vous rendre heureuse avec
mon amour, avec ma richesse, qu'elle soit petite ou grande... C'est
cela qui vous a blessée?... Répondez-moi, Augusta...
– Vous voulez faire de moi votre "amie", et pas votre
épouse.
– Mon
amie !
Comme je serais heureux si je pouvais faire
de vous mon amie...
– Vous voulez m'aimer d'une façon qui m'empêcherait de me
montrer à visage découvert... Tout le monde va dire... "Cette fille est
l
'amie du sieur..."
– Qu'ont-ils à dire ? Que vous importe ce qu'ils vont
dire, Augusta, si vous ne vivez que pour moi ?! Si je devais être
maltraité par mon père, par ma famille, par mes amis, par tout le
monde, votre amour me suffirait, Augusta, parce que je n'aurai que
mépris pour tout ce qui ne vous respecterait pas... Vous êtes persuadée
qu'il n'y a que le mariage qui fasse le bonheur et garantisse l'honneur
d'une femme ? Vous vous trompez complètement, et vous avez raison,
parce que vous ne savez pas le monde. La femme mariée n'est pas
heureuse quand elle ne se résigne pas aux inclinations de son mari, et
vit un continuel enfer derrière ses portes. La femme mariée n'a pas
d'honneur lorsque, poussée à bout par un mauvais mari, elle oublie ses
devoirs, ou juge qu'elle n'en a aucun envers un mari qui ne respecte
pas les siens. Vous me comprenez, Augusta ? Vous n'avez jamais entendu
dire ce que je vous dis ?
– De qui aurais-je pu entendre de tels discours ? Je ne
connais que mon cousin, et plaise à Dieu... que je ne connaisse
personne d'autre...
– Il est bon que ce soit à moi de vous ouvrir les yeux,
pour que vous voyiez les choses comme elles sont ; si ce n'était pas
moi, il se pourrait qu'un autre vous en fasse faire l'expérience, ainsi
que le remords. Pas moi. Je vous dis cela, parce que je suis sûr que
vous ne m'appartiendrez pas. Je voudrais pouvoir vous prévenir contre
les tentations de quelque séducteur qui viendrait, après moi, troubler
votre douce tranquillité. Je vais donc m'en aller, Augusta, et vous
serez heureuse...
– Heureuse !... je ne pourrai plus jamais l'être... C'est
pour cela que je dis qu'il aurait mieux valu que je n'aie jamais connu
que mon cousin... Il ne me faisait, lui, ni du bien ni du mal.
– Quel mal vous ai-je fait, moi ?
– Je ne sais pas, Monsieur Guilherme
– Vous voulez dire que je vous ai blessée, c'est ça ?
– Vous m'avez rendue malheureuse... Je ne pourrai plus
trouver le repos... pas si je vous revois...
– Tu es un ange, Augusta ! s'exclama Guilherme en lui
baisant la main et en réprimant le flot de paroles qui jaillissait sous
l'effet d'une joie qu'elle n'aurait pas comprise.
Peut-être comprenait-elle ! Amaral avait l'impression que
non. L'on voit bien comment, durant ce long dialogue, il s'efforçait de
se mettre à la courte portée d'une couturière. Le provincial ne savait
pas qu'il y a des trésors d'intelligence chez la femme, une sorte de
divination, une soudaine lumière qui illumine son entendement, quand
résonnent à son oreille inculte les paroles d'un amant, et leur magique
harmonie.
Entre parenthèses, j'ai dit un jour à une fille de la
campagne (ou à une paysanne) des choses monstrueusement tendres dans le
style des drames. Je crois même que j'ai mêlé, dans ma poignante
allocution, un fragment des Deux Rénégats, une tragédie à la mode, La
jeune fille me fixait de ses yeux effarouchés par le pénétration de sa
propre intelligence. Et elle me comprit, je crois. Pour vous aider à
comprendre ce phénomène, j'évoquerai la belette qui fut, un autre jour,
clouée sur place en entendant un arpège que je jouais au violon.
Hei mihi ! qualis erat !
X
Cédant sa main au baiser chaste et fervent, Augusta sentit
son sang
s'échauffer au feu de ces lèvres. Elle n'avait pas le cœur de retirer
sa main, ni Guilherme la volonté de la lâcher. Si elle avait fait là
une grande concession, elle ne manifestait aucun repentir ; si c'était
peu au regard du bonheur qu'elle ressentirait, elle n'en demandait pas
plus. C'était le transport mutuel de deux âmes, qui auraient dû gagner
le ciel unies de la sorte, si à cet instant la mort leur avait ôté leur
matérielle dépouille. Mais la mort n'aurait pas eu cette audace, en les
voyant à ce point enivrés des éphémères délices de la vie. Ce qu'elle
ferait, c'est passer son chemin, souriant de la brièveté des
jouissances humaines, et de la soif insatiable de l'âme, tant qu'elle
ne dénoue pas les nœuds, qui la tiennent attachée à la source des eaux
impures d'ici bas.
Et les lèvres avides de Guilherme continuaient à savourer
je ne sais quelles douceurs dans la main extraordinairement délicate de
la couturière. Le désir anxieux de nouvelles délices s'exacerbait.
Comme l'abeille qui saute d'une fleur à l'autre, l'amant assoiffé
chercha à assouvir sa faim d'idéal dans les lys de son cou d'une
blancheur extrême. À ce geste inattendu, Augusta répondit par une
expression trahissant son amertume ; mais elle ne s'enfuit pas.
Ceinturée par un bras convulsif, elle trembla comme le bras qui
l'enlaçait, mais pour une raison différente. En sentant sur son cou le
frôlement rugueux d'une moustache, et la chaleur corrosive de ses
lèvres, elle fit un violent effort, se dégagea de ses bras, et s'enfuit
alors, rouge comme une grenade, tendrement froissée, comme Haidée dans
l'un des chants de Byron, que je ne cite pas textuellement, car ce
n'est pas une des choses les plus morales que je connaisse.
– Augusta ! dit Amaral, sans la poursuivre, ne me tourne
pas le dos ! Regarde-moi... Ne trouves-tu pas vraiment agréable le tu
dans la bouche d'un homme qui t'aime ? Adresse-toi à moi de la même
façon. Dis-moi à présent : "Tu es mon Guilherme... et je suis ton
Augusta". Tu ne veux pas me le dire ? Méchante ! Je ne veux pas, moi
non plus, vous dire tu...
– Adressez-vous à moi comme vous voudrez ; mais moi... je
ne dois pas...
– Tu le dois, Augusta. Je ne suis pas que ton frère, et
ton ami ; je suis plus que ton mari, je suis à toi, de toute mon âme et
de tout mon cœur, à toi pour toute la vie, bien que tu ne sois pas à
moi... car tu ne l'es pas ?
– Je suis... une malheureuse, si vous voulez que j'en sois
une...
– Moi ! Je pourrai te rendre malheureuse ? Tu te
repentiras un jour de ce que tu me dis... Quand tu n'auras rien à
espérer dans cette vie, tu regarderas avec tristesse ce que tu as été
avant de me connaître. Augusta ! Dorénavant il n'y aura aucune femme
qui n'envie ton sort. Il y en a beaucoup qui en te voyant, belle comme
tu es, se mordront les lèvres de rage. Tes vêtements seront les plus
riches, ta maison la plus élégante, tes désirs les plus vite devinés.
Je t'adorerai comme une femme à qui je dois le bonheur que toutes les
autres m'ont volé. Tu seras mon ange gardien. Je ne te quitterai pas
d'un pas. Tu es née femme, je ferai de toi une dame. Avant un an,
tu ouvriras un livre à mes côtés, et tu liras les infortunes des
malheureux amants, alors que rien, dans notre sort, ne fera penser au
leur. Au bout d'un an, tu ne te reconnaîtras pas. Formée par mon amour,
tu seras tout ce que peut être une femme de haute naissance. Tu
entreras dans un salon, et celles qui ne t'auront pas connue rue des
Arménios, demanderont d'où est venue une femme si belle et si
spirituelle. Ce sera alors que tes yeux, pleins de larmes de
reconnaissance, trouveront dans les miens l'orgueil de te posséder...
Dans son exaltation, Guilherme oublia qu'il parlait avec
une couturière, et il s'en fallut de peu qu'il ne se perdît dans la
nébuleuse phraséologie avec laquelle il avait conquis Cecília, enivré
Margarida, étourdi bien des têtes folles.
Détail surprenant, la couturière l'entendit sans avoir
besoin de dictionnaire ! Elle aurait pu répéter plus ou moins les
expressions somptueuses qui l'enchantaient ! Elle aurait marché, comme
les pierres sur les traces d'Amphion, au son de sa lyre, sur les
siennes au son de son harmonieuse parole, même si c'étaient des fleurs
au milieu desquelles se cache une vipère.
Mais ce n'était pas le cas.
Guilherme do Amaral n'avait jamais été aussi sincère. Son
cœur, sa foi, ses espoirs et son orgueil, étaient tout entiers dans
cette perspective de bonheur, peut-être mensongère comme toutes les
perspectives généreusement farcies de promesses.
S'il se trompe, ce n'est pas sa faute : accusez-en la
nature inconstante. Si elle ment, comment sa victime pourrait en être
responsable ! Il ne suffit pas à l'homme d'être trahi par elle ! Qui
perd, sinon le pauvre rêveur qui se berce de bonheurs impossibles ! On
le tient pour mauvais, parce que ce malheureux ne trouve pas les
jouissances durables que l'imagination lui présente ? On le condamne
parce qu'il est dévoré de passions incessantes et vieillit dans sa
jeunesse ? Injurie-t-on le voyageur altéré dans un désert, parce qu'il
ne trouve pas une goutte d'eau ?
XI
Le journaliste était prophète. Les anciens visionnaires,
c'est la
sainteté qui les a faits ; la corruption fait les prophètes
contemporains. Chez l'homme usé, les illusions s'évanouissent,
l'expérience reste. Or l'expérience est le sixième sens, l'intuition
lumineuse de l'avenir, la prescience des infaillibles inductions d'un
principe immoral. C'est l'unique supériorité des corrompus sur les purs.
Vous souvenez-vous, cher lecteur, des confidences intimes
de Guilherme à son commensal à l'
Águia
d’Oiro ?
Le poète devançait les projets du provincial,
dessinant les contours de l'architecture romanesque de la maison où
l'ensorcelante couturière compterait, avec les palpitations de son cœur
les minutes de l'existence enchantée de son éphémère amant.
Pour vérifier l'importance de la prophétie du journaliste,
partons sur les traces d'Augusta. Pas rue des Arménios. La mère Ana do
Moiro, dans une conversation avec l'artisan Francisco, dit qu'Augusta
avait fermé sa porte, emporté la clé, précisément le lendemain du jour
où elle lui avait demandé de lui rendre les trois pièces. L'artisan
pleurait comme un enfant, auprès de la fille du batelier, qui n'était
pas à même, et n'avait pas envie, de le consoler. Pour tous les deux,
il allait de soi qu'Augusta s'en était remise à la discrétion de
Guilherme, personne ne savait cependant où elle était. Sous le coup de
la jalousie et de la colère, il était allé à l'
Águia d’Oiro se
renseigner sur ce client ; mais les domestiques lui dirent le plus
laconiquement qu'ils purent, que monsieur Amaral avait quitté l'auberge.
Je me dois de vous raconter ce que l'artisan ne savait
pas, non plus qu'Ana do Moiro et les serviteurs de l'auberge.
Vous savez où se trouve le Candal ?
C'est la colline pittoresque qui se dresse derrière les
ruines d'un château, d'où Gaia, la belle mauresque, regardait la flotte
de son ravisseur chéri, un Goth, d'après la mythologie de cette
merveilleuse région de l'Occident. Comme des linges pendant à un fil,
au loin de riantes maisons jettent leurs taches blanches, elles
regardent Porto fièrement, avec la prestance de campagnardes
fraîches, des fleurs dans les cheveux, sans envier les péristyles de
porphyre, les mosaïques de ses murs altiers et de ses opulentes grilles
de bronze. De chaque ravin de la montagne hautaine jaillissent les
flots d'une eau argentée, qui se déversent sur l'immense tapis
d'émeraude qui vient du pied des édifices, si limpide, pour se salir
dans les ruelles immondes de Vila Nova, une taverne qui donne du
vin à tout le monde, immonde comme aucune autre taverne au monde.
Fuyons d'ici vers les hauteurs. Là oui. De chaque touffe
de chèvrefeuille, vous croiriez voir, couverte de rosée, surgir
une dryade, adossée à l'urne des eaux, qui murmurent entre les
buissons. La poète s'élève de là dans les extases de l'idylle à tous
les cieux d'une imagination rajeunie. Les cantiques de Sintra, chantés
là, semblent siens. Les fameuses amours de deux poètes qui ont pleuré
ailleurs, Bernardin et Camões, se conçoivent ici, s'expliquent, entrent
dans l'esprit comme un morceau de douleur suave, et de la saudade
lucide des amours d'un autre temps. Vous ne savez pas ce qu'est le
Candal, si vous ne le voyez pas ainsi.
Guilherme était un jour passé par là, quand le soleil
plongeait dans la mer, déposant sur l'océan un large tapis d'argent,
plein de scintillantes écailles. C'était le moment de s'abandonner à la
saudade, et à de fiévreuses méditations, l'heure de la poésie qui
descend du ciel dans le cœur de chaque homme.
Sans témoins, Amaral, avec ses instincts pas encore
faussés par les illusions de la célébrité, qui se cherchait, était un
poète, un rêveur, ôtait de son visage son masque dévorant, humait l'air
pur de la nature, avait l'impression qu'il se remettait d'un ennui qui
le rendait douloureusement infirme, et aspirait à un autre monde,
meilleur que le sien.
C'est au Candal qu'Amaral sentit le plus lucidement le
caractère intermittent de la poésie. Il s'était arrêté, et avait
contemplé le coucher de soleil, qu'il n'avait pas salué durant deux
ans, depuis qu'il avait oublié cette heure, si mystérieuse dans son
village. La première émotion que lui procura sa sensibilité engourdie,
ce fut la nostalgie de sa mère, une image sainte qui venait lui
demander une larme tardive. Puis, l'un après l'autre, ce furent les
images disparues de sa vie enfantine ; le pré qu'il chérissait le plus
; l'arbre à l'ombre la plus douce, le ruisseau au murmure le plus doux,
la fleur vivace, la montagne et ses vieux contes effroyables, le vieux
mâtin qui lui léchait les mains, l'escabeau de pierre à l'entrée de la
vieille chapelle où il avait lu René, son livre préféré quand il avait
quinze ans. Puis, il descend à la vie de l'homme précoce. Il y trouve
des scènes uniformes : de l'amour sans passion ; l'imposture d'un
insensé qui avait voulu se détacher de la foule, en se donnant
l'importance du héros d'un médiocre roman. Il eut honte de lui ; il se
vit misérable, ignoble et plus trivial que tous les fats de sa
connaissance.
Il s'arracha de ce bourbier accroché aux ailes du chérubin
de l'espérance. Il s'éleva jusqu'à Dieu, laissant en bas l'athéisme
qu'il avait professé sans les convictions de l'athée ; qu'il avait
professé, parce que la vertu ne s'accordait pas à son masque mensonger.
De là, il observa la terre à l’œil nu, et vit que le bonheur n'était
pas une chimère de malheureux. Il s'imagina la femme aimée, s'inclinant
aux bras de son amant, de l'ami sincère, de l'homme estimé des hommes,
d'elle et de Dieu. Mais la femme aimée, où se trouvait-elle ? Dans
quelle région, dans quel coin du monde le poète serait-il conduit par
l'écho de son invocation ?
Les femmes de son monde lui passaient devant les yeux, et
il détourna son visage, écœuré, pour ne pas les voir. Elles étaient
frivoles, artificielles comme lui, ingénieuses dans l'imposture,
accueillant le pompeux mensonge avec plus d'amour que la vérité nue. Le
découragement lui brouilla l'esprit, la lumière de ce moment-là pâlit,
comme le rayon de lune qui se dressait au-dessus des faîtes de la cité
voisine. Amaral descendit du mont de Gaia, triste et abattu, comme
l'ami qui revient du cimetière où il a accompagné le confident de ses
larmes.
Il s'arrêta encore, tournant son visage vers l'endroit où
tant d'amères réminiscences, tant d'espérances douces s'étaient
entrelacées en se détruisant.
– Ç'a été là, dit-il, jamais je n'oublierai cet endroit ni
cette heure... Si je suis un jour moins malheureux, je viendrai là pour
me souvenir de cette heure aujourd'hui.
Cela s'était passé le vingt-huit juin, justement la veille
de la fête de Miragaia.
Impressionné par la coïncidence entre ces méditations et
la rencontre d'Augusta, superstitieux comme ceux qui voient au-delà de
ce qui est palpable, Amaral attribua à une providentielle influence le
simple hasard qui l'avait mis en présence de cette couturière qui
pleurait en étreignant le cadavre de sa mère. Sans le précédent du
Candal, Guilherme n'aurait pas été aussi sensible à la royale beauté,
et à l'idéalisme romanesque d'Augusta.
En l'aimant, en la tentant, il jugea qu'il serait facile
de la convaincre. Il imagina, comme nous l'avons vu, ce qu'il y a de
meilleur dans la vie, l'amour vrai, l'amour sans embuscades, la
perfection de l'amour. Il ne savait pas qu'au-delà de la perfection il
y a la satiété : il n'avait pas lu cette éternelle vérité proférée par
une femme : "L'amour ne se nourrit que de souffrances ; il cesse avec
le bonheur ; parce que l'amour heureux, c'est la perfection des plus
beaux rêves, et que tout ce qui est parfait ou perfectionné, touche à
sa fin."
Après ces éclaircissements, vous vous représentez, cher
lecteur, l'existence d'Augusta au Candal, si vous me dispensez de
vous dire qu'elle y fut amenée dans un coupé, deux jours après qu'Ana
de la rue des Arménios l'eut vue partir pour ne plus revenir.
La maison où elle vit est celle qui blanchoie le plus près
de Guilherme, dans ses après-midi de rêveuses mélancolies. C'est une
jolie maison. Je ne me pique pas de connaissances en maçonnerie ;
j'abandonne la marotte des descriptions architectoniques à ceux qui se
contentent d'inspirer de l'admiration à quelque chef de chantier.
Je sais qu'elle attire les regards, cette maison, avec ses
quatre fenêtres aux bleus et aux rouges transparents, ses corniches
peintes en bleu ciel, ses portes bleues, elles aussi, la cour aux
dimensions modestes, mais débordant d'acacias, de mimosas et de mûriers
qui l'ombragent, s'étalent au-dessus des murs de la propriété, qui
entourent le petit édifice. Dans le jardin, il y a une forêt miniature,
la fraîcheur des tonnelles, l'allée d'antiques lauriers, les camélias
et leurs dernières fleurs, les renoncules, les roses pompons, et
d'autres de toutes les couleurs, les myrtes, les tulipes : diverses
nuances du blanc, qui signifie la candeur ; du rouge, qui évoque la
passion ; de bleu, qui signifie la fidélité ; du jaune, qui signifie la
gloire ; du vert, qui signifie l'espoir.
Et toutes les fleurs parlaient ainsi au cœur de Guilherme
quand, s'employant à la réalisation de ses espoirs, il donnait ordre
sur ordre pour que les meubles de la maison respirassent l'élégance et
la richesse. L'argent fait des miracles à notre époque, comme la
baguette de Moïse en des temps meilleurs. La maison fut par magie
jonchée de tapis, garnie de rideaux, meublée, parfumée... C'était un
va-et-vient d'hommes, de garçons et de femmes que l'impatience de
Guilherme jugeait aussi énergiques que des huîtres !
En deux jours, le provincial avait créé cet Éden, montrant
en l'occurrence plus de goût qu'on ne pouvait s'y attendre. Ève y
pénétra, et avec elle son inséparable Adam, sans que ses côtes eussent
à en souffrir, et sans craindre d'être "mystifié" par quelque serpent
des forêts voisines, descendant de celui que Milton fit mieux parler
qu'un député de chez nous.
Augusta ne semble plus la même. Ces changements l'ont
transfigurée. Que son visage ait perdu de ses couleurs, c'est
indiscutable, mais c'est justement cela qui la rend plus intéressante.
Ça lui va bien, les yeux battus, et la morbidité du regard. La robe de
lustrine noire dont les plis tombent sur le vernis de ses chaussures ne
semble pas envelopper un tel corps pour la première fois. L'allure,
l'élégance, la grâce, la souplesse, tout cela, ou c'est l'art qui le
lui a appris, ou c'est venu de la nature qui attendait une occasion de
le mettre en relief. Comme elle enfile un gant de la couleur du lait,
moins blanc que l'avant-bras, comprimé dans des bracelets, qui y
laissent de gracieuses traces ! Une Andalouse n'ôterait avec plus de
panache sa mantille de ses épaules ! Elle tombe, fatiguée, sur une
chaise rembourrée, avec la grâce impériale d'une duchesse, exténuée
d'avoir galopé sur la piste d'un lièvre ! Comment peut-on arriver à un
tel résultat avec une couturière en quarante-huit heures !
C'est la toute-puissance de l'instinct, nous ne
connaissons pas d'autre réponse.
Vous trouvez cette raison futile ? Vous avez des yeux et
vous ne voyez pas. Allez dans les salons. Si vous ne connaissez pas les
modèles de l'élégance, renseignez-vous. Vous y trouveriez de phénomènes
plus curieux que celui d'Augusta. La main qui, il y a quelques années,
agitait un tablier devant un fourneau, voilà qu'elle agite un éventail,
l'ouvre et le ferme, l'utilise pour un regard en coin, et un sourire
malicieux... enfin, "ce sont des choses de ce monde", comme disait Ana
do Moiro.
Nous devons l'écouter à présent. Il serait encore plus
surprenant que ses expressions se modifiassent en raison directe de
l'affinement des formes ! Il ne nous restait plus qu'à voir ce prodige
philologique.
– Aimes-tu ta maison, Augusta ? demanda Guilherme.
Elle le corrigea tendrement :
– La mienne ou la nôtre ?
– La nôtre...
– Je l'adore... Je ne vois pas la raison d'un tel luxe. !
– C'est pour toi.
– Pour moi ? Je vis de peu...Ce que je veux, c'est ton
amour, et rien de plus.
– Mon amour, c'est tout ce que tu vois là... T'ai-je menti
?
– Non... Pardonne-moi.
– Tu me demandes déjà pardon ? !
– Je ne cesserai jamais de le faire, Guilherme...
– Mais tu es triste !...
– Ne pleure-t-on pas de joie ?
– Comme tu es belle ! Regarde-toi à ce miroir...
– C'est ça !.. Ne te moque pas de moi... Je ne suis belle
qu'à tes yeux... Le vilain trouve belle celle qu'il aime...
– Cet adage n'est pas de bon ton ; ne le répète pas.
– Qu'est-ce qu'un adage ?
– C'est une expression populaire... Tu n'es plus du peuple.
– Corrige-moi donc toutes les sottises que je dirai, tu
veux bien ?
– Dès demain, tu auras un professeur de littérature ;
l'après-midi, il en viendra un autre de piano ; je veux que tu
consacres beaucoup de temps aux études, tu veux bien ?
– Tout le temps que tu voudras.
– Si tu sais écrire au bout de six mois, je te donne dix
mille baisers...
– Entendu ... dix mille baisers, et un d'avance...
– Deux, trois, quatre... et je te dois, au cas où tu
exécuterais ton contrat, neuf mille neuf cent quatre-vingt-seize
baisers... Ensuite, tu apprendras à parler français ; puis italien ; et
si tu as une bonne voix, tu seras une parfaite chanteuse.
– Et je serai assez habile pour apprendre tant de choses ?
– Oui. Tu ne sais pas ce que tu es. Il y a trois jours que
tu vis avec moi : tu es une autre femme. Tu étais une perle égarée.
Dans six mois, tu apparaîtras dans la société, et tu riras de
l'ignorance de beaucoup de femmes, qui passent pour spirituelles.
– Tu veux donc m'emmener d'ici ?!
– Non ; mais je veux qu'on te voie, parce que je suis fier
d'être heureux.
– Et moi, je ne voudrais pas que personne me voie.
– Je ne voudrais pas que quelqu'un me voie... quelqu'un
pas personne...
– Je ne le redirai plus Guilherme. Ne laisse pas passer
aucune... non, pas aucune... la moindre bourde.
– Le mot bourde n'est pas joli dans la bouche d'une femme
; il vaut mieux parler d'erreur...
– C'est un joli mot ! Tu me plais comme ça... tu montres
vraiment de la patience pour expliquer.
– C'est que je veux faire de toi la première de toutes. Tu
le seras. Le dernier amour qu'un homme puisse abandonner, c'est l'amour
associé à la fierté. Je veux être prévenu pour m'en nourrir, quand les
autres me feront défaut...
Augusta ne l'avait pas compris. Peu importe. Cette idée
était un peu confuse. On l'entend mieux dans les explications
supplémentaires de Madame de Girardin : "On aime de toutes les amours,
l'amour de la nature, l'amour que ressent le cœur, l'amour qu'inspire
la fierté... Il ne faut pas oublier ce dernier... Être fier d'aimer,
tirer vanité de ce que l'on aime, c'est juste un luxe, mais c'est un
luxe fort seyant..."
XII
– Avez-vous eu des nouvelles de votre ami Amaral ? demanda Dona
Cecília au
journaliste, à la plage des Anglais de São João da Foz. Etes-vous allé
le voir ?! J'ai cru qu'il ne laissait personne voir sa romantique
couturière.
– J'ai pu constater que mon ami lui accorde une confiance
illimitée.
– Est-elle jolie, comme on dit ?
– Je ne puis vous dire qu'elle est jolie, parce que cet
adjectif est employé ici avec bien des substantifs qui ne le méritent
pas. Elle est plus que jolie. L'imagination ne saurait imaginer un tel
accord entre les traits ! Raphaël eût barré d'un trait noir la tête de
toutes ses madones, s'il avait vu Augusta.
– Oui ?! Il n'y a plus qu'à la voir !... Est-elle
spirituelle ?...
– Ça, c'est une autre chose : le talent, c'est l'art qui
le développe ; la beauté est un don naturel. Elle n'a pas encore eu le
temps d'être spirituelle ; mais ce sera, après deux années d'étude, un
prodige. Il y a trois mois qu'elle vit avec Guilherme et elle écrit,
elle lit, avec une admirable correction. Elle ne connaît pas la
musique, mais elle invente des mélodies au piano. Elle devine tout.
Elle parle sans aucune prétention de ce qu'elle sait. Son allure est
celle d'une dame accomplie, habituée dès son enfance à fréquenter des
gens connus, à suivre de bons modèles dans l'art de captiver les
esprits. L'on en oublie que cette femme cousait des bretelles il y a
trois mois.
– Votre enthousiasme me fait rire ! Les poètes ont de ces
idées ! Une couturière de la sorte serait capable de faire votre
bonheur, n'est-ce pas ?
– Non, Madame.
– Non ? !... Quelle excentricité ! Que voulez-vous de plus
? Les amours d'une couturière ont réchauffé le vide glacial de votre
ami, qui était certainement plus difficile à satisfaire que vous.
– Plus difficile, non... Je me suis contenté de bien
moins... Vous n'ignorez pas que j'ai longtemps vécu en soupirant après
votre amour.
– Je ne vois pas la raison d'une telle réflexion... L'on
ne parle pas de moi... Ce que je veux vous faire remarquer, c'est que
les instincts de monsieur Guilherme do Amaral sont biens communs !...
Il est descendu bien bas, il s'est enfoncé dans la boue. Une dame
éprouvera de la répugnance à lui tendre la main... Il se donnait une
telle importance !... Voyez ce qu'a donné tout cet orgueil !...
Inaccessible pour tant de gens de qualité, et tout prêt à se faire
séduire par une couturière...
– Pas inaccessible, chère, estimable Dona Cecília.
Guilherme était accessible à toute tentation ; il se laissait aller
quand les yeux provocants des honnêtes gens l'y invitaient. Et, vue la
connaissance que j'ai de mon ami, je proteste contre cette calomnie.
Amaral s'est acquitté loyalement, comme un gentilhomme qu'il était, de
toutes les obligations que l'on doit remplir dans la bonne société avec
d'honnêtes gens. Si l'on n'a pas fait attention à vous lorsque vous
vous êtes présentée sur le marché...
– Comment dites-vous ?
– Je dis qu'Amaral n'a pas fait attention à vous, parce
qu'il avait des vertus du XIVe mêlées à la corruption du XIXe.
Nonobstant (ne vous inquiétez pas, Madame ; nous nous entretenons dans
la plus sainte intimité), nonobstant, mon ami n'a pas toujours résisté
aux nombreuses tentations. Il s'est, comme Homère, endormi quelquefois
; il a eu les faiblesses congénitales d'une race humaine dégénérée, qui
n'est pas la seule qui le soit, puisque toutes les autres races font,
de façon plus scandaleuse, ce que la nôtre prend vertueusement la
précaution de cacher. Nous devons au bon sens des dames les précautions
qui nous épargnent une complète dégénérescence.
– Je ne vous comprends pas... Vous entortillez dans une
prose inintelligible une poésie libertine... Voulez-vous dire que la
couturière de votre ami vaut plus que les personnes délicates qui ont
reçu plus ou moins cordialement monsieur Amaral ?
– C'est bien ça...
– Cette grossièreté est surprenante de votre part.
– Elle ne l'est pas, et je ne fais pas commerce
d'originalité.
– Si vous le permettez, je vais prendre un bain. Ça fait
trois fois que la baigneuse m'appelle...
- Montrez-vous un peu cruelle avec votre baigneuse, Dona Cecília
; mais permettez-moi, pour notre commune satisfaction, de vous
expliquer succinctement ma grossièreté. La couturière vaut plus que les
fort cordiales admiratrices de Guilherme parce qu'elle n'avait pas
cette cordialité élastique prête à tendre la main à quiconque la
sollicitait. Elle a aimé un seul homme, et cet homme voulait un amour
exclusif, un cœur vierge, un visage qui exprimât, dans la feu de sa
rougeur, sa première émotion. La couturière... n'a pas rêvé de types,
elle ne savait pas non plus que les types dont on rêve défilent
ensuite, avec leur frac et leurs bottes vernies, devant la fantastique
rêveuse, qui ne cesse d'attendre le dernier. La couturière était une
femme simple, avec la tête, le cœur et l'estomac à leur place. Elle
pense, elle aime, et elle mange comme les honnêtes gens ; mais les
honnêtes gens ne pensent, ni n'aiment comme elle. Que ceux qui veulent
entendre, m'entendent.
– Elle est chaotique, votre explication ! Je n'ai pas eu
le privilège de vous entendre.
– Simplifions donc : vous ne valez pas cette couturière,
même avec mes poésies en plus, qui sont au nombre de cent
quarante-quatre.
Cecília, rouge de colère, tourna le dos au journaliste
qui, assis sur une petite chaise en pin, se mit à ébaucher sur le sable
une tête avec un nez énorme. Il alla demander ensuite du feu au mari de
Cecília pour allumer un cigare. Il revint s'asseoir, et se lança dans
de profondes spéculations sociales, qu'il publia dès le lendemain,
compromettant ainsi gravement une réputation d'honnête homme déjà
fortement ébranlée.
Malgré tout, il était l'unique homme qui fût reçu chez
Guilherme.
La première fois qu'il vit et qu'il entendit Augusta, il
embrassa son ami, en s'exclamant avec un enthousiasme sincère : "Tu
avais raison ! Je renie toutes mes théories. Il est possible d'être
durablement heureux avec cette femme. Tu dois beaucoup aimer ton œuvre.
L'âme qu'elle a, c'est la tienne, tu la lui as donnée. Chaque nouveau
don que tu développes en elle te rend encore plus amoureux. Pygmalion
aimait sa statue, tu aimes la femme qui frémit sous ta main à chaque
retouche de ton génie créateur. Sois heureux ! Tu es le second Jéhovah
de cette création. La nature lui a donné la perfection du corps ; toi,
la perfection de l'âme. Quand tu seras las de cette femme,
donne-toi la mort, parce qu'il ne te restera plus rien..."
Ces mots firent beaucoup pour la réputation du poète. À
partir de ce jour, Amaral fut son ami, d'une amitié sans réserves, sans
méfiance. Deux grands sentiments à la fois : l'amour d'Augusta,
l'amitié du lettré ; l'ambition d'un jeune homme riche peut-elle aller
plus loin à vingt-deux ans ?
Amaral n'en avait pas d'autre. Complètement absorbé par
son œuvre, comme avait dit le poète, rien ne le distrayait de
l'atmosphère de roses dans laquelle le soleil le saluait tous les
matins avec les sourires bienfaisants de Dieu. Il n'allait rendre
visite à personne. Il courait se réfugier auprès de son Augusta, qui
venait toujours l'attendre et l'embrasser avec une joie frénétique, en
haut de Vila-Nova.
Le journaliste allait les voir deux soirs par
semaine et il respirait là, disait-il, l'air balsamique de la poésie
véritable. Tandis qu'il parlait de sujets littéraire avec Guilherme,
Augusta les écoutait en silence, mais disait, avec ses yeux pénétrants,
qu'elle les comprenait. S'agissant des affaires de cœur, Amaral
choisissait ses exemples dans le dernier livre lu par Augusta, et il
avait commenté les passages obscurs, et feint l'ignorance dans ceux qui
devaient rester un mystère pour une lectrice ignorante. Au cours de ces
analyses, Augusta, invitée par Amaral à le faire, parlait peu et
timidement ; mais l'écouter quelques instants, c'était savourer le
plaisir qu'on aurait pris à l'écouter toujours. Les éloges
encourageants du journaliste, elle les accueillait en rougissant, et
les éloges secrets de son amant, elle l'en remerciait avec des larmes.
Certaines après-midi calmes, ils se promenaient à cheval.
Augusta était toujours belle ; mais, sur sa selle, quand elle faisait
faire à son cheval de gracieuses croupades, elle était inimitable.
Amaral se reconnaissait dans son œuvre, avec l'orgueil de l'artiste et
la tendresse de l'amant. Comme il mettait son visage en valeur, son
voile bleu foncé ! Quelle gentillesse, lorsque le cheval galopait, et
que le voile, qui flottait au vent, laissait voir son sourire confiant
et joyeux !
Rossi-Caccia chantait alors à Porto. Amaral voulait
susciter une nouvelle émotion chez Augusta, qui n'avait pas même
entendu parler de théâtre lyrique à la rue des Arménios.
– Nous allons demain aller au théâtre, dit-il.
– Oui...
– Une telle décision ne te fait pas plaisir ?
– Tous tes désirs me font plaisir, Guilherme.
– Je t'ai vue pâlir à l'instant...
– Ce n'est rien...
– Je te laisse le choix. Veux-tu y aller ou pas ?
– Ne pas y aller.
– Et tu me donnes raison ?
– Oui... Il n'est pas d'endroit où je puisse être plus
heureuse que je ne le suis ici... Pourquoi verrais-je de nouvelles
choses, si je vois tout ce que je désire ?
– Mais les nouvelles émotions n'enlèvent pas le goût des
anciennes...
– Comme tu voudras, Guilherme.
– J'avais envie de te faire entendre une des premières
cantatrices d'Europe... Moi-même j'ai envie de l'entendre ; mais pas
sans toi.
– Nous irons... Combien de temps passe-t-on au théâtre
?... Trois heures ?
– Plus ou moins.
– C'est trois heures qui ne passeront pas aussi vite que
celles que nous passons ici... Peu importe, allons au théâtre...
Ils y allèrent. Dès qu'on entendit la clé tourner dans la
serrure d'une loge, alors que le rideau était levé, l'attention de tous
se fixa sur le deuxième rang. Augusta fut saluée par une batterie de
lorgnettes. L'on vit apparaître une belle femme, vêtue de noir, seule,
qui s'assit, et ne détourna pas les yeux de la scène.
– Qui est-ce ? demandait Cecília à Dona Margarida, sa
voisine de loge (elles s'étaient réconciliées au dîner d'adieu de
Guilherme).
– Je ne sais pas... elle doit venir de la province...
– Elle est superbe !
– On le dirait, d'ici.
– Je ne vois que son profil.
– Moi aussi. Avec sa façon de se tenir immobile elle sent
sa province.
– Et toutes les jumelles du théâtre qui se braquent sur
elle !... C'est effarant.
– Ce doit être elle...
– Quoi ?...
– Quelque...
– Absolument pas... Elle ne se présenterait pas au
deuxième rang...
– Mais seule...
Ces réflexions adorablement
innocentes furent interrompues
par l'apparition de Guilherme do Amaral. Le murmure des loges
accompagna en contralto la rumeur qui courut, en basse profonde, dans
l'orchestre. Le provincial, qui s'était fait une réputation
d'excentrique, braquait sa lorgnette sur l'actrice, et tournait vers
Augusta un visage plein d'affection avec la prévenance d'un soupirant.
Les loges et l'orchestre le laissaient indifférent. Il ne leur accorda
même pas un de ces regards, qui n'expriment rien.
– N'est tu pas étonnée par un tel aplomb, Cecília ?! dit
la fille du baron de Carvalhosa.
– C'est incroyable !... Et tous ces gens qui ouvrent de
grands yeux !...
– Sans doute la beauté de cette couturière...
– Quelle beauté ! Elle n'est pas la moitié de ce qu'on
disait...
– Elle est bien jaune.
– Jaune, non, elle est pâle ; mais cette coiffure !... Qui
se fait à présent des anglaises !?
– Et ne trouves-tu pas qu'elle a des épaules vraiment
étroites ?
– Oui... Ce qui lui donne des seins, c'est le coton...
– La main est grande.
– Et c'est tout !... Ce n'est pas ce qu'elle a de pire...
Mais cette façon de prendre sa lorgnette, ça ne dément pas l'ancienne
couturière qui faisait des bretelles...
– Mais regarde-moi ces imbéciles, qui ne la quittent pas
du regard !...
– Ils doivent en dire de belles à l'orchestre...
– Cela dénote une absence totale de respect pour l'opinion
publique...
– C'est immoral.
– On n'a jamais vu ça.
– Il est complètement discrédité, le fameux lion des
couturières.
– Il est digne d'elle...
Le rideau était tombé, la porte de la loge de Guilherme
s'ouvrit. C'était le journaliste à qui son ami céda sa place. Rien de
plus urbain, de plus respectueux que les attitudes du poète en train de
bavarder avec Augusta.
– Êtes-vous satisfaite, Madame ?
– Je me sens bien.
– Avez-vous aimé la Rossi-Garcia ?
– Je ne puis la comparer à personne, c'est la première
fois que j'entre dans un théâtre ; mais Guilherme a trouvé cette
chanteuse remarquable.
– Votre cœur a-t-il besoin des jugements d'autrui ?
– S'il faut juger selon mon cœur, je ne porte aucun
jugement. Guilherme m'a expliqué l'intrigue, et il m'a émue. La musique
n'a pas autant de pouvoir que ses paroles. J'ai lu je ne sais où que
l'amour est un signe auquel on reconnaît les esprits cultivés. Je
ne puis donner un tel signe.
– Même l'excès de modestie vous va bien... Il faut croire
que vous allez continuer à fréquenter le théâtre.
– C'est Guilherme qui y tient.
– Et vous aussi, non ?
– Non, Monsieur. Je regrette notre cabinet. Ce bruit
m'étourdit... Il y a tant de gens qui me font une impression
douloureuse.
– Vous avez vu les loges ?
– Pas encore, et elles ne m'intéressent pas. Il y a des
dames qui ne me connaissent pas, et que je ne connais pas.
– Et toi, Guilherme, tu connais ces dames ?...
– Je ne sais pas, je ne les ai pas encore vues. Donne-moi
cette lorgnette.
En parcourant la salle du regard, il reconnut les principales
familles. Il aperçut les lentilles tournées vers sa lorgnette, et
sourit au poète, un sourire que le poète entendit à merveille.
Augusta remarqua ce sourire et rougit. L'avait-elle
compris ?
À la fin de la représentation, le journaliste offrit son
bras à Augusta. Amaral avait fait venir son landau. La tourbe d'espions
qui jouait des coudes sous le portique s'ouvrit pour laisser passer une
femme dont la beauté stupéfiait, tout en inspirant un mélange de
respect, de tendresse, et même d'effroi. Il y a des femmes qui font cet
effet.
À une porte sur le côté, où s'arrêtent les équipages, se
trouvait un groupe de femmes qu'Amaral salua sobrement en entrant dans
son landau afin d'en tirer un marche-pied de velours cramoisi sur
lequel Augusta posa son pied droit pour y monter fièrement. Le
journaliste lui donna la main, en levant bien sa voix déjà sonore.
– Je vous souhaite une bonne nuit, Madame. Au revoir,
Amaral... À demain.
Dans la voiture, Guilherme sentit son cœur se serrer quand
Augusta murmura sur un ton suppliant :
– Que ce soit la première et la dernière fois que je vais
au théâtre, tu veux bien, mon ange ?
– Pourquoi, ma fille ?
– Ce sont les premières heures tristes que j'ai connues
avec toi. Je sais que je ne vis que pour toi, et je ne me reconnais
dans rien de ce qui m'entoure. Si tu aimes le théâtre, vas-y... ne te
prive d'aucun plaisir et, quand tu reviendras chez nous, tu trouveras
dans mes bras de l'amour et la joie.
– Mais qu'est-ce qui t'a donné une telle impression ?! Le
regard de quelqu'un t'a-t-il froissée ?...
– Je ne sais pas si quelqu'un m'a regardée... moi, je n'ai
vu personne ; je sais qu'il n'y avait plus de sang à mon pouls, et
qu'il me montait par vagues jusqu'à la tête. J'ai été sur le point, au
deuxième acte, de te prier de me raccompagner. J'étais malade,
j'éprouvais un profond dégoût, j'avais une envie de pleurer que je ne
saurais t'expliquer... quelque chose comme le pressentiment d'un grand
malheur pour toi... pas pour moi, non...
Ce sont la des effets de notre dernier roman...
– Non, mon Guilherme chéri, les romans ne me procurent, ni
ne m'enlèvent ma sérénité.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
À peine eurent-ils mis pied à terre dans leur petite
maison silencieuse du Candal, Augusta courut à son cabinet de lecture,
se laissa tomber sur une chaise, et s'exclama :
– Ah !... Quel soulagement !... Je suis à nouveau heureuse
!... J'ai retrouvé la vie!...
Avec un baiser, Guilherme lui confirma le retour du
bonheur compromis.
XIII
Augusta aurait-elle complètement oublié l'artisan ?
Je réponds à toutes les questions que vous me posez, mais
pas à celle-là. Il est sûr qu'elle n'a jamais parlé de Francisco,
et Guilherme faisait bien attention à ce qu'il disait pour ne pas
évoquer des souvenirs de la rue des Armènios.
Ce que je puis affirmer, c'est que l'artisan n'oublia pas
Augusta.
Vous savez déjà les vaines démarches qu'il avait faites
pour débusquer la cachette de sa cousine. Ce n'était pas la simple
curiosité d'un étranger, ou l'inquiétude d'un parent ; c'était l'amour,
qui peut rendre fou, et la jalousie qui peut inspirer le désir de se
venger, comme on peut s'y attendre avec ce genre d'individus.
Huit mois s'étaient passés en d'inutiles recherches, quand
Francisco aperçut, rua das Flores, Guilherme do Amaral. Sa première
réaction, en le rencontrant, ce fut un accès de rage qui, dans un
endroit désert, aurait valu à ce dernier un bon coup de couteau. Puis
c'est la réflexion qui l'emporta, et l'artisan, caché au coin de la
Ponte-Nova, attendit qu'Amaral sortît d'une orfèvrerie, pour partir sur
ses traces.
Il n'eut pas à attendre longtemps. Amaral était sorti, et
l'artisan l'avait suivi de loin, jusqu'à ce qu'il le vît entrer dans un
fiacre, sur la place de São Domingos. Le fiacre partit au trot vers
Vila Nova, et l'artisan, déjà épuisé au bout du pont, ne put le
voir prendre la rue Direita (droite comme la ligne droite d'un ivrogne
). Il reprit son souffle et prit son temps pour retrouver les traces
des chevaux, mais les pavés de la chaussée n'en laissaient apparaître
aucune.
Après avoir demandé à un batelier s'il avait vu un fiacre
passer par là, il apprit tout ce qu'il voulait. Le fiacre, dit le
batelier, emmenait au Candal un fidalgo qui y habitait, le patron d'une
de ses filles, qui travaillait à la cuisine.
L'artisan dissimula comme il put sa curiosité, et prit le
chemin du Candal. Il demanda à un cultivateur où demeurait un fidalgo
du nom de Guilherme, vit la maison, en fit le tour de loin, et retourna
à Porto. S'il était resté là jusqu'à la nuit, il aurait pu voir passer
Augusta et Guilherme qui se rendaient à Porto dans la même voiture.
Cette nuit-là, l'artisan ne dormit pas. L'heure de la
vengeance était arrivée, il y pensait depuis huit mois. Incertain de
parvenir à ses fins, Francisco songea qu'il devait attendre la nuit
suivante ; il voulait se confesser, dans le louable espoir d'arriver
pur au ciel, dans le cas où il aurait le malheur de mourir, en tuant.
(Il partageait, s'agissant du sacrement de la pénitence, les
conceptions de ceux qui se confessent pour atténuer les peines
qu'entraîne le suicide. Ce ne sont pas eux, toutefois, qui offensent le
plus la religion, non plus que les prêtres qui les absolvent. Ce qui
fait du mal, ce sont les romans et les bulles.) Le lendemain, Francisco
ne se rendit pas à son atelier, et fit savoir à son patron qu'il s'en
allait pour quelque temps. Le patron, son protecteur et son ami,
alla le trouver, et le trouva en pleurs.
– Qu'est-ce que tu as, Francisco ? Pourquoi quittes-tu
l'atelier ?
– Il n'y a rien à faire, patron... Chacun vient au monde
avec son destin.
– Mais qu'est-ce qui t'arrive, mon gars ? Il y a un bon
moment que je me doute de quelque chose ! Avant, tu étais un garçon
joyeux, toujours content, et depuis des mois, là, je te vois comme ça,
tout rêveur ! Mais que, diable t'arrive-t-il ?
– Ce sont mes péchés, patron.
– Dis-moi ce qui se passe, mon garçon : il y a un remède à
tout, quand il y a des amis pour quand on en a besoin.
- Il n'y a pas de remède pour mon mal... Je vais quand même tout
vous raconter. Je ne vous ai pas dit, il y a plus de trois ans, que je
voulais épouser une fille qui était ma cousine ?
– Tu le l'as dit, et puis tu n'en as plus reparlé.
– C'est parce qu'elle a trouvé des moyens de remettre le
mariage ; puis, ça doit faire huit mois, elle s'est enfuie de chez elle
avec un homme tiré à quatre épingles, et elle est avec lui.
– Et qu'est-ce que tu lui veux, maintenant ?
– Je veux lui faire la peau.
– Tu te conduis comme un âne, mon gars ! Qu'est-ce que tu
en as à faire, de cette fille ! Comme s'il n'y avait pas assez de
femmes !
– Il n'y en a aucune comme elle ; quoi que je fasse, je ne
peux pas la balayer de ma mémoire ; quand je mange, et que je me
souviens d'elle, le morceau me reste en travers de la gorge ; j'ai
passé des nuits sans fermer l'œil ; tout m'agace ; je ne vois plus
comment je travaille ; je me moque même de la paie... Mon amour pour
elle avait de solides racines, jusque là-dedans. Ah, si Dieu pouvait
m'aider, que je cesse de lui en vouloir à ce point.
– Et lui, qu'est-ce que tu lui reproches ? Un chien, quand
on lui jette un os, il le prend dans sa gueule...
– Ne dites pas ça, patron, vous lui pardonneriez !...
C'est à lui que j'ai envie d'arracher les tripes... C'est lui qui est
entré dans sa maison avec trois pièces, comme un gars qui va acheter
une vache. Ces gens riches, qui se servent de leur argent pour faire le
malheurs des pauvres, ne méritent qu'une balle dans la peau. Elle se
trouvait là, chez elle, sans rien demander à personne, tranquille ;
pourquoi est-ce qu'il est venu me la voler ? Parce qu'il avait de
l'argent, et que moi j'avais besoin d'en gagner pour manger. Une jeune
fille, ce n'est pas sa faute, si elle tombe dans ses filets ; ce sont
eux les salauds qui n'ont aucune peine à pousser une femme à se
perdre...
– Et tu te marierais avec elle, maintenant ?
– Ce qui se passerait, je n'en sais rien, patron... Je
suis fou d'elle à en crever. Il me semble que je me marierais avec
elle, si je pouvais faire la peau à ce coquin !
– Alors, je te dis, mon garçon qui tu n'as aucune pudeur
!... Tu te marierais donc avec une fille qui a traîné là-bas à faire la
vie ?!
– Laissez-moi, patron... je n'arrive pas à mettre deux
idées bout à bout... Cette femme me rend fou... Ce dont j'ai envie,
c'est de trancher la gorge...
– Calme-toi, mon garçon... Ne te conduis pas comme un
âne... Viens avec moi.
– Où m'emmenez-vous ?
– Allons à l'atelier... Nous parlerons là-bas. J'ai là-bas
deux métiers à tisser que tu es la seul à pouvoir diriger. À partir
d'aujourd'hui, tu seras mon contremaître, à huit tostões par jour.
Demain, si tu veux te marier avec la fille du Manuel de la Severa, ou
avec la Felizarda du Cabeço-de-Cima, on ne te dira pas non. Tu pourras
t'installer quand tu voudras : je me porterai garant pour toi, et je te
donnerai de l'argent pour une demi-douzaine de métiers... Viens,
Francisco...
– Non, je ne vais pas venir avec vous... quoi qu'il en
soit, j'ai tiré ma carte... Je m'en moque d'être riche, ou pauvre... Je
vais suivre mon idée...
– Quelle idée ?
– Je vais estourbir ce salaud qui m'a volé ma cousine.
– Et si je t'engageais comme contremaître ?
Francisco ouvrit ses yeux baignés de larmes et injectés de
sang et regarda son patron.
– Et vous auriez le courage de me prendre ?
– Bien sûr ! Je ne ferai donc rien pour t'empêcher de
faire une sottise ?! Tu veux finir au gibet ? Tu crois qu'on tue
un homme comme on tue un chien ?! Et si c'est lui qui te met une balle
dans la tête ? Ne fais pas ta tête de mule ! Viens avec moi, et tout de
suite !
Francisco le suivit machinalement, entra dans l'atelier,
s'assit à son métier, travailla une demi-heure ; mais le patron,
remarquant dans quel état sortaient les fils de ses canettes, lui dit
de sortir, et vint lui expliquer dehors les obligations d'un
contremaître.
À la fin de l'après-midi, il le perdit un instant de vue.
Il le chercha sans réussir à le trouver.
Francisco, avait dit un ouvrier, était parti avec la
carabine de son patron, du côté de l'Oiro, et avait traversé la rivière
sur un bateau.
Comme il l'avait promis à Guilherme lors de leur soirée au
théâtre, le journaliste alla passa la nuit au Candal.
Quand il arrêta son cheval devant la maison, il entendit
le bruit produit par une silhouette, que l'obscurité ne permettait pas
de distinguer parmi des souches de chênes.
Il regarda attentivement, et il découvrit non seulement la
masse obscure de quelqu'un qui se déplaçait, mais il entendit le
claquement du chien d'une arme à feu.
Peu disposée à mourir sans une explication préalable, le
poète cria :
– Oh ! Essayez de ne pas vous tromper ! Si vous voulez me
reconnaître, approchez-vous.
– Ce n'est pas nécessaire ! dit l'artisan. Vous pouvez
passer.
Le journaliste frappa à la porte cochère ; un domestique
prit son cheval, et Augusta ouvrit une fenêtre, et demanda :
– C'est toi ?
– À cette question, dit le journaliste, je vois qu'Amaral
n'est pas à la maison.
– Ah ! C'est vous, Monsieur ? Montez donc.
– Je n'en reviens pas !... Guilherme n'est pas là à cette
heure ! dit, en entrant dans le salon, le journaliste, un peu défait,
comme qui n'est pas habitué au claquement des chiens.
– Il a reçu une lettre de la province, dit Augusta, on lui
demandait une procuration pour un procès, et il voulait qu'elle parte
par le courrier du matin. Mais je ne m'inquiète pas vraiment, il est
parti à la tombée du jour.
– Je regrette vraiment de vous donner de l'inquiétude à
propos de son absence, Madame...
– Qu'y a-t-il ?
– Un homme en face de cette maison, qui a armé son fusil
quand je me suis arrêté ; comme je lui ai fait savoir que je ne devais
pas être la personne qu'il attendait, cet homme m'a dit que je pouvais
passer. Je crains que la personne qu'il attend, ce ne soit Guilherme.
– Que faire, mon Dieu ?!
– Faire prévenir Guilherme.
– Mais qui peut être cet homme ? Guilherme n'a pas
d'ennemis...
– Qui sait, Madame ! Tous les hommes en vue ont des
ennemis...
– Et la voix de cet homme ...
– Il m'a semblé que c'était la voix d'un homme grossier,
d'un assassin stipendié... Si vous voulez envoyer un message à
Guilherme, je vous conseille de faire sortir le domestique par la porte
du potager ; il ne faut pas que l'assassin lui barre la route.
En tremblant, pâle de frayeur, Augusta fit sortir le
domestique, qui aurait bien voulu guetter la silhouette, du mur du
potager, et envoyer deux balles dans sa direction. Augusta n'approuva
pas cette idée.
Au moment où elle donnait cet ordre, le batelier se
trouvait là, qui dit avoir vu, peu après la tombée de la nuit, un homme
monter avec un fusil du côté de Santo António de Val-Piedade. C'était
un homme d'un peu plus de vingt ans, avec une veste et une casquette,
on aurait dit un artisan, ajouta-t-il.
Augusta poussa un cri ! Elle se souvint brusquement.
Terribles, comme le remords, ce devaient être ses sentiments, qui lui
firent lâcher ce cri ! Plus que sa honte ou sa peur, ce fut la pâleur
soudaine qui apparut à son visage, qui effraya le journaliste.
– Qu'y a-t-il Dona Augusta ? Il n'y a rien à craindre.
Guilherme entrera par une porte dérobée, et prendra, avant de
rentrer, des mesures pour que l'assassin soit arrêté.
– Si vous me permettez de me retirer quelques instants...
– Oh, Madame... Je ne vous demande rien d'autre que de
reprendre courage... Je regrette déjà de vous avoir effrayée...
– Vous ne devez rien regretter... Je vous dois un service
inestimable... Je reviens tout de suite...
En essayant d'échapper aux regards des domestiques sur les
dents, elle descendit dans la cour, ouvrit le portail, et s'en fut
droit aux broussées de chênes, en face. Le passage subit de la lumière
à l'obscurité lui rendait la nuit encore plus ténébreuse. Un échalier
le l'enclos lui barra le passage, au moment où elle allait s'engager
sur la route ; elle essaya quand même de sauter par-dessus et tomba. En
se relevant elle entendit un bruit dans les feuillages, et une
silhouette se détacha de la masse obscure du bois, qui semblait se
déplacer, en reculant.
– Francisco ! murmura-t-elle.
La silhouette continuait de s'éloigner, la convainquant
qu'elle ne s'était pas trompée. Augusta fit quelques pas, en répétant :
– Francisco, mon cousin... Ne me fuis pas, c'est Augusta
qui t'appelle.
L'artisan s'arrêta, cloué sur place par la surprise,
ébahi, comme vous, lecteur, et moi, moins niais que lui, nous le
serions dans de telles circonstances. Augusta s'approcha résolument de
lui.
– Pourquoi ne me réponds-tu pas, Augusto?
– Que me veux-tu ? dit l'artisan, plus ému qu'elle.
– Pourquoi cette arme ? Que viens-tu faire ici ?
– Je viens montrer à monsieur Guilherme qu'un pauvre sait
se venger comme les riches se vengent.
– Se venger... de quoi ? Quel mal t'a fait monsieur
Guilherme ? Si quelqu'un t'a fait du mal, c'est moi...
– Tu étais une jeune fille innocente... Tu ne savais pas
ce que tu faisais... C'est lui qui t'a perdu...
– Et qu'est-ce que cela peut te faire que je sois perdue ?
– Qu'est-ce que ça peut me faire ? Je suis ton cousin, et
je dois te défendre en l'absence de ton père.
– Me défendre de quoi ?
– De te trouver enfermée dans cette maison avec cet homme,
qui va te jeter un jour avec deux coups de pied en pleine rue.
– Et, s'il me jette à la rue, tu crois que je vais aller
te demander l'aumône ?
– Même si tu ne me la demandes pas, je te la donnerai,
pour ne pas te voir traîner par ici en guenilles.
– Tais-toi ! Tu ne sais pas à quel point je suis aimée par
Guilherme...
– Il a bien raison ; je lui en donnerai, moi, de l'amour...
– Et tu penses que je te laisserais mettre la main sur lui
?
– C'est ce que nous allons voir... Si ce n'est pas
aujourd'hui, ce sera un autre jour...
– Tu veux me tuer, Francisco ! Tu viens exprès ici pour
faire mon malheur... Penses-tu que tu feras de moi ton amie, en
commettant une infamie ? Si tu blessais Guilherme, je serais capable de
te planter un poignard dans le cœur. J'ai un cousin qui est un assassin
!... Quelle honte ! Va-t-en d'ici... À partir d'aujourd'hui je te tiens
pour un scélérat, qui a voulu me priver du seul bien que j'aie dans ma
vie... Va-t-en, être indigne, sinon, j'appelle les domestiques, et je
te fais remettre à la justice comme un malfaiteur, qui attend avec une
arme un homme qui ne lui a jamais fait aucun mal.
– C'est pour ça que tu es venue jusqu'ici ? fit l'artisan
avec une certaine douceur.
– Qu'est-ce que tu imaginais ? Tu voulais que je vienne te
demander pardon ? De quoi ? Quels droits as-tu sur moi ? Qui t'a chargé
de te faire le gardien de mon honneur ? Tu veux-donc te comparer à
l'homme que j'aime, misérable ! Tu as osé venir ici avec une arme pour
le tuer lâchement ? Je ne peux pas voir cela dans tes mains...
Augusta lui avait sans trop de mal arraché l'arme de ses
mains, et l'avait jetée à quelques pas avec une prodigieuse énergie.
L'artisan s'arrêta, immobile, une statue de la stupidité, devant un tel
courage, et foudroyé par le torrent d'épithètes qui sortaient de lèvres
tremblantes de rage.
– Va-t-en ! continua-t-elle en le poussant.
– Regarde ce que tu fais, Augusta ! Ne me pousse pas, je
ne te traite pas mal.
– Tu ne me traites pas mal ?! Tu veux tuer mon unique
soutien, l'homme que j'adore à genoux, l'ange qui me donne le ciel dans
cette vie... Et tu dis que tu ne me traites pas mal ?
Cette impétueuse apostrophe fut interrompue par des pas,
près de là, et des lumières qui venaient des deux côtés de la route.
– Fuis ! cria-t-elle. Fuis, on va t'arrêter !
– Laisse-les m'arrêter... Qu'ils me tuent même... Je ne
ferai pas un pas pour m'enfuir...
– Fuis, Francisco ! Fuis !...
– Je ne vais pas m'enfuir, je te l'ai déjà dit.
À la clarté des torches, Augusta avait vu des hommes en
armes, et, à leur tête, Guilherme avec une paire de pistolets armés.
– Qui va là ? cria Amaral.
– Moi, dit Augusta, résolument.
– Toi !... Et qui est cet homme ?
– Approche-toi, et tu le reconnaîtras.
Guilherme approcha une lampe de son visage, au moment où
deux domestiques se saisissaient de lui. Il resta perplexe, cherchant
une explication dans les yeux d'Augusta.
– Cet homme n'avait pas une arme à feu ?
– Oui, dit l'artisan. C'est cette... cette femme qui l'a
jetée là-bas.
– Retirez-vous et laissez-nous, dit Amaral aux
domestiques, et, en se tournant vers l'artisan :
– Que veniez-vous faire ici avec une arme ?
Augusta l'interrompit, en le suppliant, d'une voix
pressante :
– Ne demande rien, Guilherme, je te raconterai tout.
Laisse-le partir, il ne reviendra pas...
– Ça, je ne l'ai pas encore dit... répondit l'artisan.
– Que voulez-vous ? fit Amaral.
– Je ne veux rien...
– Vous voulez que je vous envoie vous reposer quelques
années dans un cul de basse-fosse ?
– Là... Vous ferez ce que vous voudrez.
Le journaliste arrivait, pétri des meilleures intentions,
il voulait se saisir de l'assassin, ignorant de tout ce qui avait
précédé cette étrange aventure. Guilherme lui demanda de se retirer. Le
poète obtempéra, en se demandant s'il y avait là une parodie de
La
Belle de Chamonix.
– Allez-vous en, mon vieux, dit Amaral. Vos balles ne
peuvent m'atteindre. Entendez par là que vous devez la vie à votre
cousine ; mais je ne promets pas de vous épargner une seconde fois un
tel coup de folie. Je vais aller chercher votre arme... La voici...
Allez-vous en...
L'artisan prit l'arme. Ses pistolets à la main, Amaral
suivait ses moindres gestes. Francisco reprit lentement le chemin par
lequel il était venu, en disant :
– Adieu, Augusta.
Il devait avoir fait cinquante pas, lorsqu'on entendit une
détonation. Guilherme courut avec Augusta vers l'artisan. Ils le
trouvèrent prostré, dégoulinant de sang.
– D'où vous a-t-on tiré dessus ? demanda Guilherme.
– De nulle part... C'est moi qui me suis tué.
Les domestiques arrivèrent. Amaral fit transporter l'homme
chez lui, et reçut dans ses bras Augusta évanouie...
Le poète qui avait suivi le mouvement, se disait :
– Un horrible mystère ! Et un roman en perspective !
Le dramatique héroïsme de l'artisan semble la parodie de
quelque exploit retentissant, accompli par un héros de roman. La
Marguerite d'Émile
de Girardin, a un comte qui se tue plus ou moins
ainsi. Si l'artisan n'était pas original, il ne savait pas au moins
qu'il faisait un plagiat. Il eut cette chance que n'ont pas eue les
suicidés que nous avons connus, il n'est pas mort.
Transporté chez Guilherme, il fut examiné par le
journaliste qui avait des connaissances en toutes les matières, la
chirurgie comprise. Celui-ci constata que la balle n'avait touché ni le
larynx, ni le pharynx, ni les ramifications artérielles et veineuses
les plus fragiles. Traversant le muscle sternocléidomastoïdien, la
balle était sortie sous le maxillaire inférieur sans aucune lésion de
cet important organe de la mastication ! Le médecin confirma le
pronostic du poète, et Francisco entama son traitement.
Augusta était son infirmière : il n'y avait qu'elle qui
entrait dans sa chambre. L'artisan, qui n'avait pas le droit de parler,
dévisageait sa cousine avec les yeux toujours débordants de larmes. Aux
questions discrètes qu'elle lui posait sur son état, le convalescent
répondait avec la gêne qu'inspire la honte. C'est que le luxe de la
chambre qu'on lui avait donné, et le luxe de ses habits, les "monsieur"
longs comme le bras qu'il entendait qu'on lui donnait dans la chambre
voisine, tout concourrait à le froisser, lui qui avait osé se présenter
comme le cousin d'Augusta, et le rival du fidalgo, qui disposait d'une
telle fortune. Ensuite, l'amour avec lequel sa cousine veillait sur
lui, les nombreuses visites du médecin, la générosité dont elle faisait
preuve en ne lui parlant pas de son coup de folie, l'importance qu'on
lui accordait à lui, un pauvre artisan, pour le payer de ses intentions
homicides, finirent par susciter sa gratitude. Francisco oubliait
son vieil amour, et se sentait tenu à éprouver du respect et de
l'amitié pour le généreux amant d'Augusta, qui n'était jamais venu dans
sa chambre.
Quand, au bout de vingt jours, il se leva de son lit,
Augusta lui dit que monsieur Guilherme allait venir lui parler.
Francisco devint tout rouge. Il avait honte de regarder en face l'homme
qui lui avait payé avec des bienfaits l'intention préméditée de le tuer.
– Monsieur Francisco, dit Guilherme, affable, je suis fort
heureux de vous voir rétabli. Je ne viens pas vous faire de reproches.
Vous avez fait ce que font beaucoup de gens plus à même que vous de
savoir ce qui est une folie. J'ai voulu vous montrer que votre cousine
n'est pas malheureuse, et que son changement de fortune ne l'a pas
rendue mauvaise. Je sais que vous lui avez dit, à elle, que vous
désiriez quitter cette maison dès que vous auriez assez de force pour
travailler. Je viens vous dire que vous pouvez vivre ici comme si cette
maison était la vôtre.
– Merci beaucoup, Monsieur Guilherme ; je ne puis vous
être d'aucune utilité, il importe donc peu que je dise ou non que je
suis prêt à vous servir. Je suis un garçon qui a été élevé en
travaillant, j'ai mon atelier, et je compte y retourner.
– Mais, si vous voulez recevoir une formation pour être
plus qu'un simple ouvrier, je vous donnerai de quoi vous établir dans
le commerce, ou dans l'industrie...
– J'ai quelqu'un qui m'a déjà proposé cette faveur ; je
vous remercie, Monsieur, de votre bonté, mais je n'ai pas besoin, ni
n'éprouve aucun désir d'être plus que mon père. Je vais m'établir, s'il
plaît à Dieu, avec une fabrique de tissus, et je ne manquerai pas de
pain.
– Comme vous voudrez ; mais soyez sûr que vous avez en moi
un ami, et en Augusta, une protectrice.
– Je le sais bien ; et vous me pardonnerez mes folies. On
n'est pas toujours maître de soi.
– Je n'ai pas à vous pardonner. Vous vous êtes bien
puni vous-même. Vous avez retourné contre vous l'arme qui devait me
tuer. N'en parlons plus.
......................................................................
......................................................
XIV
Cet épisode altéra l'insouciant bonheur d'Augusta. Son
allégresse perdit
beaucoup de cette intimité spontanée. Les sourires ne lui venaient plus
de sa conscience, comme une approbation à sa position de femme grandie
par le déshonneur. Un amour immense, cette sujétion qui la forçait à
persévérer dans le crime, ne l'encourageaient pas, comme tant d'autres
de sa condition, à se soumettre aveuglement à la fatalité, à s'habituer
à sa faute, en étouffant le cri d'un remords tardif.
C'était une femme extrêmement originale, douée de vertus
fort inconsidérées, n'est-ce pas ? Elle eût mieux fait de
transiger
avec le vice, de s'accommoder de l'irrémédiable, de suivre enfin le
système qui nous invite à nous soumettre au fait accompli. C'est ce que
font bien des gens, plus avisés que la sensible couturière.
Ce qu'elle ne savait pas faire, comme le font bien des
gens, c'est dissimuler, faire une bonne figure stéréotypée, s'attirer,
comme l'esclave d'un harem, avec d'artificieuses caresses, un sourire
voluptueux de son maître.
Amaral avait senti la différence, et interrogeait en vain
le silence résigné d'Augusta.
– D'où vient, disait-il, cette mélancolie qui n'est pas
dans ton caractère ?
– Je suis heureuse, Guilherme...
– On ne le dirait pas...Si j'avais fait une chose qui te
chagrinerait au point de provoquer le remords de ce que tu es, tu ne
serais pas plus triste...
– Vois-tu en moi le moindre signe de remords ?...
– Tous les signes. Tu étais différente avant notre sortie
au théâtre, et avant cet incident avec ton cousin...
– Le théâtre ne pouvait me faire changer... L'incident
avec mon cousin, il n'est pas surprenant qu'il me laisse un triste
souvenir.
– C'est passé, tout ça, Augusta... Ton cousin est remis et
heureux... Ces hommes ont des crises morales qui ne durent guère. Il
leur manque l'intelligence qui est la pierre où s'affûte le fil de la
douleur. Il a son travail pour s'occuper, et des besoins modestes, tous
satisfaits, comme récompense... Dois-je donc croire que ta tristesse
est due à des regrets ou à de la compassion pour ton cousin ?
– Ni regrets, ni compassion, Guilherme. S'il y a quelqu'un
qui mérite de la compassion...
– C'est toi ?!
– Non, pas moi... le corrigea-t-elle en l'embrassant,
pardonne-moi cette folie... Je suis vraiment heureuse avec toi ; je ne
veux aucune compassion, sinon de toi ...
– Quelle est la souffrance qui en mérite, mon enfant ?
– Je ne souffre pas... Je ne souffre pas....
– Et, malgré tout, tu pleures !
– Que veux-tu donc ? Aussi heureuse soit-elle, une femme a
besoin de larmes comme d'air... On pleure involontairement quand on est
heureux, comme on respire, quand on dort...
– Cette explication ne me satisfait pas... Je veux savoir
pourquoi tu pleures...
– Je n'en sais rien, mon ami.
– Que désires-tu ?
– De rien, pour moi, je n'ai rien à désirer... Je ne pense
qu'à toi... Je veux que tu sois vraiment heureux.
– On ne dirait pas... tes souffrances ne peuvent
m'inspirer aucune joie.
– Elles passeront...
Cependant, elles ne passaient pas...
Augusta avait oublié les livres, la musique, les fleurs,
les promenades à cheval, et même le goût instinctif (le plus précieux
de tous les talents chez les femmes) avec lequel elle s'habillait pour
surprendre son amant, en lui présentant de nouveaux attraits. Guilherme
ne méritait pas cela. Sa conscience ne l'accusait pas, mais le poussait
à avoir avec Augusta une explication plus sérieuse. Avant cette
démarche délicate il consulta le journaliste, l'immuable confident de
ses pensées les plus secrètes.
– Comment expliques-tu la tristesse d'Augusta ?
– À mon avis, ce doit être l'effet de quelque roman...
– Non.
– Si tu m'assures que non...
– Je te le garantis.
– Alors, tout s'explique. Tu me permets de te donner mon
opinion ?
– Quelle question !
– Cette femme veut que tu l'épouses.
– Allons donc !...
– C'est ce que je dis.
– Elle a donc des arrières-pensées ?
– Aucune ; elle cède à un sentiment honnête.
L'intelligence, que tu lui as par trop affinée, a fait naître des
ambitions qu'elle n'aurait jamais eues. Elle a commencé à prendre
conscience de son déshonneur. Elle veut se réhabiliter comme les
héroïnes de romans, où certaines femmes, jusqu'à l'avant-dernier
chapitre, se tiennent en équilibre avec leur honneur sur une corde
raide.
– Ce serait ça ?
– Et si c'est le cas, que fais-tu ?... Tu l'épouses.
– Non. Je n'ai jamais eu cette intention.
– Et tu ne lui as rien promis ?
– Clairement, non... pour autant que je m'en souvienne...
– Mais d'une façon équivoque, si ; tu as donc mal agi. Si
tu avais lu la satire de Boileau contre L'ÉQUIVOQUE, tu ne te
hasarderais pas à le dire.
– Mais depuis qu'elle est avec moi, nous n'avons jamais
effleuré un tel sujet.
– Ce n'est pas un argument.
– Je crois que tu te trompes... Aujourd'hui même je vais
la sonder là-dessus.
– C'est moi qui te le demande : aimes-tu beaucoup Augusta ?
– Je l'ai beaucoup aimée, et je peux dire que je l'aime
encore ; mais, depuis que je la vois se montrer froide avec moi, je me
suis un peu refroidi... Elle a eu tort de me contrarier...
– Elle t'a contrarié ?
– À quoi ça rime d'être mélancolique, quand je suis gai ?
En me mettant dans l'obligation de lui demander d'heure en heure ce
qu'elle a, elle finit par m'embêter. Tu sais que tout ce qui est
contrainte me pèse, et que je ne veux pas de menottes, moi. Si je
la contrariais, je lui demanderais ou je ne lui demanderais pas de me
pardonner ma faute ; je ne lui ai pas donné la moindre raison d'avoir
de la peine, et ça me coûte de me rabaisser... Cet ascendant me
révolte, qu'elle veut exercer sur moi... Sais-tu que toutes les femmes
se ressemblent, dès qu'elles atteignent un certain degré d'intelligence
!?
– C'est maintenant que tu découvres cette règle ? Elle est
vieille. La femme dont l'intelligence a été cultivée à l'école du
savoir-vivre, tombe aujourd'hui se réhabilite demain, retombe ensuite,
se remet en quelques heures, et avance, prête au change, la tête
tournée vers le soleil. Celles qui, une fois tombées, ne se relèvent
plus, sont des machines, de simples amas d'os, de muscles, et de
membranes, ce sont des idiotes qui ne se ménagent pas une bouée de
sauvetage, qui leur permettrait de se moquer du bois pourri, sur lequel
la vertu se trouve à la merci de vagues comme toi, comme moi et bien
d'autres que nous connaissons. Bigre ! J'allais perdre le souffle ! Une
période de cette taille, dans un livre, me discréditerait ! En résumé,
je voulais te dire qu'Augusta préfère être ta femme que ta maîtresse.
C'est à toi de voir.
– Je veux la prendre pour maîtresse, et il est impossible
qu'elle insiste pour me faire changer de position.
– Et si elle insiste ? Si elle te coince entre les deux
mâchoires d'un dilemme ?
– Je renoncerai à sa compagnie intéressée. Je suis certain
qu'elle n'y renoncera pas.
– Je le crois aussi... Dis-moi : n'entre-t-il pas chez toi
quelque prêtre avec un peu plus de morale que les abbés sous Louis XV ?
– Il n'y a que toi qui peux entrer chez moi.
– En ce qui me concerne, il est certain que je ne lui
souffle aucun scrupule sur la liberté de ses mœurs. L'on ne peut
craindre qu'une seule chose : qu'elle ne se sente quelque penchant pour
la mystique. Si elle éprouve des scrupules, si elle se laisse aller au
fanatisme, elle te quitte... Sais-tu qu'un soupçon m'effleure, fort
raisonnable ?
– Quel soupçon ?
– Ton amour pour Augusta ne laisse plus place à aucune
cristallisation.
– Aucune
cristallisation ? je ne comprends pas.
– C'est parce que tu n'as pas lu la
Physiologie de l'amour de Stendahl.
(10) La cristallisation, ce sont les
beautés imaginaires, les
formes variées, les merveilleuses nuances que tu associes à la femme
qui te fait penser à elle deux heures, tout frémissant d'espoirs et de
désirs. C'est le fait d'associer le merveilleux à l'ordinaire. Or, toi,
tu n'imagines plus rien sur Augusta. Les cristaux se sont fondus : il
est resté la femme...
– Que j'aime encore.
– Ne te fais pas d'illusions, Amaral... Je me suis montré
terriblement prophétique...
– Pas du tout... J'aime Augusta ; si je ne l'aimais pas,
sa mélancolie ne me ferait rien.
– Mais tu ne te sens pas disposé à la consoler de
telle sorte qu'elle ne doute plus de la haute estime dans laquelle tu
la tiens ?
– En me mariant avec elle ? Pour l'amour de Dieu ! Tu es
d'un comique ! Tu viens donc vraiment me conseiller de me marier
?
– Je conseille le mariage à tout homme qui vit dix-huit
mois avec une femme et qui, au bout de cette éternité d'amour, dit
encore sans être un imposteur : je l'aime. Une femme que l'on aime
après dix-huit mois de cohabitation, on l'aime toute sa vie, qu'elle
soit notre maîtresse ou notre femme. Comme c'est mon heure de
sincérité, laisse-moi te dire que tu ne trouveras pas de femme qui
vaille Augusta. Si tu te sépares d'elle, je te comparerai à l'avare qui
avait amassé un trésor, et qui, enivré par sa fortune, passait des
nuits et des jours à le contempler ; et, la joie le mit dans un tel
état, qu'il perdit la raison, et jeta, dans sa folie, son trésor par le
fenêtre dans la rue. Ce trésor, c'est cette femme simple, immaculée,
sainte, en face de la corruption et de la duplicité de toutes celles
que tu as connues. Tu imagineras un ange ; cet ange est sorti parfait
de tes mains. Tu as fait d'un cœur brut ce que Phidias a fait avec du
marbre. Aucun homme n'en aura tant fait, et aucune femme n'aura autant
répondu aux inspirations d'un homme. L'amour peut beaucoup, il
transfigure bien des natures, il donne une nouvelle apparence à la
femme magnétisée ; mais il n'est pas tout-puissant, il ne fait pas les
miracles que l'on a vus, et que l'on voit tous les jours produire ton
amour sur Augusta... Tu es un ingrat vis-à-vis d'elle et vis-à-vis de
Dieu, si tu l'abandonnes !
– T'ai-je dit que j'allais l'abandonner ?!
– Aurai-je par hasard besoin que tu me le dises ?!
Tu es
pour moi un homme transparent ; je peux suivre, sans la double
vue du
mesmérisme, les moindres opérations de ton esprit. L'agacement que
trahissent tes remarques face à la mélancolie d'Augusta, c'est comme si
tu ouvrais la bouche au quatrième acte du meilleur drame. Il y a un an,
la tristesse d'Augusta aurait été pour toi une nouvelle raison de
l'admirer : tu aurais parlé d'une poétesse, d'une rêveuse, d'une nature
privilégiée, d'un esprit capable de comprendre l'idiome des archanges.
À présent, ce visage sombre ne te paraît plus aussi beau, et les larmes
d'un cœur silencieux te dérangent.
– Et elles pourraient me déranger à n'importe quel moment,
si j'admets qu'elle cherche effectivement le mariage.
– C'est l'hypothèse la plus honorable pour Augusta. Ne te
semble-t-il pas naturel, ce désir, chez une femme à qui tu as donné
autant d'esprit que toi ? Je trouve même logique cette noble ambition.
Il y a un an, Augusta était encore la femme de l'amour, mais
uniquement de l'amour-passion ; aujourd'hui, il y a un esprit qui se
donne à la place d'un autre esprit ; une intelligence qui épouse une
autre intelligence ; une idée claire du devoir et de l'honneur qui
domine les emportements de la passion, et lui apprend ce qu'est la
plénitude du bonheur sur la terre.
– C'est le mariage ?
– Ce doit l'être, quand cette femme est Augusta, et
l'homme, si tu n'étais pas ce que tu es, il est ce que je pense qu'il
serait.
– Et tu te marierais, toi ? !
– Avec la plus riche héritière et la plus grande beauté au
monde, non ; mais, à ta place, avec Augusta, oui.
– Tu es un être admirable !
– Écoute, Amaral, ne blesse pas ma modestie ; je te dis
que je suis vraiment un être admirable... Ne donne pas à ces mots un
sens ironique... Toi aussi, tu es un être admirable : mais pour moi, tu
es une chose aussi lisible qu'une manchette à la quatrième page d'un
journal... Voici une autre prophétie... Le fil qui t'attache à Augusta
peut être demain coupé par la première Cecília qui voudrait t'absoudre
de tes erreurs passées, en t'imposant, comme pénitence, de renoncer à
tes amours avec cette aristocratique couturière.
– C'est un outrage que je démentirai.
– S'il s'agit là d'un outrage, il ne s'adresse pas à toi,
mais à la nature, une matrone que je respecte pour ses incartades et
l'importance qu'on accorde à ses égarements. Le "Connais-toi toi-même"
du philosophe ancien est une sottise. Qui se connaît ? Qui peut prendre
la responsabilité de ses actes de demain ? Il n'y a pas de définition
exacte de la vertu, ni du crime. Tu élèves aujourd'hui une femme avec
l'enthousiasme d'un illuminé ; demain tu rejetteras cette femme dans
son néant avec la force d'un instrument qui obéit à une volonté
supérieure. Tu ne sais si tu as été vertueux hier, ou si tu l'es
aujourd'hui... Nous sommes lamentables, mon cher Guilherme. La
dépravation humaine se confirme en moi, en toi, chez ceux qui croient
s'abreuver aux plus pures eaux des sources de la science.
L'intelligence, c'est la corruption qui s'étale ostensiblement dans
toute sa clarté. Le benêt se cache ; nous nous félicitons de nos
scandales... Je ne sais à quoi rime ce bout de philosophie...
– Moi non plus.
– Il se trouve qu'il va êtres onze heures du soir, et que
je n'ai pas encore écrit mon feuilleton de demain... Je vais le
griffonner sur ton écritoire. Augusta a dû remarquer le temps qu'a duré
notre entretien. Demande-lui de jouer
Casta
Diva pendant que j'écris.
– Aujourd'hui tu écriras sans musique... Je vais essayer
de déchiffrer cette énigme qui me paraît indéchiffrable après tes
explications.
(1) C'est une tortue de mer.
D'aucuns l'écrivent avec un C. Vous pouvez
le lire comme vous voudrez. Nous usons de l'orthographe qui s'est
gravée d'emblée dans notre mémoire, durant les années de mon enfance.
Nous nous souvenons de A. arbre ; B. ... et cetera, jusqu'à K. Kágado.
Notre loyauté aux principes du roman, exige l'exhibition d'un tel
qualificatif, que nous trouvons dissonant, un coup de griffe répété à
l'harmonieuse mélopée de l'éducation. Prenons notre mal en patience.
(2) Le mot cagado,
accentué autrement, est le participe passé du
verbe cagar (chier). Le Garde des Sceaux ne se refuse aucun à-peu-près
scatologique. À moins qu'il ne pense au coffre qui tient lieu de
carapace au marchand de morue. (NDT)
(3) La sentence de la
juridiction de
Porto, prononcée le 2 Février
1810, est rédigée en ces termes, à la page 9 :
“L'enquête ayant établi très clairement qu'aux dits jours
de troubles et de regrettables atrocités, n'a pris part aucun des
honorables habitants de cette ville, lesquels se sont vraiment
distingués par leurs qualités, leur caractère, leurs élans patriotiques
et leurs actions généreuses, s'attachant personnellement à défendre
l'intérêt commun et le droits du souverain ; ils sont le fait d'une
bande de criminels abjects, de scélérats sortis des plus bas fonds,
pour la plupart étrangers à notre cité, ennemis de l'ordre, de la
tranquillité, qu'ils s'emploient à bouleverser et à subvertir."
Ce qui est sûr, c'est que "les honorables habitants de
notre ville" ont parfaitement vu l'utilité de leurs demeures,
puisqu'ils ne sont pas sortis de chez eux.
Dix mille assassins enrégimentés viendraient de la Maia ou
de Valongo ? Nous devons croire, avec les témoignages et la tradition
encore vivante des contemporains de l'invasion française, qu'un grand
nombre de ces anarchistes étaient de Porto. Et, s'ils ne l'étaient pas,
le nombre "des honorables habitants de Porto”, était, comme le dit la
sentence, fort réduit.
(4) Les pièces valaient alors
6.400 réis. (NDT)
(5) Pour le lecteur curieux de
savoir comment ce clerc de Porto a
évangéliquement compris ce jour-là sa mission, je vais vous donner un
passage textuel de ce manuscrit monacal intitulé : Mémoires
Chronologiques Critiques et circonstanciées (le moine se souciait peu
de l'orthographe, mais il s'y entendait en majuscules) de l'Invasion
Française au Portugal en 1809 ; et Relation Particulière de la
Très-Noble et Toujours-Fidèle Ville de Porto, etc, etc, etc. Le moment
est venu de dire que je dois à monsieur João Nogueira Gandra ce
jaillissement de succulents aperçus sur une époque dont l'illustre
bibliothécaire promet de nous donner une histoire fournie et
minutieuse. Voici donc l'apologie du clerc, pour ce qui s'est passé le
29 Mars 1809 :
"Il n'est pas possible
de passer sous silence la valeur de
quelques vassaux aussi fidèles qu'intrépides qui, voyant l'ennemi à
l'intérieur de nos murs, s'approchent en rampant courageusement et font
feu sur lui. Les valeureux clercs qui campaient dans le Palais
Épiscopal préparent leur artillerie, et marchent, avec une de leurs
pièces sur la Place de Santo Ildefonso, sous les ordres du Père
Francisco Correia, sous-lieutenant, et neveu du commandant, l'autre
restant sur l'Arco da Senhora de Vandoma ; s'y est jointe toute la
troupe qui se retirait des batteries ; ils y attendent l'ennemi. Dès
que celui-ci arrive, on l'accueille par un feu roulant d'artillerie et
de mousqueterie, en reculant à mesure que l'ennemi gagnait du terrain,
jusqu'à ce que celui-ci parvienne à s'approcher de l'Arco da Vandoma ;
là, les coups de feu ont repris de notre côté, jusqu'à ce que la
nombreuse cavalerie de l'ennemi parvienne à passer à travers nos coups
de feu ; les commandants des vaillants ecclésiastiques et des vaillants
étudiants étaient, au cours de cette action, le Bénéficiaire Manuel
João da Silva, et le père André António Correia, l'un à la tête
de l'infanterie, l'autre à la tête de l'artillerie ; ils ont
suffisamment prouvé leur valeur et leur intrépidité, en présence du
Révérend Deão, colonel du dit Corps qui commandait en chef dans ce
secteur, lequel a tué hardiment un orgueilleux Dragon Français, imité
en cela par le commandant de l'Infanterie qui a tué, rua de Santo
António do Penedo un officier de Cavalerie Français, qui invitait les
siens à percer nos rangs, etc."
Ces prêtres, quelques jours après, levaient de leurs mains
souillées de sang l'hostie consacrée du si patient agneau ! S'il ne
pouvait compter sur un soutien providentiel, le Christ aurait mille
fois succombé au ridicule de ses prêtres.
(6) Camões ayant écrit
alcançando, et non
apanhando, nous n'avons
cependant pas pris sur nous de proposer "rejoindre". Il se peut que
Camilo se permette les mêmes approximations que Proust avec Racine. On
ne saurait le lui reprocher. (NDT)
(7) Le Cours de Mathématiques d'Étienne
Bezout ( 1730 - 1783
) n'a plus été réédité depuis longtemps. La postérité est ingrate.
(NDT)
(8) Dans plusieurs passages,
Castelo Branco utilise pour qualifier
Francisco le terme
artista en
lieu et place de l'attendu
artesano.
Nous
l'avons rendu à chaque fois par
ouvrier.
(NDT)
(9) En français dans le texte
(NDT).
(10) Stendahl intitule
simplement son traité
De l'amour.
(NDT)
